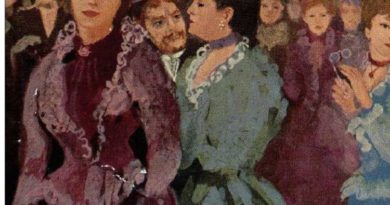Son Excellence Eugène Rougon – Émile Zola
 |
Son Excellence Eugène Rougon. 1876Origine : France
|
Sans surprise, Eugène Rougon a fait son trou dans le landernau politique du second Empire. Grimpé au rang de président du Conseil d’État (administration chargée de vérifier la légalité des lois, contrôlée alors par l’Empereur), il est pourtant tombé en disgrâce, ce qui le pousse à la démission. L’éloignement du pouvoir ne contrecarre pas ses ambitions. Entouré d’une foule d’amis naviguant principalement dans le monde des affaires ou tout simplement issus de la haute société mondaine, il ne se retire que pour mieux revenir en force lorsque la situation sera propice. Ses alliés travaillent dans ce sens, espérant bien qu’une fois revenu aux affaires, le “grand homme” comme ils l’appellent leur renverra l’ascenseur. L’occasion se fera attendre mais se présentera bel et bien. Eugène Rougon deviendra le puissant ministre de l’Intérieur d’un Second Empire en pleine période autoritaire. Mais dans le microcosme du palais des Tuileries, où les coulisses ne sont jamais en repos, il n’est pas dit qu’un nouveau revirement ne viendra pas changer la donne.
Pour quiconque a entrepris la lecture des Rougon Macquart dans l’ordre de publication, Eugène Rougon est loin d’être un inconnu. Petit-fils d’Adelaïde Fouque, la matriarche, il est aussi le fils aîné de Pierre Rougon, seul membre de la deuxième génération à être né d’une union légitime. Ayant hérité de l’avidité de son père et de l’entêtement de sa mère, Eugène n’a pas hésité à mettre à profit son incontestable intelligence pour assouvir sa soif de pouvoir, et en faire bénéficier ses proches et fidèles. C’est ainsi que dès La Fortune des Rougon, c’est lui qui conseille son père pour l’ériger en défenseur de la cause gagnée de Napoléon III face à une pseudo menace républicaine dans la cité assoupie de Plassans. Par la suite, il procure aussi ses bons conseils à son frère Aristide, monté à Paris pour y participer à l’emballement immobilier décrit dans La Curée. Influent, Eugène n’hésite pas à user de son pouvoir pour rendre service, s’attirant ainsi des soutiens qui, une fois leur fortune faite, renforceront ainsi sa position. Dans ce Second Empire en proie à ce genre de collusions, un camp alimente l’autre. Il était donc inévitable qu’un des romans du cycle soit consacré à Eugène Rougon et plus généralement aux hautes sphères politiques et au monde des affaires qui tourne autour. Non pas pour s’attaquer frontalement à Napoléon III comme a pu le faire si violemment Victor Hugo, mais plutôt pour continuer à décortiquer en naturaliste la nature d’un régime que pourtant Zola n’a pas porté dans son cœur. Son mépris de l’Empire, l’auteur ne le clame pas en politicien, et ne l’a pas fait non plus au moment du règne. Écrite après la chute du Second Empire, son œuvre est un travail de dissection sociale, reposant sur un raisonnement aux volontés scientifiques s’appuyant (certes avec des points de vues que l’on pourra trouver biaisés) sur différents pans de la société de cette seconde moitié du XIXe siècle. Le monde politique en est un, et bien que l’on aurait pu attendre de Son Excellence Eugène Rougon qu’il soit l’un des plus polémiques des Rougon-Macquart, ce sixième opus s’avère singulièrement sobre. On y trouvera aucun passage choc, aucune fièvre, bref rien de ce qui fera le succès polémique du roman suivant, L’Assommoir. Pour mieux épouser le climat quelque peu conspirateur et communautariste qui règne aux environs des Tuileries, Zola adopte un style discret soulignant les perpétuelles expectatives séparant deux évolutions, celles dans lesquelles se déroulent des tractations hypocrites mais préservatrices des convenances. Les déchéances spectaculaires façon Gervaise Macquart, ce n’est pas la finalité de cette grande bourgeoisie parisienne dont les préoccupations sont pour le moins éloignées de la simple survie. Dès lors, il est forcément plus difficile de développer une quelconque empathie pour tous ceux qui raccrochent leur vie à ces bassesses omniprésentes au sommet de l’État.
C’est bien simple : aucun des personnages de Son Excellence Eugène Rougon n’inspire la sympathie. Pas le moindre protagoniste, alors que le roman en compte quand même plusieurs (toute la bande à Rougon et au-delà, jusqu’à Napoléon III lui-même). Ils n’inspirent pas vraiment non plus de la haine, du moins pas dans le sens où pourraient l’inspirer des personnages qui, comme les patrons de Germinal, non seulement abusent sciemment de leurs pouvoirs pour leurs propres intérêts, mais se montrent aussi prêts à écraser des hommes en position de faiblesse. Ici, le mal que les personnages se font entre eux est d’une autre nature : ils se combattent en requins, et le perdant ne pourra pas être totalement écrasé tant que durera l’Empire. Opposé à Marsy, son prédécesseur au ministère de l’Intérieur, Rougon lui-même connaît au cours du livre deux disgrâces dont il se sortira. Son rival n’en fera pas moins, et tous deux finissent le livre dans une bonne situation. Du reste, l’Empereur -vu comme discret et se plaçant au dessus de la mêlée- semble avoir compris qu’il a tout à gagner à opposer ces deux factions. L’une (Marsy) incarnant la tolérance, l’autre (le rustre Rougon sorti de sa campagne) l’autoritarisme. Les partisans de Rougon avec lesquels Zola compose ses pages se moquent pas mal de savoir quelle sera la politique menée : ils ont choisi leur poulain, celui qui pourra leur amener ce qu’ils demandent (qui une place pour le fiston, qui l’aménagement d’une ligne de chemin de fer près de l’usine, qui une décoration…) et ils le soutiennent jusqu’à ce qu’ils aient épuisé tout ce qu’ils aient pu obtenir de lui. Leur situation n’étant pas vitale, ils peuvent même se permettre de patienter un peu, car la présence d’un ami au gouvernement n’est en fin de compte qu’un investissement pour l’avenir, au même titre que le serait un investissement financier. Rougon n’est pas dupe de ce jeu, mais il sait également qu’il ne peut se passer de ces soutiens qui constituent une cour dans ses appartements puis jusque dans son cabinet ministériel, où ses relations qu’elles soient politiques ou non entrent et sortent au nez et à la barbe de véritables politiciens venus s’enquérir des charges dont doit les investir “son Excellence” et dont le seul défaut est de ne pas être liés à lui. Il en résulte que les relations entre personnages ne sont aucunement amicales. Ce n’est qu’un jeu, une sorte de théâtre mené par la bonne société pour réussir à se placer. Preuve en est qu’après plusieurs années de soutien, tout le monde peut aussi bien aller chez le voisin pour voir si l’herbe y est plus verte. Toutefois, dans ce Paris extrêmement mondain, les apparences comptent énormément, et c’est pour cela que tout le monde fait comme s’il s’agissait d’une véritable proximité affective. Tout est une question d’allure, et cela vaut aussi pour la politique : tout en décrivant jusqu’à la lourdeur le luxe des ors de l’Empire, Zola nous dresse le portrait de ces gens consacrés tout entier au clientélisme. L’introduction et la conclusion à l’Assemblée sont à ce titre éloquentes, puisque les visiteurs sont venus guetter le sort de Rougon, parfois avec les jumelles de théâtre pour regarder la tête des députés. Plusieurs séances à la même Assemblée sont d’ailleurs purement et simplement boudées, les députés préférant éviter les sujets techniques (demande de subvention de tel ou tel département) pour mieux converser à la buvette ou dans les jardins avant d’être de retour pour un sujet plus trivial, voire même quelque peu injuste, mais éminemment plus attractif comme les larges subventions données à l’Empereur pour le baptême en grandes pompes de son fils. Les hommes comme Rougon et sa cour ont beau pérorer au sujet de la grandeur de l’Empire, ils ne font en réalité que déshonorer le cadre grandiloquent dans lequel ils officient. Rougon n’est pas au service du pays, mais bien de ses amis, et à travers eux de lui-même. Tel est ce à quoi ressemble “l’Empire”, un terme pourtant chargé d’un certaine magnificence, mais qui comme les dorures des palais n’est qu’un moyen de mieux faire croire que cette clique politicienne se préoccupe vraiment du pays. Un moyen de se payer une dignité auprès d’un peuple qui -à part bien entendu les affairistes de tous poils collés aux basques des politiques- n’a pas grand chose à attendre de ces gens. Tout au plus peut-il espérer des faveurs visant à acheter la paix sociale, dont certains (y compris ceux qui disaient l’inverse hier) se feront les gorges chaudes. Ou bien courber l’échine jusqu’à ce que l’orage passe. Telle est la seule différence entre la période autoritaire et la période libérale de l’Empire. Après tout, la France d’alors avait connu pas moins de trois révolutions et six régimes politiques en moins d’un siècle (il en restait encore un à passer pour garder une certaine stabilité jusqu’en 1940), et quelques concessions ne font pas de mal.
S’il est largement bien moins poussé que dans d’autres romans du cycle, l’aspect psychologique n’est pas complétement absent de Son Excellence Eugène Rougon. La plupart des personnages sont d’une superficialité et d’un arrivisme à faire peur, mais deux d’entre eux ont droit à un traitement de faveur, si l’on peut dire. Il y a Rougon lui-même, ainsi que et surtout Clorinde, jeune et belle aristocrate italienne après laquelle court “le grand homme”. D’ordinaire plein de sang-froid, Rougon se laisse mener par le bout du nez par cette manipulatrice qui sait parfaitement jouer de son physique pour se rendre indispensable. Devant elle, l’épée du Régime devient le rustre paysan qu’il aurait pu être et ne possède alors plus aucun sens du discernement, lui qui par sa fonction de Ministre de l’intérieur est pourtant amené à être d’un naturel méfiant. L’homme décrétant des quotas d’arrestations politiques à chaque préfet n’est pas capable d’entraver les projets de Clorinde, tombe dans le panneau de la douce ingénue aussi bien que dans celui de la fieffée libertine qu’elle revêt selon la nécessité et les circonstances. Pour elle, tout est bon pour grimper les échelons. Rougon n’est que l’hôte sur lequel elle fixe sa présence parasite. Contrairement aux autres, elle n’a même aucun desiderata affairiste, elle ne semble que vouloir être puissante. Se refusant à lui, elle est même prête à aller loin pour le soumettre, fut-ce au risque de se faire violer. Mais c’est le jeu qu’elle a entrepris, et même, cela témoigne de la dépendance qu’elle a su faire naître chez Rougon. Celui-ci n’ayant d’autre but que de la sauter, pour parler trivialement, elle sait qu’il ne la lâchera pas. Mais elle le fera lorsqu’elle sera arrivée à son but : Napoléon III lui-même, qui dans le fond n’est à ce niveau pas très différent de Rougon. Au passage, en entrant dans les cercles du pouvoir, elle aura aussi fait siens les fidèles de Rougon. Intelligente, elle a même su jouer sur la fierté de ce dernier, en l’intimant de la prendre pour épouse. Ce qu’il n’a pas voulu faire, car cela serait revenu à admettre sa défaite et placer Clorinde en position de force. Au lieu de cela, Rougon a épousé la sœur insipide d’un de ses lèche-bottes (histoire de se donner une situation de bon bourgeois), tandis qu’il a arrangé le mariage de Clorinde avec un autre de ses fidèles, connu pour son manque de personnalité et qui ne brillera certainement pas par sa capacité à voir la vraie nature de sa femme. Rougon et Clorinde peuvent donc continuer leur affaire, l’italienne ne pouvant qu’écraser le provincial en profitant de l’attitude irraisonnée de celui-ci à son encontre. Elle-même est totalement libre, et son attitude n’est pas sans inspirer d’autres “dames” de la bonne société. Une scène en particulier se montre révélatrice du rôle qu’acceptent de jouer les femmes : au cours d’une vente de charité organisée par l’Impératrice au palais des Tuileries, toutes n’hésitent pas à étaler leurs charmes auprès de ces riches messieurs pour les persuader d’acheter des babioles à un prix exorbitant. On pourrait taxer Zola de misogynie, et on doit bien admettre que c’est un peu le cas, mais à travers les femmes il incrimine surtout les hommes de pouvoir (politiques ou financiers), ceux qui se posent en sauveurs et qui cèdent avec une naïveté de collégien à de grossières manipulations. Ils étaient déjà hypocrites et égoïstes, mais cela achève de faire d’eux de parfaits crétins. C’est pourtant dans leurs mains que se construit la France du renouveau. Le mépris qu’ils suscitent est finalement bien plus humiliant que d’être haïs, sentiment que l’on éprouve envers un ennemi d’envergure.
N’étant certainement pas le plus fort des livres du cycle des Rougon-Macquart, Son Excellence Eugène Rougon n’en est pas moins un opus brillant. Plutôt que de miser sur les effets choc, Zola préfère concevoir un roman aseptisé, laissant une impression d’ironie cruelle sur le mode de vie de tout un petit monde très loin de toute réalité. Et encore une fois, les propos qu’il tient ne sauraient être sans nous ramener à notre temps présent… Qui peut réellement croire que nos hommes d’État et nos gros industriels se préoccupent vraiment du peuple laborieux ? La collusion entre finance et politique s’étale encore bien souvent sur le devant de la scène, sans parler des histoires de femmes. Et le tout sous couvert d’une République au sujet de laquelle ils parlent quasiment avec la main sur le cœur et la larme au groin. Certes, la modernité est passée par là, et des efforts ont malgré tout été faits. Mais le clivage entre ce monde et celui de n’importe qui ressemble toujours à un gouffre, qu’on essaie malgré tout de remplir par des écrans de fumées au gré de l’actualité (“déclaration du patrimoine” et autres manœuvres politiciennes stériles qui ne réduiront aucunement ce gouffre).