La Curée – Émile Zola
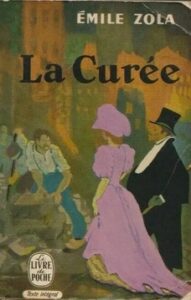 |
La Curée. 1872 Origine : France
|
Le deuxième tome des Rougon-Macquart est, du moins pour le plaisir de la lecture, le démarrage de la série après un premier opus, La Fortune des Rougon supportant la lourdeur de toutes les présentations familiales et des descriptions naturalistes allant avec. Quoique contenant aussi une intrigue propre, ce démarrage ne peut prétendre rivaliser avec les meilleurs opus de Zola, dont le grand talent est de se saisir d’un sujet donné et de l’exploiter à fond à l’aide de personnages issus de la lignée des Rougon-Macquart. Ce qu’il ne pouvait faire tout à fait lorsqu’il avait en tête l’introduction descriptive de cet anarchique arbre généalogique. La Curée est donc le premier des romans de la série à se focaliser sur une seule branche de l’arbre, et à la plonger dans la vie du second Empire.
La cellule familiale qui en constitue le cœur est celle d’Aristide, fils de Pierre Rougon, qui dans La Fortune des Rougon parvenait à la reconnaissance tant recherchée en prétendant avoir défendu la ville de Plassans (berceau des Rougon-Macquart) de la menace républicaine, en fait inexistante. Aristide avait quant à lui misé sur l’échec du coup d’État de Napoléon III, ce en quoi il eut tort, mais se convertit illico au bonapartisme avec l’aide de son frère Eugène, bonapartiste de la première heure et monté à Paris pour y réussir une carrière politique. A la fin de ce premier roman, Aristide s’apprêtait lui aussi à monter à Paris. Au début de La Curée, nous le retrouvons sous le nom d’Aristide Saccard dans la capitale, habitant un hôtel particulier de luxe, preuve de son succès initié par un mariage d’intérêts avec Renée Béraud du Châtel, fille d’un riche magistrat mis sur la touche suite au triomphe du coup d’État. La fortune d’Aristide s’est alors développée sur la spéculation provoquée par les travaux dirigés par le Baron Haussmann, spéculation qu’Aristide, toujours avide d’argent, compte encore accroître malgré d’éventuelles difficultés. Pendant ce temps-là, sa femme Renée mène une vie de mondaine, passant son temps en compagnie de Maxime, le fils d’Aristide né d’un premier mariage (sa véritable mère est morte). Une relation belle-mère / beau-fils qui se mue en amitié, puis en amour semi-incestueux.
La Curée est comme son nom l’indique l’histoire d’une mise à sac complète. Celle de Paris, de sa transformation, de son éventration par les bâtisseurs et surtout par les financiers tels qu’Aristide Rougon et des autres financiers avec lesquels il travaille. Comme on peut s’y attendre, Zola n’est pas tendre avec ce milieu de requins dominé par l’hypocrisie, l’appât du gain et la malhonnêteté. Bien entendu, toutes ces tares sont dans la logique naturaliste de Zola associées pour Aristide Saccard à son ascendance familiale, cette branche officielle des Rougon qui est dominée par la cupidité (son frère Eugène -auquel un roman sera plus tard consacré- ne vaut pas mieux, c’est d’ailleurs lui qui lui suggère de changer de nom pour ne pas discréditer le sien au cas où un scandale financier éclaterait). On peut bien entendu critiquer ce raisonnement entièrement basé sur le dogme de la primauté absolue de l’inné sur l’acquis, ce que je ne me prive pas de faire encore une fois, mais après tout le lecteur est également libre de ne pas y attacher trop d’importance. Aristide pourrait aussi bien ne pas être le fils de cet autre grand arriviste de Pierre Rougon que cela ne changerait pas grand chose au fond, puisque Zola, contrairement à ce qu’il faisait dans La Fortune des Rougon, n’insiste pas sur les liens génétiques au sein de cette branche de la famille. Il faut véritablement connaître l’arbre généalogique pour découvrir pourquoi tel personnage est comme il est, c’est à dire la somme des caractéristiques de ses parents. Mais si l’on évite cette peine, il est aisé de faire l’impasse sur ce grossier raisonnement qu’est le naturalisme, marque d’une époque charnière rejetant la métaphysique, engagée sur la voie du matérialisme mais dominée par le déterminisme. L’important, et ce pour quoi Zola reste toujours aussi fascinant, est cette analyse impitoyable d’une époque, qui dans l’esprit critique de l’auteur était le terreau de l’épanouissement des tares congénitales, mais qui dans un esprit moderne (car il faut bien admettre que le naturalisme n’est plus vraiment d’actualité) n’existe que par elle-même, déterminant les succès et les échecs. Aristide Saccard est un homme cupide, cela ne fait aucun doute, mais rien dans La Curée ne s’oppose à voir en lui le fruit de son époque, celle où la spéculation immobilière prédomine, créant ainsi les opportunités d’enrichissement par des moyens douteux que le roman nous fait justement découvrir. Au sein de la meute affamée que constituent tous les spéculateurs, Aristide Saccard est certainement l’un des pires prédateurs : sauvé de sa réputation de républicain (née en fait d’une spéculation politique) par son frère, enrichi sur le dos d’une famille toujours riche mais isolée, exploitant sans vergogne les expropriations et les drames qui vont avec, bénéficiant des largesses du Second Empire et de ses accointances avec les intérêts privés de la grande bourgeoisie, auprès de laquelle il s’endette au point d’en être le serviteur volontaire (rappelons la justesse du constat de Marx selon qui l’État n’est que le représentant de la classe au pouvoir), adepte des montages financiers les plus tordus, Aristide Saccard est l’incarnation vivante de la pourriture de cette société parisienne pour laquelle la transformation de Paris, loin des conceptions hygiénistes mises en avant par Haussmann est surtout l’occasion rêvée de prospérer dans un luxe que Zola dépeint en détail avec son sens de la description poussé. A lui seul, Aristide résume tous les travers que Zola attribue à cette nouvelle bourgeoisie foncière. Il n’existe d’ailleurs que pour s’enrichir : le sentiment lui est totalement inconnu, et même les mondanités qui plaisent tant à sa femme (qui outre les ressources fournies par son patrimoine lui sert aussi de signe extérieur de richesse) ne sont pour lui que l’occasion de se mettre au mieux avec des personnages influents, députés, préfets et même l’Empereur, qu’il flagorne dès qu’il en a l’occasion. Son inhumanité est totale, on le sent prêt à la moindre bassesse pour s’attirer encore plus d’argent, chose qui sera établie dans le final où il en vient même à nier sa dignité. Un tel spectacle est écœurant, et la force de ce titre, La Curée, se révèle tout à fait dans le témoignage apporté par Zola sur cette débauche arriviste dans laquelle se vautre tous ceux réclamant avidement leur part du gâteau cuisiné par le Second Empire.
Si Aristide Saccard est de par son manque d’humanité un individu finalement fort simple psychologiquement, il n’en va pas de même pour son épouse Renée, principale protagoniste du livre, livrée à elle-même dans un monde d’apparat après avoir été arrachée à une éducation religieuse. Son mariage avec Saccard ne la chagrine pas : sur le moment, ce fut pour elle une porte de sortie honorable après avoir été violée et être tombée enceinte (elle fera une fausse couche), et surtout cela lui permet de profiter de l’existence bourgeoise, mode de vie dans lequel elle se livre à corps perdu faute de pouvoir faire autrement. Au milieu des épouses de divers dignitaires, Renée va de fête en fête, dans une débauche de chiffons payés hors de prix chez les tailleurs les plus réputés. Dans ce milieu, c’est à celle qui sera la plus excentrique, et Renée, dotée d’un physique avenant, se montre particulièrement brillante, restant à la limite de l’indécence (qu’elle franchira dans le final). Tout comme les hommes s’associent ou rivalisent en vue du marché offert par la reconstruction de Paris, les femmes s’unissent ou se méprisent en fonction de leurs propres intérêts, adoptant ou lâchant des amants en fonction de ce qu’ils peuvent leur offrir (seule Sigonie Rougon, sœur d’Aristide et célibataire endurcie, prend elle-même ses affaires en main, s’occupant d’activités pour le moins suspectes). Qu’il soit amoureux ou amical, le sentiment n’existe pas plus que dans le milieu des affaires : tout est une question d’instincts vénaux. Une mesquinerie permanente représentant la curée morale de ce monde détestable au sein duquel Renée finit par s’ennuyer, faute de stabilité émotionnelle. Ses amants ne lui procurent aucune joie, et son mari ne se soucie d’elle que lorsqu’il en a besoin. Comme tous les hommes de la haute société, il se fiche de savoir que sa femme a des amants, et il ferme les yeux sur la relation entretenue par Renée et Maxime, ce jeune homme paresseux trouvant refuge auprès des femmes pour se faire dorloter et auprès de sa belle-mère pour vivre en parasite. Il ne fait aucun doute que Renée n’est que la vache à lait de Maxime, qui profite d’elle à tous les sens du terme, inconscient ou dédaigneux de ce que la jeune femme peut éprouver pour lui (affection maternelle, puis amicale, puis amoureuse). Le drame personnel du roman réside dans l’aveuglement de Renée sur sa propre exploitation, sur ses sentiments trompés. La narration de Zola brille particulièrement d’une grande qualité littéraire lorsqu’il évoque les amours de Renée et de Maxime dans la serre, lieu où la végétation sauvage fait écho à la bestialité et au vice caractérisant les ébats de cette jeune belle-mère naïve et de son beau-fils profiteur. Mais il faut bien dire ce qui est : si ce n’est peut-être pour sa brutale prise de conscience en fin de livre, la destinée de Renée est loin d’être aussi touchante que celle de Gervaise Macquart dans L’Assommoir. Ses conditions de vie ne sont jamais épouvantables, bien au contraire, et une personnalité moins scrupuleuse aurait très bien pu s’en accommoder. Il s’agit essentiellement d’un drame psychologique au sujet d’une femme emportée dans le tourbillon des excès, rendue aveugle par le passage trop soudain entre une vie de bourgeoise rangée et une vie menée dans le luxe le plus tapageur. Renée passe tout simplement à côté de sa vie, ce qui est triste pour elle et révélateur pour un milieu donné, mais il y a des injustices bien plus grandes sous le Second Empire…. Cela dit, pour ce qui concerne l’ambiance morale des cabinets et des salons parisiens de cette époque, La Curée est aussi fort que peut l’être Germinal pour la condition ouvrière. Mais certains thèmes sont toutefois plus porteurs que d’autres, et la spéculation est très certainement moins parlante (quoique les débauches monétaires et ses dérives morales soient toujours d’actualité). D’où le relatif anonymat dans lequel se trouve La Curée face à d’autres livres du cycle des Rougon-Macquart.




