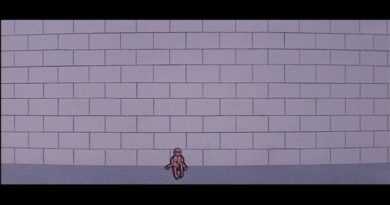Road House de Rowdy Herrington
 |
Road House. 1989.Origine : États-Unis
|

Bien qu’il jure le contraire, préférant mettre en avant les qualités de son ami et mentor Wade Garrett, James Dalton est considéré comme le meilleur videur des États-Unis. Alors qu’il semble occuper un poste en or dans une boîte à la mode, il accepte la proposition – à ses conditions ! – de Frank Tilghman de diriger la sécurité du Double Deuce. Direction le Missouri pour la ville de Jasper. Sur place, il trouve un établissement gangréné par les magouilles en tous genres et une clientèle particulièrement portée sur la bagarre. Pour sa prise de fonction, il effectue un grand ménage et dispense ses préceptes aux salariés restant. Les mentalités ne tardent pas à changer au sein du Double Deuce, pour le plus grand bonheur de son patron, qui peut enfin investir pour obtenir le bar dont il rêvait. Sauf que sa réussite ne plaît guère à Brad Wesley, maître argentier de la ville qui tient à garder ses ouailles sous son autorité. En conséquence, il envoie régulièrement ses hommes faire le coup de poing. Mais ils se heurtent invariablement à Dalton, qui n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds.

Devenu une star internationale et la coqueluche de ces dames depuis Dirty Dancing, Patrick Swayze tente avec plus ou moins de bonheur de se diversifier afin de ne pas être prisonnier d’un seul rôle. En France, Steel Dawn, récit post-apocalyptique, et le drame Tiger Warsaw se cantonneront, par exemple, à une exploitation stricte sur le marché de la cassette vidéo. Après avoir refusé de partager la vedette avec Sylvester Stallone dans Tango et Cash, la production ne cédant pas à ses exigences financières, il se laisse approcher par Joel Silver, toujours sur la brèche dès qu’il s’agit de trouver une nouvelle star du cinéma d’action. Ici, il n’est question pour Patrick Swayze d’incarner ni un énième ancien militaire, ni un détective privé et encore moins un flic un peu casse-cou. Non, Road House innove en proposant en guise de héros un videur de boîte de nuit. A ce titre, James Dalton s’inscrit davantage dans la lignée de Brian Flanagan, ce jeune homme ambitieux – normal, c’est Tom Cruise – qui rêve de conquérir Wall Street mais qui en attendant occupe un emploi de barman afin de pouvoir financer ses études. Succès aussi improbable que représentatif de son époque, Cocktail de Roger Donaldson, quasiment unanimement conspué par la critique, démontre qu’il existe une voie pour des héros du quotidien. A l’instar de Brian Flanagan, Dalton a lui aussi ciré les bancs de l’université mais plutôt au département philosophie. Davantage que son compte en banque, c’est son esprit qu’il cherche à enrichir. Jamais avare en formules à l’emporte-pièce (“Dans une bagarre, il n’y a pas de vainqueur.”), il distille une forme de philosophie à l’orientale avec mouvements de kata au sortir du lit qui tranche avec le côté bourru de ses congénères. Il impose une forme de hauteur de vue, privilégiant d’abord le dialogue mais ne dédaignant jamais le bourre-pif car au bout du compte, il convient de se faire respecter et seule la démonstration de force semble pouvoir y parvenir. Une notion particulièrement vivace dans ces contrées reculées.

Pour son deuxième film après le thriller Jack’s Back avec James Spader, Rowdy Herrington hérite d’un scénario qui a tout du retour aux sources. Road House fait l’effet d’un ras-le-bol. Par sa facture classique et le lieu de l’action, le film marque une volonté de tourner le dos aux années frics, strass et paillettes de la décennie en cours, et milite pour une certaine authenticité. Il y a du western dans cette intrigue qui s’attache à un personnage aux allures de redresseur de torts dans une bourgade cornaquée par un propriétaire sans foi ni loi. Cette opposition entre James Dalton, un type aux valeurs simples, proches des gens du peuple (enfin jusqu’à un certain point) et le côté m’as-tu-vu et autoritaire de Brad Wesley sonne comme une attaque en règle des valeurs superficielles et individualistes dispensées durant les années 80. L’ironie tient à la présence de Ben Gazzara dans le rôle de l’antagoniste, lui qui a trouvé son bonheur d’acteur dans le cinéma indépendant de John Cassavetes et Peter Bogdanovich, face à un pur produit du cinéma des années 80, coupe mulet incluse. Mais au-delà de cette inversion des rôles, les deux personnages qu’ils interprètent entretiennent des similitudes. A son échelle, James Dalton ne fait rien d’autre qu’exercer son autorité, soumettant les membres du personnel et les consommateurs du Double Deuce à ses prérogatives. Au passage, il façonne une troupe de fidèles qui le suivent aveuglèment dans l’exercice de sa fonction. Néanmoins, et en dépit des pleins pouvoirs qui lui ont été octroyés, Dalton demeure un employé. Mais du genre employé du mois, prompt à susciter l’envie ou la haine chez ses collègues et devant lequel toutes les femmes se pâment. Car la confrontation entre Dalton et Wesley se joue aussi sur le plan de la séduction. Denise, l’actuelle petite amie de Brad, ne cache pas son attirance pour le ténébreux préposé au service d’ordre quand le Dr Elizabeth Clay lui tombe carrément dans les bras. Leur petite partie de jambes en l’air au clair de lune sous l’oeil inquisiteur du maître de la ville prend alors des airs de provocation lorsqu’il devient évident que Brad Wesley en pince lui aussi depuis longtemps pour la docteur. Tout concourt à ce que les deux hommes demeurent irréconciliables, jusque dans leur manière de conduire, symptomatique de leur manière d’être. L’un, Brad, conduit comme s’il était seul au monde, zigzaguant sur toute la largeur de la route au son d’une country médiocre quand l’autre, Dalton, reste bien sagement sur sa voie, se rangeant même bien sagement sur la bas côté pour éviter les conflits. Dalton se rêve en homme tranquille, qui répugne à la violence car il ne sait que trop ce qu’elle peut engendrer. On pourrait dès lors disserter sur son choix de vie qui tient du sacrifice au nom d’un idéal qu’il sait difficile, voire impossible, à atteindre. Il n’ignore pas que la société est malade et tente vaillamment d’y remédier, même s’il n’est pas à l’abri d’un dérapage. La vérité tient à un trauma, une pierre dans son jardin qu’il porte comme une croix. L’homme est faillible et sa rédemption tient parfois à pas grand chose.

Road House traite d’un rapport à la violence ambivalent qui confine au masochisme. Voir ces hommes de main revenir inlassablement à la charge et s’en prendre tant et plus dans la figure démontre un certain sens du tragique. Jouer les durs, miser sur l’intimidation et la force du nombre fonctionnent contre un adversaire qu’on appréhende pour la première fois. Il s’agit alors de marquer son territoire, de faire savoir qui est le véritable maître à bord. Mais une fois les forces en présence connues, la poursuite de cette mascarade tient alors du sacerdoce. Il y a quelque chose de pathétique dans cet entêtement forcené bâti sur une forme de confiance en soi qui confine à l’inconscience. On peut y voir également de la noblesse. Ces pauvres types se savent battus d’avance et pourtant ils reviennent, emplis d’espérances. Ils font le job parce qu’il faut bien justifier son salaire. Et même si leur rôle peut paraître ingrat, ces sbires servent par leur vaillance à magnifier le héros. Road House baigne dans la testostérone, renouant avec les codes du western d’antan qu’il transpose tel quel à l’époque contemporaine. Dans ce contexte, les personnages féminins se retrouvent le plus souvent réifiés. C’est cette femme qu’on offre en pâture à des soulards contre quelques billets verts. Ou Denise, blonde sculpturale que Brad exhibe tel un trophée et qu’il rudoie si elle ose s’affranchir de son emprise. Elizabeth Clay n’est pas mieux servie, réduite à son postérieur par un Wade Garrett dont la braguette semble prête à exploser. James Dalton a beau se montrer sous un jour plus charmant, elle ne sert qu’à le valoriser, s’étonnant du nombre conséquent de ses blessures et le complimentant sur sa manière de recoudre ses plaies. Pour ceux qui en doutaient encore, Dalton n’est pas une chochotte. Partant de là, leur romance emprunte des chemins balisés même si le récit a le bon goût de nous épargner le gimmick de la demoiselle en détresse. En danger, Elizabeth ne l’est que par les menaces indirectes proférées par un Brad Wesley particulièrement remonté et meurtri. Mais son oncle à beaucoup plus à craindre, comme d’autres commerçants de Jasper, en tant que débiteur éternel du maître de la ville. Lui, comme Frank Tilghman, le concessionnaire ou encore le paysan qui héberge Dalton, sont les laissés pour compte de cette histoire alors qu’ils sont les premiers impactés par cette situation. Ils restent la plupart du temps en retrait, subissent quelques humiliations avant de se rebiffer, exploitant pleinement la lutte de pouvoir qui se joue entre Dalton et Wesley, rappelant que bien souvent, l’union fait la force.

Plutôt amusant par sa manière de foncer tête baissée dans les clichés sur fond de rock joué à même la scène du Double Deuce par Jeff Healey, Road House s’avère distrayant à défaut d’être inoubliable. Encore tendre, Patrick Swayze ne fait guère d’étincelles en philosophe du coup de latte, supplanté par une ribambelle de seconds couteaux, Sam Elliott en tête, dont la carrière connaissait un second souffle en jouant des vieux de la vieille cabossés par la vie. Le film connaît une suite tardive en 2005 où l’on apprend non seulement la mort de Dalton mais aussi qu’il a eu un fils, héros de ce Road House 2 exclusivement dédié au marché de la vidéo. Et tout récemment, Amazon Prime a proposé son remake réalisé – mais renié depuis – par Doug Liman avec en vedette Jake Gyllenhaal en ancien combattant de MMA.