Waxwork II – Anthony Hickox
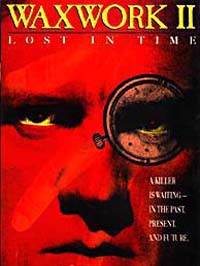 |
Waxwork II : lost in time. 1992Origine : États-Unis
|
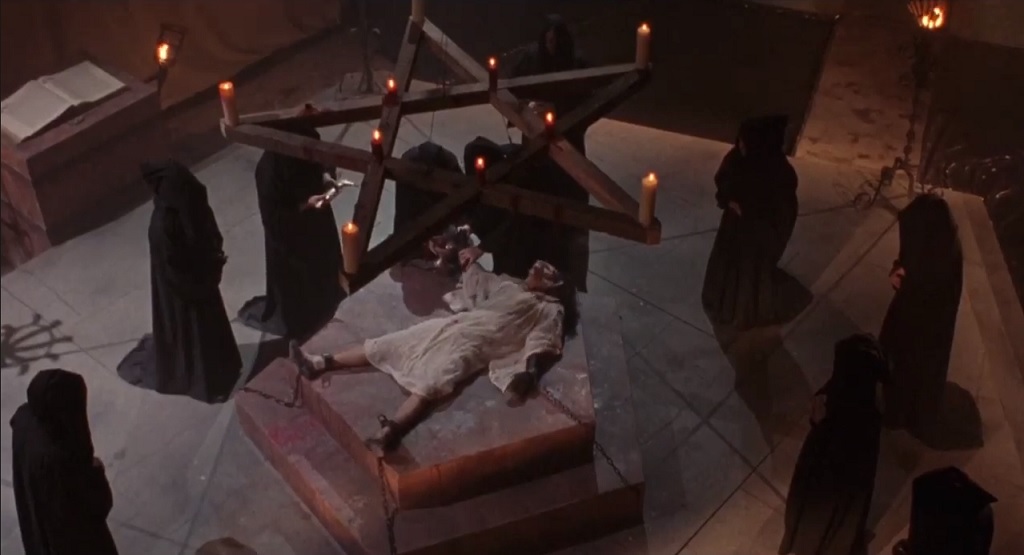
Que font les héros après avoir vaincu tout un tas de monstres mythiques sur le point de conquérir le monde ? Et bien ils rentrent chez eux en taxi et se font engueuler par leur père alcoolique (George “Buck” Flower, fidèle à Hickox) parce que c’est pas une heure pour rentrer. Telle est la malheureuse récompense de Sarah (Monika Schnarre en remplacement de Deborah Foreman), que son copain Mark (Zach Galligan) n’a même pas daigné raccompagner jusqu’à chez elle. Elle n’est cependant pas revenue seule, puisque la main coupée ayant survécu à l’incendie du musée de cire l’a suivi, et s’empresse d’assassiner le papa avant de s’en prendre à Sarah, qui s’en débarrasse dans le broyeur de l’évier. La mauvaise fortune de notre sauveuse du monde ne s’arrête pas là : la justice la pense coupable du meurtre de son paternel, et le juge refuse de croire à son histoire de main tueuse. Laissée en liberté jusqu’à la fin du procès, Mark l’emmène chez feu Sir Wilfred, qui les avait bien aidés au musée. Il leur a laissé une vidéo juste au cas où les choses tourneraient mal, et leur indique la marche à suivre. Mark et Sarah devront donc voyager dans le temps pour ramener un indice susceptible de convaincre la cour.

Et voilà, c’était prévisible : la réussite de Waxwork premier du nom entraîna une séquelle, toujours sous la coupe d’un Anthony Hickox qui entre les deux réalisa Sundown et confirma ses prédispositions au fantastique révérencieux. Mais une séquelle n’est pas forcément un film comme un autre, et, fort de son succès, Hickox dût croire bon d’appuyer lourdement les composantes de son premier film. Si Waxwork n’était pas dénué de défauts, il était en tout cas à l’évidence conçu avec le soucis de ne pas s’attirer les foudres d’un public toujours très pointilleux lorsque l’on utilise ses idoles. Un peu comme si le réalisateur avait manqué de confiance en lui, il se faisait oublier devant les mythes à l’écran et ne reprenait ses droits qu’avec ses personnages à lui. La confiance étant désormais d’actualité, Waxwork II se montre bien moins inhibé que son prédécesseur, et d’un trop grand respect pour les poncifs nous passons ici à la farce généralisée. Le retour dans le temps est en réalité une plongée dans plusieurs genres issus du cinéma fantastique ou de genre, et l’histoire propre à Hickox -la recherche d’une preuve pouvant innocenter Sarah- est d’une débilité toute assumée. Or, la crétinerie volontaire fait bien souvent office d’humour facile, vague prétexte à ne pas se casser la tête à trouver des gags amusants. Waxwork II n’échappe pas à la règle. Le même défaut se retrouve dans tous les films ou genres de films traversés conjointement ou séparément par le couple de héros, et ce en dépit d’un contexte qui ne s’y prête guère. Prenez La Maison du diable, par exemple. Hickox y envoie Mark, passe en noir et blanc, dresse des équivalents aux personnages de Robert Wise, recréé la fameuse scène des bruits dans le couloir et des zooms déformés sur la porte, tout ceci schématisé à l’extrême et réduit sur une très courte période. Il ne peut s’empêcher ensuite de verser dans la gaudriole totale, jonglant avec plusieurs autres films en même temps (Shining, La Maison des damnés…). Cette séquence est d’ailleurs caractérisée par le rôle qu’y tient Bruce Campbell, acteur certes sympathique au demeurant, mais capable de la meilleure excentricité (Evil Dead et sa suite) comme du pire cabotinage (Man with the screaming brain, son propre film). Son apparition ici tient beaucoup plus de la deuxième opportunité, avec sa cage thoracique découverte, ses gémissements et le manque de bol qui caractérise son personnage.

Pris dans la tourmente de cette surenchère, le pauvre Zach Galligan se montre lui aussi sous un jour peu enviable, devant composer avec des répliques primesautières d’une facilité calculée, jouant beaucoup sur l’anachronisme moral (tel “allons leur botter le cul” adressé à des gueux médiévaux). Sa comparse Monika Schnarre est elle d’une fadeur absolue, rien n’étant fait pour lui donner un semblant de relief dans une déferlante qui finit par l’absorber. Même sa séquence à elle, dans laquelle Galligan ne figure pas, ne lui permet pas de se faire remarquer. Et pourtant, il s’agit du décalque de Alien et Aliens, qui lui offre l’opportunité de se mettre dans la peau de Ripley. Hélas, cette partie est atroce, plombée par une mise en scène hasardeuse, un montage bordélique et un monstre mégacéphale franchement laid (à l’image de la plupart des effets spéciaux du film). Hickox s’amuse vraiment en faisant n’importe quoi, déséquilibrant totalement son film dans sa structure même. Si Frankenstein (le premier monde -bâclé- visité par les personnages), La Maison du Diable et Alien (plus les sous-références en leur sein) occupent une majeure partie du film, la part du lion revient à un film de fantasy, difficilement assimilable à un film en particulier. Legend ou Excalibur sont évoqués par défaut, saupoudrés de sorcellerie façon La Pluie du diable. Cette longue excursion dans le film médiéval est certainement la chose la plus moche du film, celle où l’humour se montre le plus poussif et celle où la sous-intrigue (le scénario dans le scénario, plus exactement) patine le plus à vide, quitte à être relancé par des inepties (un corbeau possédé par l’esprit de Sir Wilfred vient porter secours à Mark, prétexte à évoquer le film de Corman). Le temps que prend cette partie aurait été bien mieux exploité si Hickox s’était davantage intéressé aux films entrevus par un duel à l’épée passant d’époque en époque. Le Nosferatu de Murnau (avec Drew Barrymore dans le rôle d’une fille apeurée), L’Invasion des profanateurs de sépultures de Siegel, le Zombie de Romero ou la saga Godzilla passent ainsi en coup de vent, générant des blagues pas toujours très recommandables (voire ouvertement parodiques dans le cas du dinosaure nippon).
Difficile de défendre ce ratage. Hickox s’est certainement cru en terrain conquis, et livre finalement un film beaucoup plus proche de la comédie pour adolescents que du fantastique. L’hommage censé être rendu aux films qui lui sont cher en perd tout son sens. Et dire qu’il s’agit du dernier film de ce vénérable acteur qu’est John Ireland (qui joue le rôle du Roi d’Angleterre dans la cochonceté médiévale)…





