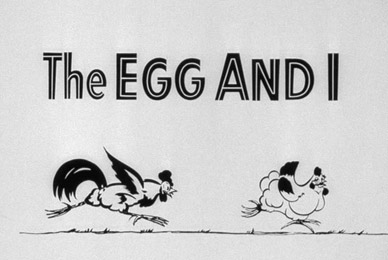Universal City, le royaume des sensations fortes
Je sais que ce dossier pourra paraître incomplet (d’ailleurs, il l’est !). On a tous en tête les films d’épouvante de l’Universal, mais on oublie trop souvent le reste, qui ne constitue pas la moindre partie non moins flatteuse du studio tout en ayant participé à rendre possible l’élaboration de ces classiques du fantastique et de l’horreur, que ce soit dans les années 20, 30 ou 40. Il existe un dossier déjà fait sur le sujet sur des sites de genre.
Aussi j’ai préféré en parler de façon plus globale même si répertorier les films d’épouvante est tentant mais à mon sens très réducteur. Il m’intéressait de parler du contexte dans lequel ces films ont été produits. Souvent grâce à des oeuvres de prestige, parfois encore grâce à un mulet ou au succès d’une comédie musicale sirupeuse qui à ce jour n’a pas forcément laissé grande trace…
C’est à quelques kilomètres seulement d’Hollywood, dans la San Fernando Valley, que fut construit l’un des studios les plus importants de l’histoire du cinéma…
Par le passé, les maisons de production n’avaient rien de ce qu’elles sont par la suite devenues : généralement, de grosses société anonymes. A l’époque, les studios portaient la marque des magnats qui les avaient fondés et qui les dirigeaient. Parmi eux, Carl Laemmle, qui a su acquérir petit à petit son statut d’homme courageux, tenace, honnête et loyal au point de ne jamais trahir sa parole, un trait de caractère plutôt rare aussi bien hier qu’aujourd’hui. L’homme fascinait même assez souvent et représenta même à cette époque, l’archétype de l’homme de spectacle juif, doué d’un remarquable sens des affaires. Ce qui n’empêchait en tout cas pas ses employés, comme la plupart de la populace hollywoodienne, de lui vouer une sincère admiration et de l’appeler même affectueusement « Oncle Carl ».
Fils d’un fermier misérable, Carl Laemmle est né à Lauptheim , en Allemagne. Il eut pas moins de douze frères dont huit périrent alors qu’il était encore enfant. S’ensuivit lors de son adolescence, la perte de sa mère. Le personnage resta pour le reste de sa vie attaché à sa famille et, devenu riche, fit rénover la maison paternelle afin d’y habiter lors de ses réguliers séjours en Allemagne. Durant sa carrière, l’homme eut également tendance à favoriser le népotisme et à certaines périodes même, on pouvait compter pas moins d’une douzaine de Laemmle à l’Universal en plus d’autres noms proches d’un point de vue familial : ainsi, ce que l’on sait moins, c’est qu’il mit les pieds à l’étrier de son neveu, William Wyler, qui deviendra le réalisateur de renommée que l’on sait.
A l’âge de 13 ans, Laemmle commença son parcours professionnel en travaillant chez un papetier avant d’apprendre le métier de comptable. C’est en 1884, âgé à peine de 18 ans qu’il émigre aux États-Unis pour y intégrer différentes entreprises. Dès 1898, il se retrouvait directeur de l’Oshkosh, une filiale de la Continental Clothing Company, dans le Wisconsin.
Les débuts de Universal International
Alors toujours en poste à l’Oshkosh, mécontent de sa rétribution pour les tâches et fonctions qu’il exerçait, Laemmle démissionna et investit ses économies dans un théâtre de Chicago qu’il ne tarda pas à transformer en cinéma. Bien entendu, si cela serait difficilement envisageable à ce jour, à l’époque, il était plutôt aisé de prospérer jusqu’à faire fortune dans ce genre d’affaires. D’ailleurs, Laemmle se retrouva rapidement propriétaire d’une chaîne de salles de cinéma ainsi que d’une société de distribution, la Laemmle Film Service. Trois en plus tard, on lui proposa de s’associer à la Motion Pictures Patents Company, une société récemment formée et qui cherchait à s’assurer le monopole et le contrôle total du secteur. Laemmle n’étant pas homme à accepter les compromis, il choisit, au lieu de s’associer, de devenir concurrent. Afin de fournir des films aux salles boycottées par les producteurs associés, il se mit à en produire lui-même. C’est ainsi que naquit l’IMP (Independant Motion Picture Company), qui lança une vigoureuse campagne au terme de laquelle le monopole cinématographique fut brisé.
C’est après cette lutte acharnée que l’Universal Film Company vit le jour. Elle fut fondée en 1912 à partir de la fusion entre l’IMP, de la Power’s Picture Plays, de la Bison Life Motion Pictures et de plusieurs autres petites compagnies dont la Nestor, la Champion et l’Eclair.
The Dawn of Netta fut le premier bébé cinématographique et put être distribué en 1912. Suivirent bientôt une série d’adaptations de romans classiques comme Robinson Crusoe et Uncle Tom’s Cabin, tous deux en 1913. Puis ce fut au tour de Jane Eyre et The Merchant of Venice, produits en 1914. Mais le premier succès eut lieu un peu avant avec Traffic in Souls (1913), lequel dénonçait la traite des blanches pour un coût dérisoire de quelques milliers de dollars. Le film fut dirigé par J. Loane Tucker et sa petite équipe de techniciens, et tourné en secret, sans que Laemmle (qui n’aimait pas les sujets scabreux) et ses collaborateurs eussent été mis au courant.
Une gestion payante
L’un des principes de base qui dictait le choix économique de Laemmle reposait sur le fait que la publicité paie et que la meilleure stratégie commerciale consiste à vendre des produits de bonne tenue. Dans le studio, on voulait croire également au vedettariat. D’ailleurs, dès l’époque de l’IMP, Laemmle avait confié des rôles à Mary Pickford et avait commencé à faire connaitre les noms des acteurs qui devenaient ainsi, grâce à des campagnes publicitaires bien menées, les chouchous du public. Ainsi certains acteurs ou actrices devenus depuis lors obscurs, tels King Baggot et Florence Lawrence, bénéficièrent largement ce cette politique. Pour cette dernière, Laemmle alla même jusqu’à annoncer sa mort alors que la vedette était bien vivante ! Une pratique pour le moins étonnante sinon même innovante puisque, à l’époque, toutes les autres maisons de production cachaient au contraire jalousement les noms de leurs vedettes afin d’éviter toute revendication salariale de la part des stars.
Dans les films de l’Universal datant du muet, certaines vedettes reviennent régulièrement à l’écran : Annette Kellerman est omniprésente tandis que Wallace Reid campa la première sirène du cinéma ; ailleurs Francis Ford (le frère de John), Harry Carey, Jack Hoxie et Hoot Gibson jouaient des cow-boys tandis que d’autres acteurs étaient plus multitâches. On peut citer en vrac Rudolph Valentino, Conrad Veidt ainsi et surtout Lon Chaney. Ce dernier et le réalisateur Tod Browning, maître de l’horreur et de l’épouvante, travaillèrent principalement pour la MGM, mais le succès des films de Chaney pour l’Universal – dont Notre-Dame de Paris (The Hunchback of Notre Dame, 1923) et Le Fantôme de l’opéra (The Phantom of the Opera, 1925) – eut une influence certaine sur l’orientation de la maison de production vers le cinéma d’épouvante.
C’est peut-être en souvenir de ses origines germaniques que Laemmle fit dès l’époque du muet confiance à deux réalisateurs européens, lesquels devaient jouer plus tard un rôle important à l’Universal. Il reste clair encore à ce jour que la sympathie du boss pour les immigrants européens pesa dans la décision de ce dernier d’aider Erich Von Stroheim à mener à bien son premier film, La Loi des montagnes (Blind Husbands, 1919). Fort du succès que fit le film, Stroheim put en réaliser un second, Le Passe-partout du diable (The Devil’s Passkey, 1920). Lorsque le coût d’un autre film de Stroheim, Folies de femmes (Foolish Wives, 1922) atteignit des chiffres astronomiques, Laemmle, avec beaucoup d’à-propos, sut en tirer avantage. Le montant des dépenses engagées pour le film (elles avaient ruiné la maison de production) devint un atout publicitaire. Cependant, Irving G. Thalberg, le jeune directeur de production (vingt-deux ans à l’époque) récemment engagé par Laemmle fut moins indulgent. Il confia la fin du film à Rupert Julian, qui s’occupa aussi du montage. Chevaux de bois (Merry-Go-Round), le dernier film que Stroheim réalisa pour l’Universal en 1923, fut également achevé par un autre metteur en scène.
Un autre européen de talent, Paul Leni, réalisa pour l’Universal, trois excellents films d’épouvante, avec L’Homme qui rit (The Man Who Laughs), sorti en 1928 et interprété par le grand acteur allemand Conrad Veidt, ce après La Volonté du mort (The Cat and the Canary, 1927) et Le Perroquet chinois (The Chinese Parrot, 1927). Leni acheva ce film peu avant une mort prématurée. En vérité, pour connaître le succès à l’intérieur des studios Universal, être parent de Laemmle ou d’origine européenne n’était pas suffisant. Laemmle semblait, avec le flair qui le caractérisait, savoir donner leur chance à ceux qui la méritaient. C’est d’ailleurs ainsi que le cascadeur John Ford passa à la réalisation… Le même Laemmle l’avait fort bien jugé : « Ford ? Mettez-le à la réalisation. C’est celui qui gueule le plus. » En outre, l’Universal fut l’un des premiers studios à confier la réalisation de films à des femmes. Pour mémoire, citons les noms de Loïs Weber, Clep Madison ou encore Ida May Park.
Un cinéma parlant expressif
C’est triomphalement que l’Universal entra dans l’ère du sonore en produisant une série de comédies musicales : dès 1929 sortirent Show Boat (dont James Whale fit un remake en 1936) et Broadway, puis, en 1930, La Féérie du jazz (King of Jazz), dont une partie était même en couleur. Ceci étant, la production la plus prestigieuse de cette époque fut A l’ouest rien de nouveau (All Quiet on the Western Front) qui sortit donc en 1930. Ce qui pouvait s’apparenter à un geste altruiste de la part de Laemmle, qui finança ce film coûteux (il alla même jusqu’à envoyer aux cinémathèques les plus connues des copies du film dans des containers scellés et dorés), était plus vraisemblablement motivé par son désir de recevoir le prix Nobel de la paix. Durant les années 20, Laemmle avait œuvré de manière infatigable pour aider l’Allemagne à sortir de la crise économique, et en 1930, l’écrivain anglais John Drinken s’était déclaré prêt à soutenir sa candidature au fameux prix, qu’il aurait éventuellement partagé avec Erich Maria Remarque et Lewis Milestone, respectivement auteur du roman original et réalisateur du film. Pourtant certainement attendu par Laemmle, celui-ci n’obtint pourtant pas la distinction briguée.
Au début des années 30, l’Universal se consacra alors à un nouveau cycle de films d’épouvante, grâce, en grande partie à la base, au réalisateur d’origine britannique James Whale et à la découverte de deux acteurs dont les noms restent encore à ce jour indissociables du genre : Bela Lugosi et Boris Karloff.
Citons parmi les plus belles réussites maison : Frankenstein (1931), La Maison de la mort (The Old Dark House, 1932), L’Homme invisible (The Invisible Man, 1933) ou encore La Fiancée de Frankenstein (Bride of Frankenstein, 1935).
Parallèlement aux films d’épouvante, Universal produisit une importante série de drames sentimentaux dont les meilleurs furent incontestablement ceux de John Stahl, avec notamment Back Street (1932) et Le Secret magnifique (Magnificent Obsession, 1935), interprétés tous deux par Irène Dunne, ainsi qu’Une nuit seulement (Only Yesterday, 1933) avec Margaret Sullavan, et Les Images de la vie (Imitation of Life, 1934) avec Claudette Colbert. A ce propos, on signalera que durant les années 50, le studio réalisa d’appréciables bénéfices en produisant des remakes de certains films de Stahl, dont la réalisation fut confiée à un autre talentueux réalisateur : Douglas Sirk.
A partir de 1930, la direction générale passa à Carl Laemmle Jr. Malgré le succès de A l’ouest rien de nouveau et de La Féérie du Jazz, il ne réussit pas à atteindre la notoriété du paternel (dont le style personnel et l’individualisme farouche n’étaient plus compatibles avec les nouvelles exigences de rentabilité). En 1936, alors que l’Universal amorçait son déclin, Laemmle père et fils quittent la société.
La nouvelle gestion, avec à sa tête Charles Cochrane, fut tout d’abord plutôt désastreuse. De tous les films produits par le studio en 1936, un seul fut un succès : My Man Godfrey. Mais le destin allait encore se montrer favorable à l’Universal. Deanna Durbin, qui n’avait pas réussi à intéresser la MGM, arriva comme un don du ciel. Elle contribua à éponger les dettes de la maison de production grâce aux recettes de Trois jeunes filles à la page (Three Smart Girls, 1937). Durant les sept années qu’elle passa à l’Universal, Deanna Durbin interpréta plusieurs comédies musicales qui connurent un grand succès. Durbin passa ensuite à la MGM mais sa carrière ne tarda pas à décliner.
La dépendance au box-office
Au début des années 40, l’Universal trouva son salut dans le comique. Elle produisit une série de films de W.C. Fields et engagea les comiques Abbott et Costello, qui ne brillaient pas forcément par la subtilité mais qui jouissaient d’une immense popularité. A l’époque, l’Universal avait beaucoup perdu de son prestige et se contentait de lancer des productions peu coûteuses : films d’épouvante souvent interprétés par Lon Chaney Jr. ou Boris Karloff ; films exotiques dans lesquels on retrouvait généralement Maria Montez, Yvonne De Carlo et Jon Hall ; westerns tournés à l’économie sur les plateaux d’Universal City.
Parfois, les acteurs attirés de ces genres bien différents se retrouvaient au même générique ; il en fut ainsi pour Bela Lugosi et Lon Chaney Jr. qu’on vit ensemble dans Frankenstein et le monstre (Frankenstein Meets the Wolf Man, 1943), et, avec les deux grands comiques maison dans Deux nigauds contre Frankenstein (Abbott and Costello Meet Frankenstein, 1948).
A la fin des années 40, deux nouvelles séries furent mises en chantier pour répondre aux besoins de la double programmation. La première présentait les personnages de Maman et Papa Kettle, ainsi que leur famille, dans toute une série de films dérivant de L’Oeuf et moi (The Egg and I, 1947), adapté du roman autobiographique de Betty MacDonald. La deuxième utilisait une vedette bien particulière, un mulet parlant. Cette étrange star permit au studio d’équilibrer son budget.
L’Universal et des oeuvres de prestiges
A côté de ce flot de productions économiques, le studio s’efforçait cependant de mettre sur pied quelques oeuvres de prestige : Lettre à une inconnue (Letter from an Unknown Woman), réalisé en 1948 par Max Ophuls, Cinquième colonne (Saboteur, 1942) et L’Ombre d’un doute (Shadow of a Doubt, 1943), deux films d’Alfred Hitchcock. Celui-ci allait d’ailleurs devenir le principal actionnaire de l’Universal International, la compagnie se chargeant pour sa part de la distribution de tous ses films. Les autres œuvres importantes produites par l’Universal dans les années 40 furent La Rue rouge (Scarlet Street, 1945) de Fritz Lang, La Double énigme (The Dark Mirror) et Les Tueurs (The Killers), deux films réalisés en 1946 par Robert Siodmak ; puis La Cité des voiles (The Naked City, 1948) de Jules Dassin.
Pendant toute cette période, la maison de production dut faire face à de multiples changements. L’année 1946 fut celle de sa fusion avec l’International Pictures, d’où sortit l’Universal International. La même année, la maison de production anglaise Rank avait acquis des actions Universal. Celles-ci furent rachetées en 1951 par la Decca, qui allait fusionner dix ans plus tard avec la MCA (Music Corporation of America).
Une volonté de grandeur
Le développement de la télévision dans les années 50 marqua le déclin des films de série B et des doubles programmations dans les salles de cinéma. L »Universal se tourna alors vers une production plus ambitieuse, notamment avec les grandes reconstitutions historiques, souvent assez fantaisistes d’ailleurs, dans lesquelles elle exploita le talent d’une star de l’écran qui allait exploser : Tony Curtis. L’intérêt de la compagnie pour le cinéma en relief donna lieu à toute une série de films de science-fiction, dont les meilleurs furent Le Météore de la nuit (It Came from Outer Space, 1953) et L’Étrange créature du lac noir (Creature from the Black Lagoon, 1954), tous deux réalisés par Jack Arnold.
Vers la fin des années 50 et durant les années 60, l’Universal continua à connaître le succès grâce à ses vedettes. De bonnes comédies eurent pour interprètes Doris Day, Rock Hudson, James Garner et Cary Grant. Audie Murphy devint la star de ses westerns tandis que Kirk Douglas excellait dans ses interprétations dramatiques.
A partir de 1970, l’Universal International, qui s’était entre temps associée à la CIC, entra dans l’ère des superproductions. Les budgets de plus en plus élevés et les recettes phénoménales d’Airport (1970), de L’Arnaque (The Sting, 1973), de Tremblement de terre (Earthquake, 1974), des Dents de la mer (Jaws, 1975) et des Dents de la mer 2 (Jaws 2, 1978), ont presque effacé dans les mémoires le souvenir des modestes bobines que Laemmle produisait au beau temps de l’IMP et les champêtres aventures de Maman et Papa Kettle. Adieu aussi la flopée de beaux films d’épouvante et ses galeries de monstres, jadis faits avec peu de moyens mais aussi avec une imagination fertile.
La suite faisant davantage partie d’une nouvelle donne économique mondiale, le studio, à l’instar de ses frères et cousins, s’est mis à l’ère du blockbuster. Une nouvelle ère qu’il convient de traiter à part, et qui fera peut-être l’objet d’une seconde partie, même si celle-ci inspire moins de prime abord l’auteur de ce dossier générique…