La Planète des singes : les origines – Rupert Wyatt
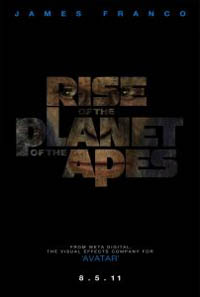 |
Rise of the Planet of the Apes. 2011.Origine : États-Unis
|

Will Rodman, brillant scientifique, travaille à un traitement pour guérir la maladie d’Alzheimer. Alors qu’il pense avoir abouti, et qu’il présente son remède miracle devant un parterre d’actionnaires, la femelle chimpanzé sur laquelle il a procédé au test de son sérum s’échappe de sa cage, terrorise tout l’étage pour finir par perturber sa présentation et être abattue sous ses yeux par des agents de la sécurité. Cet événement porte un rude coup au projet, annulé sur le champ. Will accuse le coup, d’autant plus lorsqu’il apprend que l’accès de colère du singe n’était pas lié au traitement mais tout simplement au fait qu’elle protégeait son petit. Alors que tous les singes lui ayant servi de cobayes sont abattus, il sauve la vie du jeune chimpanzé en l’adoptant. Baptisé César, ce dernier ne tard pas à présenter des signes d’une intelligence rare. Visiblement, le sérum lui a été transmis génétiquement par sa mère et, lorsqu’il n’a pas de cellules malades à reconstituer, il développe les aptitudes intellectuelles du sujet de manière exponentielle. Face à cette découverte, Will reprend espoir et poursuit ses recherches en secret, ne percevant pas qu’en grandissant, César vit de plus en plus mal sa condition d’animal de compagnie.

En dépit de recettes honorables récoltées de par le monde, La Planète des singes version Tim Burton n’a curieusement engendré aucune suite. Compte tenu des nombreuses années qui furent nécessaires pour que le projet aboutisse enfin, on pouvait s’attendre à ce que les producteurs de ce remake soient plutôt enclins à tirer sur la corde. Or, les faibles retours positifs sur le film ont apparemment refroidi toutes leurs velléités mercantiles. Cependant, dans un contexte où le remake, le reboot (reprise d’une franchise à zéro) et le reboot de remake constituent la colonne vertébrale des productions issues des majors hollywoodiennes, la saga initiée par Arthur P. Jacobs, en sa qualité d’œuvre phare du cinéma fantastique, ne pouvait décemment laisser plus longtemps les producteurs indifférents. Dès le départ, il ne fut pas question de se lancer dans une troisième adaptation du roman de Pierre Boulle, les producteurs souhaitant davantage revenir aux sources même du mythe à partir du personnage de César. De fait, le film se présente comme un mélange inédit de remake et de reboot puisque tout en repartant de zéro, La Planète des singes : les origines reprend les grandes lignes de La Conquête de la planète des singes, quatrième épisode de la saga et le plus à même de fournir les bases d’une nouvelle franchise. Toutefois, le jeune réalisateur Rupert Wyatt (un film à son actif au moment du tournage, le direct-to-video Ultime évasion) ne souhaite pas en épouser la teneur sociale. A cela deux raisons : la première émane de la volonté de ne pas calquer bêtement son film sur celui de Jack Lee Thompson ; et la seconde tient au fait qu’il s’agit là avant tout d’un blockbuster –ce que les autres films de la saga n’ont jamais été, à l’exception de La Planète des singes– et qu’il convient donc de brosser le public dans le sens du poil. Résultat, on se retrouve face à un film au sous texte plus consensuel et bien dans l’air du temps, se résumant à dénoncer les tortures infligées aux animaux dans les laboratoires. Néanmoins, La Planète des singes : les origines s’avère un blockbuster à part par sa volonté constante de privilégier les aspects émotionnels de son intrigue au détriment du spectacle pur, quitte à procéder à des choix frustrants pour le spectateur, au sommet desquels trône la relégation de la propagation de l’épidémie décimant les humains en arrière-plan du générique de fin. Un choix qui s’avère d’autant plus risqué qu’il repose essentiellement sur les prouesses techniques dues à la performance capture, procédé préféré aux simples effets de maquillages pour personnaliser les singes. Avatar et son incroyable succès sont passés par là, validant à la fois le choix de cette technique de pointe et de ce sous texte opportunément fédérateur.

Dès la première scène –une brave famille de chimpanzés prise en chasse par des braconniers–, le film révèle sa note d’intention : nous placer d’emblée du côté des singes. Et pour cela, Rupert Wyatt ne lésine pas sur les plans tire larmes. Des scènes comme le gros plan sur le chimpanzé aux yeux qu’on devine humides en voyant ses congénères se faire embarquer à bord d’une jeep, ou encore l’exécution de la mère de César abondent en ce sens. Davantage que la saga originale, dont les singes marquaient un stade d’évolution inédit, cette nouvelle mouture joue pleinement la carte de l’anthropomorphisme. Le jeu consiste à progressivement faire affleurer la part d’humanité naissante chez César pour mieux rendre horrible les situations auxquelles il se retrouve confronté. A ce titre, un soin tout particulier a été apporté aux expressions de son visage, captés à même la peau de Andy Serkis, son interprète et spécialiste en incarnation virtuelle. Pour bluffant qu’il soit, le résultat n’en apparaît pas moins dans toute son artificialité. La modélisation des mouvements captés sur l’acteur puis retranscrits sur ordinateur fait office de filtre entre la performance du comédien en plateau et le résultat à l’écran. En somme, au vu des images, on pense davantage aux prouesses technologiques qu’au travail de l’acteur. Mais revenons-en à son personnage qui d’animal de compagnie fidèle et affectueux au départ, passe par différents stades à mesure que les années défilent et que son corps –et son cerveau !– se développent. César prend ainsi conscience de sa captivité, même si au sein d’un cocon empli d’amour, et commence à poser des questions à son maître –via le langage des signes– comme tout enfant le ferait auprès de son père, du genre « qui suis-je ? » ; « d’où viens-je ? »… En dépit de ces questionnements, la vie suit son cours jusqu’au point de rupture, la résurgence de son animalité à l’encontre de l’inamicale voisin, coupable de s’en prendre violemment à Charles Rodman, le père de son maître. Répondant à un stimulus bien naturel, la défense d’un être aimé, César laisse son instinct animal prendre le dessus sur ses bonnes manières, le révélant dans toute sa férocité (et on le comprend, ledit voisin étant interprété par le toujours aussi exécrable David Hewlett !). Détail amusant, César n’apparaîtra plus sous ce jour peu flatteur de bête en furie capable d’écharper quiconque se dresse devant lui, même lorsqu’il mènera les singes à la révolte. Produit familial oblige, La Planète des singes : les origines s’en voudrait de donner dans l’imagerie barbare, limitant les morts aux personnages qui le méritent vraiment, autrement dit les méchants hautement identifiables tels Steven Jacobs, le directeur du laboratoire à l’origine des nombreuses expériences sur animaux ; ou Dodge Landon, l’horrible maton du refuge pour singes.

De manière générale, les humains ne sont guère pris en considération, à l’image d’un Will Rodman bien fade. Pourtant, lui aussi joue à son niveau sur la fibre émotionnelle, ses recherches étant motivées par son père, souffrant d’Alzheimer. Et c’est parce que ses recherches partaient d’un bon sentiment qu’il bénéficie de la magnanimité d’un César au plus fort de la révolte. Seulement le personnage ne parvient jamais à exister pour autre chose que son rôle dans la mise en place du processus aboutissant à la rébellion simiesque, se faisant allégrement voler la vedette, et par César (normal, c’est le vrai héros du film), et par son père (le trop rare John Lithgow, ici tout en retenue). C’est bien simple, une fois son père décédé, son personnage tend à disparaître totalement, tellement inutile au récit qu’il se retrouve en marge du clou du spectacle, la traversée du Golden bridge par des hordes de singes assoiffés de liberté. Et ce n’est pas son idylle avec la vétérinaire Caroline Aranha, totalement accessoire, qui contribue à changer la donne. On dirait que dans ces productions hollywoodiennes, le cahier des charges exige que le personnage principal ait une idylle, quand bien même les scénaristes se montrent incapables de les développer de manière satisfaisante. D’ailleurs, si on se fie à la bande-annonce du film, une autre idylle aurait dû être développée, concernant César et une compagne d’infortune. Sa disparition pure et simple du montage final témoigne de l’impasse du film sur le terrain des sentiments amoureux. Et ce n’est pas seulement sur ce point que les scénaristes se sont montrés maladroits, le film regorgeant de détails saugrenus, dont le plus flagrant demeure sans conteste la grossesse du chimpanzé femelle puis la naissance de son petit -le futur César- passées totalement inaperçues aux yeux du personnel scientifique.

Sans surprise, cette Planète des singes : les origines apparaît dans toute son insignifiance, produit ultra calibré pour plaire au plus grand nombre et redonner du lustre à une franchise délaissée. Le film n’est pas désagréable à suivre mais irrite constamment par sa volonté de ne pas exploiter pleinement son sujet, se bornant à un survol gentillet des événements. Il est ainsi difficile à avaler de voir l’épidémie reléguée au rang d’épiphénomène. Et en vue d’une inévitable séquelle, le film dissémine quelques pistes à suivre, notamment dans la caractérisation de cet autre chimpanzé au faciès patibulaire et à la mèche blanche caractéristique, dont l’évidente dureté le prédispose à s’ériger en double maléfique de César.





