Witchtrap – Kevin Tenney
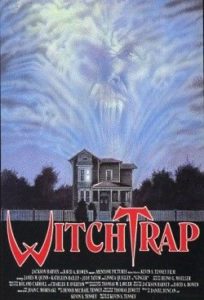 |
Witchtrap. 1989.Origine : États-Unis
|

Qu’ont en commun Ouija et Night of the Demons, les deux premiers longs métrages de Kevin Tenney ? Et bien de traiter tous les deux de paranormal, et plus spécialement de spiritisme qui tourne mal. Mais les deux le font de différentes manières : là où le premier se bornait à une classique histoire de possession graduelle, le second suivait (avec panache !) les traces d’Evil Dead en jouant la carte du malsain et du gore. Les deux films ont connu un succès mérité, et Kevin Tenney d’aborder son troisième film sous un même angle paranormal, là encore à base d’invocations, et avec un casting mêlant allègrement les acteurs auxquels il a déjà eu recours : la tête d’affiche James W. Quinn était dans ses deux premiers films, Judy Tatum et J.P. Luebsen étaient dans Ouija, Linnea Quigley et Hal Halvins dans Night of the Demons et deux autres encore proviennent de Book of Joe, le court-métrage par lequel il inaugura sa carrière. De quoi se demander pourquoi Tenney n’a pas directement réalisé la séquelle de l’un de ses deux films, d’autant qu’un titre comme Witchtrap -donné par le distributeur- sonne diablement comme Witchboard (titre en VO de Ouija) ? Et bien tout simplement car le réalisateur a choisi d’innover en remplaçant les invocations inconsidérées entre post-adolescents par celles, moins gaudriolesques, d’un sataniste revendiqué.

Joué par un Kevin Tenney qui pallie à une absence imprévue, Devon Lauder est bien embêté avec le manoir qu’il a hérité de son aïeul Avery, un sorcier notoire interrompu par la police en plein rituel sataniste. Selon les dispositions testamentaires, il ne peut ni vendre ni détruire la bâtisse et il ne souhaite pas l’habiter non plus puisque le fantôme d’Avery hante les lieux. Le tourisme paranormal a un temps été envisagé, mais la mort d’un locataire dans de mystérieuses circonstances constitue un fâcheux précédent qu’il ne faudrait pas répéter. C’est pourquoi Lauder embauche une petite équipe d’experts pour tenter d’exorciser les lieux sous la protection de trois agents de sécurité dûment assermentés.

Il est donc fini le temps où le mal surgissait sans crier gare et sanctionnait l’inconscience de personnages non préparés à ça. Ici, l’engeance diabolique est toute désignée et a pour nom Avery Lauder. Quant à ses ennemis, il sont venus l’affronter sur son propre terrain en toute connaissance de cause. Cela n’a pas l’air, mais ce changement fait de Witchtrap un film assez différent des deux autres. Potentiellement plus adulte, il évoque illico La Maison des damnés de John Hough (adaptée d’un roman de Richard Matheson) dont il reprend non seulement le point de départ -une équipe de parapsychologues envoyée dans une maison de sinistre réputation- mais également des caractéristiques par lesquelles le film de Hough se démarquait de son propre modèle, La Maison du diable de Robert Wise (d’après Shirley Jackson). Nous y retrouvons donc notamment les deux clans opposés de médiums : d’un côté le couple Agnes et Felix Goldberg fait écho aux époux Barrett non seulement par leur statut marital mais également parce qu’ils revendiquent une conception « paraphysique » de la hantise, considérant que celle-ci est due à des phénomènes scientifiques encore inexpliqués (électromagnétisme dans le cas des Goldberg). Le binôme se propose notamment d’exorciser la maison hantée par le biais d’une machine de son cru spécialement conçue à cette fin. Dans un cas comme dans l’autre, ces duos font figure de meneurs, opposés à la vision bien plus métaphysique de l’autre camp de médiums : Florence Tanner et Benjamin Fischer dans La Maison des damnés, réunit dans l’unique personnage de Whitney O’Shay dans Witchtrap. Pour elle et à l’instar du personnage de Roddy McDowall, l’ennemi est bien trop puissant et ne fera qu’écraser l’opposition. Dans le même temps, et cette fois comme sa devancière Pamela Franklin, elle est le moyen physique par lequel se manifeste l’entité maléfique. Bien identifiée, celle-ci avait pour nom Emeric Belasco en 1973 et s’appelle Avery Lauder en 1989. Un sadique orgiaque dans l’un, et un sataniste en quête d’immortalité dans l’autre.

Même si ses deux premiers films étaient des réussites -et même éclatante dans le cas de Night of the Demons-, l’originalité n’était pas leur fort. Le réalisateur s’en sortait par son sens de la mise en scène, par sa gestion du rythme et par sa capacité à comprendre les attentes d’un public exigeant. Le voir basculer dans le genre très balisé de la « maison hantée » sous l’excellente tutelle du film de John Hough laissait donc augurer du meilleur. Et pourtant, dès le départ, alors que se posent les mêmes ressorts que dans La Maison des damnés, plusieurs éléments clochent. Au premier chef, la présence du trio d’agents de sécurité qui vient rompre le sérieux de l’entreprise en nous faisant sortir de l’isolement dans lequel les personnages et spectateurs de La Maison des damnés étaient plongés. Le paranormal ne faisait alors aucun doute, tous les protagonistes en étaient convaincus, et la maison elle-même nous immergeait par le simple fait qu’elle soit murée. Ici, les trois « intrus » prennent les choses à la rigolade, à commencer par celui qui hélas deviendra ensuite le héros du film : Tony Vincente, un ex-grand nom du LAPD renvoyé pour ses insubordinations répétées. Un flic dur à cuire à la répartie cynique et qui ne cache pas son scepticisme pour l’affaire dans laquelle il est plongé. Ainsi fait-il remarquer que Bill Murray serait plus à sa place que lui dans cette chasse aux fantômes. Ou encore, à ce médium percevant que quelque chose se cache derrière le rideau, rétorque-t-il « probablement une fenêtre »… Dans le genre casseur d’ambiance, Vincente se pose là. Plus tard, alors que la réalité du paranormal s’impose de plus en plus à ses yeux, il continue à décrédibiliser l’intrigue en lui donnant une patine typiquement années 80 en se faisant l’homme d’action du groupe. Le fort de La Maison des damnés était non seulement de ne jamais céder à l’humour pour ne pas parasiter sa dimension paranormale, mais aussi de ne jamais donner l’impression qu’un « héros » pouvait émerger en cassant la gueule au mal et en sauvant ses camarades. C’est ce que Vincente fait ici, avec pour corolaire de nous sortir brutalement de la fameuse « suspension d’incrédulité » par laquelle nous pouvions croire aux manifestations impalpables.

Mais s’il est l’élément le plus symptomatique d’une propension rédhibitoire au hors-sujet, il n’est pas le seul à sonner faux. Ses comparses l’épaulent bien dans sa quête : entre un patron passant son temps à essayer de faire valoir son autorité et un collègue qui n’a pour autre ambition que de déculotter la vidéaste embarquée par les Goldberg (deux personnages qui par leur vacuité sont d’emblée promis au rôle de victimes expiatoires), l’attention des spectateurs est pour le moins détournée des préoccupations paranormales. Du reste, les médiums eux-mêmes y contribuent. Déjà en apportant avec eux Linnea Quigley, dont la simple présence (outre qu’elle met en rut l’ami de Vincente) est la promesse d’une scène de nudité à laquelle nous ne couperons pas, et ceci avec une gratuité purement commerciale (Night of the Demons réussissait à l’incorporer bien plus harmonieusement), et d’autre part parce que, somme toute, leurs investigations ne sont pas poussées bien loin et pèchent par un manque de sérieux. De l’hurluberlu binoclard servant de médium (Felix Goldberg) à la boucle musicale wagnerienne balancée à chaque fois que la médium Whitney O’Shay convulse sous l’influence d’une possession imminente (c’est à dire un peu n’importe quand pour éviter les temps morts), Tenney fait tout ce qu’il ne devrait pas faire. Il pousse même le vice jusqu’à faire baigner son manoir -assez quelconque dans son allure- dans une luminosité guère adaptée. Pour une large part, le film se déroule ainsi en plein jour, ce qui n’aide pas à la création d’atmosphère propice. Par ailleurs, il s’éloigne de la complexité de La Maison des damnés en se focalisant bien trop sur la figure de Avery Lauder. Sous la caméra de John Hough, Emeric Balasco était sans nul doute le chef d’orchestre des poltergeists, mais une part de mystère demeurait du fait de la présence supposée d’esprits secondaires et trompeurs. Ici, aucune ambiguïté : Lauder est le seul et unique responsable. La caméra du personnage de Quigley réussit d’ailleurs à filmer sa présence. Le sataniste fantôme est donc ravalé au rang d’ennemi certes invisible mais bien palpable. Tellement palpable que les manifestations de sa présence (se réduisant bien trop souvent aux seules mises à mort) ne sont pas foncièrement différentes de celle d’un tueur bien matériel façon Jason Voorhees. Du reste, les vigiles les interprètent comme telles en les attribuant au jardinier, ancien serviteur d’Avery Lauder qui constitue la seule ambiguïté de cette affaire de fantôme. Ou quand le slasher fait intrusion dans la maison hantée, cela ne fait pas bon ménage.

En bref, petit à petit, Witchtrap se délite jusqu’à ne plus être qu’une tuerie d’ordre surnaturel sans aucune autre plus value que celle d’effets spéciaux réussis et parfois assez gores (et encore, Kenney s’est restreint pour ne pas brusquer le comité de censure). On a certes vu bien pire dans le style : au moins le film évite de tomber dans la léthargie et dans l’amateurisme flagrant. Mais compte tenu des promesses affichées par le réalisateur dans ses deux premiers films, il y a de quoi se montrer fortement déçu par le conformisme de l’ensemble. Rien n’y est exploité : ni la maison hantée, ni le satanisme, ni les théories paranormales, tout cela cédant le pas à un écrémage du casting convenu dans la forme comme dans le fond, jusqu’à un final frappé du sceau du rebondissement facile, de l’effet spécial complaisant et de la solennité inappropriée. De quoi marquer un sévère coup d’arrêt aux espérances concernant un réalisateur qui en deux films avait su faire très bonne impression.





