Mean Streets – Martin Scorsese
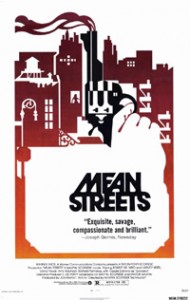 |
Mean Streets. 1973Origine : États-Unis
|

Repéré par Roger Corman suite à Who’s That Knocking at My Door, Martin Scorsese eut l’occasion de sortir du documentaire grâce à Bertha Boxcar, qui ne devait être que la séquelle du Bloody Mama réalisé par Corman lui-même. D’un film de commande, Scorsese réussit à faire une œuvre plus personnelle, réécrivant le scénario tout en étant capable de répondre aux exigences techniques et commerciales de son producteur, non sans par ailleurs apprendre beaucoup de ses conseils. Visionnaire comme pas deux, Corman remarqua au passage le talent de son nouveau poulain et le défendit contre vents et marées face aux distributeurs de l’American International Pictures, dont les nouveaux chefs demandaient le renvoi pur et simple. Corman obtint gain de cause et Scorsese put terminer Bertha Boxcar. Mais, sans rancœur aucune, le réalisateur se sentait déjà à l’étroit sous la tutelle de son producteur. Comme le ressentit aussi John Cassavetes dont l’influence allait s’avérer encore plus importante que celle de Corman, il était déjà mûr pour une grande carrière. Restait toutefois à convaincre quelqu’un de financer son projet personnel, Mean Streets. Corman l’aurait bien fait, mais il demandait en échange à ce que les personnages deviennent des afro-américains, ce qui lui aurait permis à la fois de s’illustrer dans la toute fraîche blaxploitation et d’adopter une thématique anti-raciste qui a toujours été un sujet prisé de Roger Corman, qu’il soit réalisateur (The Intruder) ou producteur (Bertha Boxcar, justement). Bien que ce n’aurait pas été l’idéal pour un film reposant sur du vécu, Scorsese aurait pu accéder à cette demande si Jonathan Taplin, le manager du groupe The Band tout juste sorti de son association avec Bob Dylan ne lui avait fourni le budget nécessaire. C’en était fini de l’association Corman / Scorsese qui n’aura donc duré officiellement que le temps d’un film. Elle fut en tout cas suffisante pour que le réalisateur ait acquis une expérience qui lui sera toujours de grand secours (il invoque la méthode Corman pour les tournages de After Hours et de La Dernière tentation du Christ) et pour qu’il embarque avec lui le production manager Paul Rapp ainsi que David Carradine, lui aussi présent sur Bertha Boxcar, et -grâce à Keitel- Robert De Niro, un des acteurs du Bloody Mama de Corman.

Dans les rues de Little Italy, à New York, Charlie (Harvey Keitel) est un jeune homme tiraillé entre sa foi catholique et ses activités mafieuses. Employé par son oncle Giovanni, pour lequel il s’occupe de recouvrer des dettes, ce qui risque de le propulser sous peu à la tête d’un restaurant dont le patron est en rupture de paiement, il s’est pourtant préservé un espace personnel qu’il tente de gérer tant bien que mal. Ainsi, il jongle constamment entre sa liaison secrète avec Teresa (Amy Robinson), la cousine épileptique de son ami Johnny, tout en essayant de pousser ce dernier à payer ses nombreuses dettes, au risque de nuire à sa propre réputation.
A l’instar d’American Graffiti de George Lucas, Mean Streets est l’une des œuvres phares du nouveau cinéma américain. Initiée par le précurseur John Cassavetes notamment lors de son premier film, Shadows, en 1959, cette nouvelle vague faisant écho à sa consœur française se distingue par son refus des canons techniques et narratifs et par une subordination des intrigues aux désirs des cinéastes. Une sorte d’équivalent cinématographique de ce que la Beat Generation fut à la littérature. Cette appropriation du médium cinématographique met en exergue un ressenti personnel, et il est de fait logique que les réalisateurs s’inspirent de leur propre vie. Œuvres de réalisateurs quasi-débutants, American Graffiti tout comme Mean Streets, mettent logiquement la jeunesse de Lucas et de Scorsese au premier plan. Le but est moins l’autobiographie que la vision subjective d’époques qui, réussite aidant (car des réalisateurs plus mauvais s’y seraient certainement cassés les dents) ont ainsi pu faire office de manifeste pour ceux qui y ont grandi. Cependant, si Lucas a à peu près tout dit de sa jeunesse insouciante avec American Graffiti, dans laquelle se retrouveront le plus grand nombre, Scorsese, l’italo américain de New York, ne fait qu’entamer une longue histoire cinématographique avec sa ville, qu’il a a depuis à peu près traitée sous tous les angles. C’est qu’il y en a à dire sur la grosse pomme, porte d’entrée de l’Amérique des immigrants, symbole à la fois de la liberté et du banditisme, du cosmopolitisme et de la pauvreté, du spectacle et de la décadence. Une ambivalence que l’on retrouve dans Mean Streets, film dont le personnage principal hérite à la fois d’une morale toute chrétienne et d’un penchant certain pour les combines qui aspirent les jeunes comme lui vers la délinquance et, surtout lorsque l’on a un oncle dans le milieu, la mafia. Pour l’aspect religieux, Scorsese a mis beaucoup de lui-même dans le personnage, chose qu’il avait déjà faite dans Who’s That Knocking at My Door, dans lequel la foi jouait un rôle prépondérant. Elle aurait pu occuper la même place dans Mean Streets, comme le laissait suggérer le retour d’Harvey Keitel, déjà tête d’affiche de Who’s that…, mais Scorsese a finalement opté pour une approche un peu plus large.

“On ne rachète pas ses péchés à l’Église, on le fait dans la rue, chez soi“. C’est par cette phrase prononcée par Scorsese que démarre Mean Streets avant d’embrayer sur un générique où un super-8 familial défile sur fond du gentillet “Be my Baby” des Ronettes puis sur un plan montrant Charlie à l’église et parvenant à la conclusion énoncée. De là à dire que tout Mean Streets n’est que l’illustration de cette maxime, il n’y a qu’un pas. Il n’est pas non plus interdit de penser que le pré-générique et le générique sont en fait la conclusion du film, bouclant la boucle d’un scénario qui n’aura définitivement pas été linéaire. Comme dans American Graffiti, et il s’agit d’une récurrence du nouveau cinéma américain, les personnages n’ont pas à aller d’un point A à un point B. Il n’y a pas vraiment d’histoire, mais plus une tranche de vie dans laquelle les personnages, et au premier rang desquels Charlie, ont certes à affronter des épreuves (persuader Johnny de régler ses dettes, trouver une issue à la relation précaire avec Teresa…) mais ce n’est pas tant leur conclusion que la façon de les affronter qui intéresse Scorsese. Ainsi, pour racheter des péchés bien réels, car il officie après tout dans le monde du crime, Charlie est prêt à payer de sa personne. Pour lui et pour les autres, ceux dont il se sent responsable. Il protège ainsi Johnny contre lui-même et contre les autres. Par l’amour qu’il lui porte, il protège aussi Teresa de l’ostracisme qu’elle affronte tant de la part de l’oncle Giovanni que de Johnny, qui prennent tous deux son épilepsie pour de la folie. Dans un cas comme dans l’autre, il risque des retombées : c’est dans les deux cas sa réputation, son avenir voire sa vie qu’il met en jeu, ce dont il n’est pas forcément payé en retour. Portant le poids de ces charges et tentant d’amener Johnny à régler ses dettes, donc à faire acte de repentance, il se donne un peu une charge christique, payant pour racheter autrui. La parenté avec Scorsese, qui avant d’être cinéaste étudiait pour rentrer dans les ordres, est assez évidente. La vision religieuse de Charlie, plus porté sur la vie réelle que sur le dogme (“On ne rachète pas ses péchés à l’Église, on le fait dans la rue, chez soi“), fait écho à celle du réalisateur dont la foi est avant tout une conception personnelle, ce dont il fera part avec encore plus de mordant avec la sulfureuse Dernière tentation du Christ. Charlie se plait également à mettre sa main au feu, une façon pour lui d’expurger ses fautes dans une symbolique avant tout chrétienne, mais qui peut aussi se percevoir comme le témoignage d’un mal-être et s’apparenterait alors à de la scarification. Une pratique très puérile il est vrai, mais Charlie et Johnny restent eux-mêmes très puérils malgré leur volonté d’apparaître comme des durs. Sans aller jusqu’à les infantiliser, Scorsese fait d’eux des représentants de la jeunesse qu’il a côtoyée dans son enfance, et du jeune qu’il fut lui-même. S’aidant d’une bande originale composée entre autre de la pop sucrée des girls groups façon Ronettes, le réalisateur ancre ses personnages dans la naïveté.

Ces apprentis mafieux, accompagnés parfois d’un troisième larron, Tony, font les cons avec des poubelles dans la rue, se battent comme des chiffonniers entre eux ou avec d’autres par pure susceptibilité et vont très souvent au cinéma voir des productions comme La Prisonnière du désert et La Tombe de Ligeia, dont ils semblent s’inspirer (Scorsese nous montre une scène de chaque films, une bagarre pour le Ford, une épuration par le feu pour le Corman, renvoyant à des scènes particulières de Mean Streets). Des comportement décidément très immatures pour de futurs caïds. L’oncle Giovanni porte d’ailleurs un regard paternaliste sur Charlie, très loin de l’entente clanique d’une famille mafieuse. Il faut dire qu’en affaires aussi, ces jeunes sont encore très tendres. Arnaquer deux adolescents des beaux quartiers à la recherche de cannabis n’est pas très glorieux, et ils se montrent bien plus hésitants avec toutes ces histoires de recouvrement de fonds. C’est presque timidement que Charlie demande au restaurateur de mettre ses traites à jour, et c’est encore plus timidement qu’il affronte Michael, le créditeur de Johnny, lui-même très inexpérimenté et qui ne sait trop comment réagir. Michael n’ose pas dire non à Charlie, qui ne sait pas comment lui dire que Johnny ne peut payer. Ils sont amis, et ne parviennent pas à en faire abstraction, là où de véritables mafieux auraient déjà réglé leurs comptes, amitié ou pas. Leurs entretiens tout en atermoiements pour quelques malheureuses dizaines de dollars et en “promesses de la dernière fois” sont assez pitoyables. On a franchement du mal à croire qu’il s’agit de deux futurs mafieux. Ce sont plutôt des paumés qui cherchent à suivre des exemples familiaux et culturels dans le simple but d’exister dans une ville et un quartier écrasants (surtout lorsqu’a lieu le carnaval de la fête de San Gennaro). Or, seul le milieu du crime le leur permet, ce qui les place donc face à leur conscience et les plonge dans un malaise permanent. Charlie réagit par la foi, Michael en oubliant sa fierté et Johnny… Son sort est le plus désespéré. Criblé de dettes qu’il n’a pas la force de payer, il se terre lorsqu’il le peut dans le secret et la paranoïa, ou bien il agit en écorché, se comportant en cinglé. Le plus bagarreur, le plus gueulard, le plus vaniteux, et le plus sujet aux coups de folies, comme de prendre un flingue et tirer dans le vide depuis un toit (et s’excusant lorsqu’il brise une vitre du voisinage… il n’a pas plus mauvais fond que les autres). Giovanni a raison sur son compte : c’est un fou, il est définitivement perdu. Il n’existe que par la provocation et le déni. C’est par son attitude irresponsable et encore plus puérile que celle de ses camarades qu’il risque de faire tourner les choses au drame, entraînant tout le monde avec lui dans l’expiation si chèrement souhaitée par Charlie, dont l’attitude protectrice envers Johnny ne peut contribuer qu’à accroître l’amertume jusqu’à une solution explosive et purgative. Peut-être n’y a t il que cette manière pour prendre conscience de la nécessité d’enrayer cette spirale négative où lui et ses amis font office d’intrus.

Un an avant Le Parrain II, le déjà exceptionnel De Niro s’offre un rôle prenant le contrepied de la froideur calculatrice de Don Vito Corleone et annonce clairement Taxi Driver. Plus généralement, Mean Streets est à l’opposé de la trilogie de Coppola dans laquelle les jeunes, couverts dès le plus jeune âge par la “famiglia” sont prêts à prendre le relais, y compris à l’improviste dans le cas de Michael Corleone. Chez Scorsese, en tout cas dans Mean Streets, il n’y a rien de tout cela. Comme le suggère le déséquilibre de la caméra, assez souvent portée à l’épaule (pour cause de budget réduit, mais cette immersion ne fait que renforcer l’opposition à toute vision romantique), il n’y a que la réalité de jeunes embarqués sur de mauvais rails, et qui tentent coûte que coûte de se prouver qu’ils sont dignes du chemin qu’ils ont choisi, le seul qui leur était proposé. Ils font fausse route, et seul Charlie et sa foi des rues en a un début de conscience… Ils devront en payer le prix, et lui-même cherche à se racheter. Et après tout, en posant un regard plein de compréhension sur une frange paumée de la jeunesse new yorkaise qu’il a côtoyée (et De Niro aussi), Scorsese contribue lui aussi à la racheter, loin des préjugés dont il s’affranchit via sa réappropriation “nouvelle vague” du film noir. Le titre Mean Streets fut d’ailleurs emprunté à Raymond Chandler, remplaçant celui qui était prévu, “Season of the witch“, et le film qu’il désigne fut un coup de tonnerre dans le cinéma américain. Un cinéaste de génie venait d’apparaître, imposant déjà sa marque 100% new yorkaise.





