Batman – Tim Burton
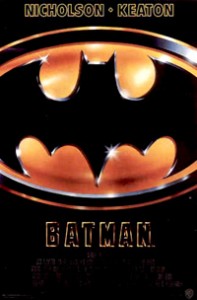 |
Batman. 1989Origine : États-Unis
|

Au temps de sa sortie en 1989, Batman marqua une nouvelle évolution dans le cinéma-marketing. Dépassant de loin tout ce qui avait été déjà fait en termes de produits merchandising, le film de Tim Burton, pour un budget de 35 millions de dollars, engrangea la coquette somme de 750 millions de dollars de bénéfices rien qu’avec les produits dérivés, soit presque autant que ce que le film en lui-même rapporta par sa distribution en salles au niveau mondial. Les T-Shirts, les pin’s, les mugs, les posters, les cartables, sans compter le 45 tours de la chanson-titre interprétée par Prince, bref la promotion de Batman tint plus de la propagande massive que de la simple publicité. Il faut dire que la sortie du film constitua un grand événement pour la Warner, qui vit ainsi s’achever presque dix ans d’un développement cahotique, à l’origine initié pour surfer sur la vague des films de super-héros relancée par la sortie des aventures de Superman, autre personnage estampillé DC, également porté à l’écran avec les fonds de la Warner. Logiquement, le tout premier script de Batman fut signé du scénariste du Superman de Donner, et devait mettre en scène Batman et son traditionnel allié Robin, déjà présent dans la prédécente adaptation du Dark Knight à l’écran, en 1966, dans la farce de Leslie H. Martison dérivée d’une série télé pour le moins très fantasque. Mais le projet s’eternisa, et les réalisateurs potentiels défilèrent, notamment Ivan Reitman (Ghostbusters), Joe Dante (Gremlins) ou encore les frères Coen (scénaristes du cartoonesque film noir Mort sur le Grill)… Le projet fut quelque temps mis au placard, avant que les producteurs Peter Gruber et Jon Peters (déjà associés pour Le Loup-Garou de Londres, La Couleur Pourpre, L’Aventure Intérieure…) ne le repêche pour le confier à un jeune réalisateur nommé Tim Burton, qui, guère satisfait du script d’origine et inspiré par le Dark Knight Returns de Frank Miller, rédigea sa propre histoire qu’il confia à un novice nommé Sam Hamm, chargé de retranscrire le tout sous forme de scénario. Satisfaisant à peu près tout le monde, ne restait donc plus qu’à trouver le casting. Lourde tâche, auquel s’était déjà heurtés les premiers instigateurs de cette renaissance Batman. Willem Dafoe, David Bowie, John Lithgow, James Woods, Tim Curry, Ray Liotta furent ainsi présentis dans le rôle du Joker. Ce fut finalement à Jack Nicholson qu’échut le rôle, après une hésitation initiale de l’acteur, qui finalement accepta sous la pression d’un studio qui n’hésita pas à lui faire savoir que Robin Williams risquait bel et bien de prendre sa place. Pour Batman, Alec Baldwin, Charlie Sheen, Bill Murray, Pierce Brosnan, Tom Selleck et Mel Gibson furent un temps envisagés. Adam West, l’interprète de Batman dans la série télévisée des années 60, alla même jusqu’à aimablement proposer ses services en dépit de ses 60 ans ! Ce fut finalement Michael Keaton qui fut retenu, avec le consentement de Bob Kane, le créateur de Batman. Au milieu de toute cette pré-production cahotique, Tim Burton eut le temps de mettre en scène Beetlejuice, dont le succès rassura une dernière fois la Warner, et le tournage démarra enfin en octobre 1988.

Pour un film constituant la renaissance d’un super-héros à l’écran, ce Batman cuvée 1989 ne présente finalement que peu d’intérêt pour tout ce qui concerne la création du Batman par le milliardaire Bruce Wayne. Nous sommes très très loin d’un Batman Begins, et si le film de Tim Burton montre tout de même le meurtre des parents Wayne, de même qu’il dévoile la naissance du Joker, il ne s’y attarde que modérément, trahissant même au passage dans les deux cas la mythologie créée par les comics. Les parents de Bruce Wayne ne sont ainsi plus assassinés par une petite frappe des rues, mais bel et bien par Jack Napier, celui qui deviendra un jour le Joker, et celui-ci ne sera plus un bandit débutant trahi par ses complices, mais un ponte de la ville piégé par Batman, qui le plonge dans une cuve d’acide lui déformant les traits du visage pour en faire le Joker. Burton sait pertinement que toute la mythologie ne peut tenir en un film, et il sait également que son film doit rester cohérent, avec un début, un milieu et une fin, bref avec une vraie histoire. Et c’est pourquoi ces libertés prises avec les mythes fondateur de Batman et du Joker sont détournés, afin de mieux servir le film, qui dès lors devient autonome (n’est-ce pas, monsieur Christopher Nolan ?).

En faisant du Batman le fruit des crimes de Jack Napier, et en faisant du Joker le résultat d’une intervention du Batman, Burton lie véritablement le destin de ses deux personnages principaux, diamétralement opposés. Là où le Batman est dur, taciturne et droit dans son costume hyper-rigide, le Joker est au contraire rigolard, plein de gouaille et exubérant. L’un dissimule en permanence son identité sous son costume, l’autre ne fait que peu de cas de savoir si sa véritable identité est connue ou non, s’affichant tantôt maquillé et tantôt démaquillé. Le Joker est le Joker, son rictus est fixé dans sa chair, tandis que Batman est Bruce Wayne, son alter-ego mondain et rêveur. Batman est aussi l’âme de Gotham : sombre et torturé, comme peut l’être l’esthétique même de la ville, superbement retranscrite par le décorateur Anton Furst, qui se base sur plusieurs sortes d’architectures pour donner un look disparate à Gotham, évoquant également certaines références filmiques telles que le Metropolis de Fritz Lang ou encore les grosses villes des films noirs (après tout, Batman n’est-il pas à la base censé être un detective ?). A l’inverse, le Joker, pourtant nouveau leader du syndicat du crime depuis qu’il s’est débarassé de son ancien patron Carl Grissom, celui-là même qui l’a trahi dans l’usine de produits chimiques, est coloré et farceur. C’est en quelque sorte le Pee-Wee du crime. Il ne respecte rien, ni Gotham ni le Batman, et son manque de solennité en fait décidément le centre d’intérêt de tout le film. Car Burton, en bon défenseur des marginaux qu’il est, délaisse en effet le Batman, qui s’inscrit beaucoup trop dans la ville, dans son esthétisme et dans sa façon de penser (la célèbre fin, lorsqu’est inauguré le spot lumineux symbole de l’alliance entre le Dark Knight et la ville, est à ce titre tout à fait révélatrice de l’osmose entre le justicier et la ville).

En outre, Burton doit également composer avec le personnage de Vicky Vale (Kim Basinger, remplaçant au pied levé Sean Young, blessée lors du tournage), véritable fléau « parachutée » au milieu de Gotham pour une raison incompréhensible. Le terme « parachutée » vient en effet tout de suite à l’esprit : sa première apparition est totalement imprévue, et se justifie très mal par le boulot de photographe indépendante qui lui incombe. Non seulement elle ne sert à rien, mais en outre elle tend à insuffler une niaiserie malvenue non seulement chez Bruce Wayne, qui dès lors trahira avec la complicité du majordome Alfred sa double identité auprès de cette blonde de pacotille censée représenter le grand amour… Les scènes romantiques sont consternantes de bêtise, d’autant plus lorsqu’elles succèdent -comme c’est le cas de la principale d’entre elles- à une intervention du Joker, sans conteste la principale source d’inspiration de Burton. Du reste, un autre réalisateur présenti, Joe Dante, avait d’ailleurs abandonné le projet parce que, je cite : « Je ne crois pas à Batman. Celui que j’aime c’est le Joker, parce qu’il tue des gens et qu’il rit. Mais je ne peux pas faire un film uniquement parce que j’aime le Joker ». Et c’est pourtant ce que Burton a réalisé : un film où Batman se trouve réduit à ses fonctions minimums, et où le Joker dynamite un monde trop solidement accroché à ses conventions, aussi bien dans le domaine de la justice que dans celui du banditisme. Car le Joker rejette tout en bloc : la légalité imposée par Batman, ainsi que les vieilles méthodes de banditisme de gens tels que Carl Grissom. C’est un esprit libre, qui à vrai dire ne cherche même pas tant à imposer la terreur sur la ville qu’à se moquer des conventions, au premier rang desquelles figure la personnalité de Batman. Les gags à la con sont légion et dignes du premier clown venu, et ne seraient même pas si humoristiques s’ils ne se déroulaient pas dans un contexte aussi guindé, voire carrément figé. Le choc que constitue le personnage du Joker est assez rude, surtout qu’a priori rien ne laissait entrevoir une telle personnalité lorsqu’il n’était encore que Jack Napier. Son apparition fracassante au milieu de la dogmatique assemblée de malfrats reste assez stupéfiante, tout comme l’est son défilé au milieu de la ville, qui préfigure grandement celui du Gang du Cirque dans Batman le défi, ou encore son arrivée mouvementée au restaurant / musée, dans lequel il s’evertue à saccager sans vergogne, comme un gosse, toutes les peintures de maîtres qui lui passe sous la main, ou presque (le très sombre et assez surréaliste Figure With Meat de Francis Bacon est ainsi sauvegardé).

Avec un tel adversaire, Batman se fera bouger, et autant son trauma enfantin que sa romance présente seront fort agréablement compensés par sa rivalité avec le Joker, comme le prouve le combat final, qui zappe complètement le personnage de Vicky Vale, pourtant théoriquement l’enjeu du combat, au profit d’une superbe opposition entre le Dark knight et le Joker, qui évoquera tour à tour le cirque (c’est l’un des moteurs de la carrière de Burton), le ballet et, encore une fois, le Metropolis de Fritz Lang, aidé en cela par le superbe travail de Anton Furst et du directeur de la photographie, Roger Pratt, ainsi que par la non moins superbe musique de Danny Elfman, sorte de valse se prêtant à merveille aux délires déplacés du Joker. Jusqu’au bout, celui-ci imposera sa patte sur le film, et permettra non seulement d’apprécier grandement ce Batman, mais aussi d’imposer le style de Tim Burton.
Batman est donc en réalité un galop d’essai, qui selon les dires du réalisateur fut plutôt pénible à concevoir en raison de l’omniprésence du studio. Mais grâce à ce film, grâce aux expérimentations qu’il a pu y faire, Burton put quelques années plus tard livrer son fantastique Batman le défi, où tous les concepts posés par ce premier Batman seront exploités jusqu’au bout sans aucune retenue. Le meilleur restait donc à venir, mais en attendant, ce premier film-merchandising demeure un étonnant succès.






Petite anecdote concernant Batman et The Dark Knight. Dans le film de Tim Burton, en haut d’une cathédrale, Batman attache la jambe du Joker à une gargouille pour qu’il ne s’échappe pas, celui accroché à l’échelle d’un hélicoptère, se retrouve avec une gargouille qui l’empêche de monter dans l’hélico, et finit par tomber dans le vide et mourir.
Dans The Dark Knight, après une lutte acharnée contre le Joker, Batman finit par le pousser dans le vide en haut d’une tour en construction, mais se sert de son Bat-grappin pour rattraper le Joker et le sauver.
Au final l’un tue le Joker, tandis que dans le film de Nolan, Batman le sauve.
Je sais pas trop ce que disent ces films de leur époque. Mais pour moi on est dans une période ou l’on ne prend plus de risque, soit ce sont des PNG (extra terreste, monstres) qui sont tués car complétement déshumanisés, soit ce sont des personnages plus importants qui sont ressuscités à la faveur d’un scénario, qui sort une explication complétement tirée par les cheveux comme dans Fast and Furious ou Endgame (amis ou ennemis).
J’ai l’impression que l’on ne prend plus de risques. J’ai vu Transformers Rise of Beast qui à ma grande surprise m’a beaucoup plu, et on refait le coup de tuer un personnage important pour le voir ressusciter. Pareil pour Superman qui meurt dans Batman contre Superman et ressuscite dans Justice League.
Je crois que ce l’on tolérait auparavant n’est plus possible. On peut se souvenir de mauvais films dans les 90, mais là actuellement, quelque soit leurs qualités, les nouveaux films deviennent de plus en plus oubliables.
En montrant son Batman épargner le Joker, Christopher Nolan ne fait que revenir à l’essence même du personnage, un justicier parfois brutal, certes, mais jamais au point d’outrepasser les limites.
Mais il laisse mourir Ra’s al Ghul dans le métro de Gotham, pousse Double Face dans le vide pour l’empêcher qu’il tue le fils de Gordon, et ne s’émeut pas trop de la mort de Bane.
Il a certes un code d’honneur, mais quand les circonstances l’exigent, il lui arrive de prendre des décisions, qui peuvent être fatales, comme sauver Gotham d’une bombe, en précipitant le véhicule conduit par Talia al Ghul, dans le vide.
Donc oui, il ne tue pas, mais il y a quand meme des choix à faire.