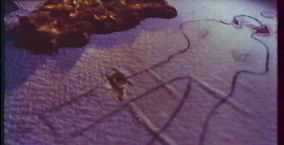Le Coriace – Franco Prosperi
 |
L’Uomo dalla pelle dura. 1972Origine : Italie
|
Bien remplie est la vie de Teddy Wilcox (Robert Blake) dit « le Cherokee » en raison de ses origines indiennes. Étudiant jusqu’à ce qu’il soit renvoyé pour avoir violenté un professeur pervers sur le point de violer sa copine, ex soldat du Vietnam décoré et délinquant connu des services de police, il est désormais boxeur et connait de jolis succès. Il quitte cependant son manager, coupable de lui avoir volé de l’argent durement gagné et, selon les conseils de Mike, son vieil ami de fac, il en rejoint un autre, Nick, qu’on lui dit moins corrompu. Quelle ne sera pas sa désillusion lorsqu’un soir de match, Teddy se rendra compte que son nouveau manager tente de lui faire perdre le match. Il le renvoie immédiatement avec fracas et gagne finalement la partie. Mais à peine rentré au vestiaire, Nick le contacte et l’implore de venir le voir, car sa vie en dépend. A peine Teddy est-il au lieu de rendez vu qu’un homme masqué débarque et assassine Nick. Le boxeur doit se rendre à l’évidence : le pauvre manager avait été victime des pressions d’une organisation mafieuse. Le coriace Cherokee tentera de retrouver les vrais responsables tandis que l’entourage de Teddy sera peu à peu décimé, conduisant l’Inspecteur Perkins (Ernest Borgnine) à la conclusion que Teddy est le meurtrier.
Il va sans dire qu’entre le début du film et son dénouement, nous serons passés d’un genre à un autre. Bien difficile de cataloguer le film de Franco Prosperi, réalisateur qui eut son heure de gloire dans les années 60 grâce à son Mondo Cane et ses suites. Bien entendu, des films de fiction traitant de la boxe, Rocky est le plus célèbre. Mais en 1972, Sylvester Stallone n’avait pas encore démarré sa saga, et le coup du boxeur qui s’élève du rang de médiocre à celui de champion n’était pas encore en vigueur. Cette orientation, à laquelle le film pouvait faire songer au départ (entre le moment où Teddy quitte son premier manager pour rejoindre un nouveau) sera très tôt démentie. S’ensuivra alors ce qui semble être une étude du milieu de la boxe, avec la corruption qui le gangrène. Ce thème, déjà à l’honneur dans l’excellent Nous avons gagné ce soir de Robert Wise en 1949, apparaît comme légitime dans une époque où la mafia reste très implantée. Mais si Prosperi l’utilise bien et poursuit au gré des meurtres par montrer une mafia omniprésente et calculatrice, il ne l’utilise pourtant pas comme une fin en soi. Il s’agit plutôt d’une toile de fond qui ne sera pas développée outre mesure, puisque le point de vue du spectateur épousera celui du personnage principal, qui ignore justement tout de ceux qui cherchent à le faire condamner par la police. Difficile dans ces conditions de théoriser sur le mode de fonctionnement d’une organisation complétement opaque. Nous voilà donc amenés à suivre une intrigue policière des plus classiques, sous la forme d’un « whodunit » entretenant quelques vagues points communs avec le giallo, tels que des meurtres à l’arme blanche commis par une main gantée, ou encore le sentiment du personnage principal d’être coincé au milieu d’une dangereuse machination. Mais pour l’essentiel, nous ne dépasseront que rarement le statut de simple film policier, à peine pimenté par le suspense, puisque l’identité du vrai responsable (et de son allié) ne fera que peut de doute pour quiconque est un tant soit peu observateur. Prosperi, malgré une mise en scène poussive (les combats de boxe du début sont horrible et la caméra tend généralement à se balader dans tous les sens) réussit tout de même à garder l’intérêt de ses spectateurs et à préserver l’intensité de l’intrigue en faisant de son personnage principal (solide interprétation de Robert Blake) un dur de dur n’obéissant qu’à lui-même, se plongeant dans une merde noire avec une foi inébranlable en ses propres capacités à retourner la situation. Tomas Milian en rôdeur hippie sarcastique fera également merveille, anticipant un peu sur le personnage de Monnezza dans les polars qui contribueront à sa gloire quelques années plus tard. Dommage cela dit qu’il ait un aussi faible temps de présence à l’écran, ce qui sera également le cas de Ernest Borgnine, toujours bienvenu en policier aussi dur qu’à côté de la plaque, et de Catherine Spaak, fille d’un des scénaristes de Renoir alors tout auréolée de sa présence dans Le Chat a neuf queues d’Argento.
Voici un film résolument moyen, oscillant entre de bonnes choses (comprenant un très sanglant final) et d’autres carrément médiocres, entre divers genres mariés avec plus ou moins de bonheur… Assez dispensable.