Forgotten Silver – Costa Botes, Peter Jackson
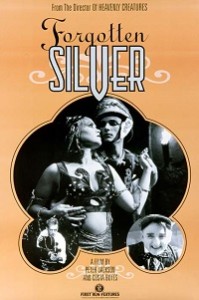 |
Forgotten Silver. 1995Origine : Nouvelle-Zélande
|

Le 28 octobre 1995, sur la chaîne TV ONE, le public néo-zélandais trouve de quoi galvaniser son patriotisme en visionnant Forgotten Silver, un documentaire faisant connaître la vie et l’œuvre de Colin McKenzie, ce compatriote qui au début du XXe siècle fit figure de pionnier du septième art avant de tomber dans l’oubli au fil des pérégrinations de l’histoire. Le réalisateur Peter Jackson l’en a sorti en retrouvant par miracle les bobines des films de McKenzie dans la vieille malle de sa voisine, épouse du cinéaste depuis longtemps décédé. Désormais restaurées, les bandes font l’unanimité auprès des spécialistes et historiens du cinéma interrogés pour l’occasion par Jackson et son acolyte Costa Botes.

Rusés Peter Jackson et Costa Botes, qui pour mieux faire gober le contenu de leur faux documentaire ont opté pour une diffusion sur une grande chaîne publique à un créneau horaire pas forcément squatté par un public averti. Logiquement, il y eut du monde pour tomber dans le panneau et, une fois la vérité révélée, faire naître une petite controverse. Tout comme les réactions suite à la fameuse Guerre des mondes de Orson Welles, cela invite à s’interroger sur la puissance des médias et sur la crédulité qu’ils entraînent. Mais tel ne sera pas le sujet de cette chronique, comme cela n’a probablement pas été la préoccupation principale de Jackson et de Botes, en dépit de leurs efforts plus ou moins fructueux pour faire passer des images fraîchement tournées pour de réelles archives âgées d’un demi-siècle et plus. L’envie de réalisme, qui se prolonge jusque dans la façon même de composer le documentaire (le recours à de nombreux témoignages intelligemment choisis – l’acteur Sam Neill, le producteur Harvey Weinsten, le critique et historien du cinéma Leonard Maltin, la fausse épouse de McKenzie… -, le ton employé par la voix off, l’historique des recherches sur McKenzie et l’excursion pour retrouver les décors qu’il a utilisé etc…) n’est à mon sens pas tant la preuve de leur désir de tromper les spectateurs que celle de leur inclination pour le second degré. Soigner les apparences de véracité peut certes induire en erreur un public sans recul, mais c’est aussi la meilleure manière de faire ressortir par l’humour les énormités attribuées à Colin McKenzie. Avant même de songer à la réception réservée à Forgotten Silver, les deux réalisateurs semblent avoir pris un plaisir jubilatoire à inventer tout un tas d’anecdotes, de péripéties et de (més)aventures qui font à la fois de leur sujet un pionnier incomparable et un poissard absolu prisonnier des circonstances et d’une époque qui n’était pas prête à accueillir ses innovations.

Insensibles aux aspirations de cet inventeur de génie, les autorités n’hésitent pas à l’interpeller après qu’il eut dérobé les œufs dont il avait besoin pour concevoir sa propre pellicule de cinéma. De même, lorsqu’il filme des femmes à moitié nues à Tahiti pour expérimenter avec succès son procédé d’images en couleur, ces mêmes autorités sont davantage alertées par l’atteinte aux bonnes mœurs que par la révolution technique que McKenzie vient de mettre au point. Dans un autre style, le problématique financement de Salomé, son magnum opus qui a nécessité un retrait complet de la civilisation le temps de bâtir des décors pharaoniques, le fait passer de la servitude la plus plate envers un pitre bête et méchant -mais riche- se voulant Charlie Chaplin au service de la cause marxiste à la demande de Staline lui-même… Lorsque la météo ne s’invite pas à la fête, contraignant son tournage à s’interrompre et faisant fuir les figurants. Bref, le sort s’acharne sur lui et lui-même n’est pas exempt de maladresse, comme lorsqu’il provoque le crash du monoplan de Richard Pearse qui venait enfin de décoller, non sans avoir immortalisé cet événement qui précède le premier vol officiel des frères Wright. Ou encore lorsqu’il réalise le premier film parlant en utilisant des acteurs sinophones, limitant du même coup la portée de sa trouvaille. Tant de déboires et la naïveté qui s’associe au génie de McKenzie ne peut que le rendre attachant. Jackson et Botes ne se sont d’ailleurs pas limités à en faire un doux rêveur, et n’ont pas négligé d’intégrer dans sa vie quelques tragédies qui cette fois invitent plus à la compassion qu’à l’amusement : la mort de son frère et associé sur les champs de bataille de Gallipoli, celle de Colin McKenzie lui-même, et même une certaine tristesse qui se dégage du harcèlement que lui voue le mauvais sort pendant le tournage de Salomé, le film de sa vie… Le faux réalisateur en retire une humanité qui fait sortir le documentaire de la simple farce. Ces accès dramatiques, peu en adéquation avec les “gags” qui entourent bien des aventures de McKenzie, ont certainement joué un rôle au moment d’induire en erreur des spectateurs peu préparés à ce genre de ruptures de ton.

Par delà le personnage central se dégage aussi de Forgotten Silver un sentiment qui n’est pas véhiculé directement par McKenzie, mais que sa personnalité et son parcours font ressortir d’une façon évidente. En se plongeant dans une histoire du cinéma, quand bien même inventée de toute pièce, Jackson et Botes revendiquent une certaine nostalgie pour l’ère des débuts du cinéma, depuis le début du XXe siècle aux années 30. Tout était alors à inventer, aussi bien dans les domaines artistiques que dans les domaines purement techniques et même commerciaux, et ils ne cachent pas leur affection pour ces pionniers qui ont initié l’histoire du septième art dans la difficulté de leur époque et parfois dans un flou absolu induit par le manque de repères. D’où les faux-pas amenant ce petit côté touchant mais qui ne saurait faire oublier le côté novateur incarné par Colin McKenzie. Les premiers pas du cinéma sont pour Jackson et Botes, réalisateurs et scénaristes des années 1990, une ère fascinante qu’ils reproduisent non seulement en vieillissant artificiellement leurs propres images pour jouer la carte du faux documentaire, mais en reproduisant aussi un style qui trouve à la fois son origine dans le matériel de l’époque (le défilement un peu saccadé des images), dans les contraintes techniques (l’absence de son et de couleurs… après tout McKenzie a inventé les deux, mais n’en a gardé aucun pour son Salomé), dans l’aspect artistique (le jeu excessif des acteurs, voulant rendre par le geste ce qu’ils ne pouvaient exprimer par la parole) et dans des concepts apparaissant aujourd’hui -et même alors- un peu simplets (Stan the Man, le fameux comédien et ses tartes à la crème). Auteur de ces reconstitutions tandis que Botes s’occupait de filmer les interviews, Peter Jackson s’est en fait livré à un véritable exercice, celui de reproduire de la façon la plus convaincante possible ces caractéristiques. Une façon aussi de se mesurer à ces glorieux prédécesseurs et de leur rendre hommage.

Après tout, le concept même de Forgotten Silver ne diffère guère de celui d’Orson Welles pour son adaptation radiophonique de La Guerre des mondes, les images en plus (mais Welles n’était-il pas aussi avant tout un réalisateur ?). Stan the Man lui donne l’occasion de verser dans le burlesque à la façon de Charlot. Salomé, en plus de faire écho à trois films du temps du muet, n’est pas sans évoquer les grandes fresques réalisées par un D.W. Griffith. Les exigences des producteurs soviétiques de Salomé, ou celles des autres producteurs mafieux, évoquent elles aussi des difficultés récurrentes dans la vision d’un artiste. Et qui sont toujours de mise, comme d’ailleurs d’autres éléments qui contribuent à faire le lien entre les premiers pas du cinéma et ce qu’il est désormais. Car tout en soulignant des spécificités propres à l’époque, Jackson et Botes font aussi des parallèles qui établissent une filiation entre eux et les pionniers. Le financement, les exigences des producteurs, les contraintes sociales et morales, et même l’accumulation de poisse (un Terry Gilliam pourrait en parler), tout cela n’a guère changé. Il devient dès lors tentant de ne pas faire une comparaison entre le Salomé, la fresque épique de Colin McKenzie, et le parcours de Peter Jackson lui-même, qui a démarré comme lui en néo-zélandais novice avec les moyens du bord pour se projeter vers sa propre fresque grandiloquente. Indépendamment de la valeur qu’on peut lui trouver au final, son Seigneur des anneaux a été un carton commercial et critique. Mais à l’heure de Forgotten Silver, en 1995 alors qu’il commençait déjà probablement à être travaillé par l’idée d’adapter Tolkien, Jackson n’avait peut-être pas tant d’espoirs que cela. D’où une auto-projection dans la personne de Colin McKenzie.

Œuvre à même de le faire remarquer au-delà des communautés réunies autour de Bad Taste, Créatures célestes a marqué la volonté de Peter Jackson de tourner la page de sa première partie de carrière. Fini l’amateurisme débrouillard et insouciant. Désormais, le réalisateur regarde son avenir. Ambitieux, il sait malgré tout qu’il se lance dans l’inconnu et semble déjà pâlir d’avance devant l’ampleur des responsabilités qui ne tarderont pas à le cerner. D’une certaine manière, le personnage de Colin McKenzie lui permet d’évoquer sa vision du cinéma et ses motivations en même temps que ses craintes. Des fois que la postérité viendrait à le juger comme un opportuniste ou des fois qu’il se vautrerait lamentablement, il restera toujours Forgotten Silver, ce petit bilan très perspicace aux accents auto-justificateurs de ce qu’il était à ce moment donné (on y retrouve bien le Jackson facétieux des débuts), et de ce qu’il comptait faire. Aurait-il eu peur de perdre son identité en route, ou de ne pas être capable de l’exprimer convenablement au sein d’un univers hollywoodien qui le dépayserait forcément ? C’est fort possible, surtout si l’on tient compte de sa volonté de ne pas tourner en dehors de sa Nouvelle-Zélande natale.





