Sorority House Massacre – Carol Frank
 |
Sorority House Massacre. 1986.Origine : Etats-Unis
|

Grosso modo, le Roger Corman adulé en ces pages aura été actif de 1955 à 1980. 25 ans passés à apprendre sur le tas le métier de cinéaste puis de producteur, le tout dans un esprit sachant concilier l’exploitation pure et l’investissement personnel, et non sans savoir à un certain moment su transmettre la flamme à de nouvelles pousses promises à un brillant avenir. Pour tout cela et en un aussi court laps de temps, Roger Corman aura bien mérité la réhabilitation tardive qui l’aura vu passer du rang de « pape de la série Z » en symbole à part entière du cinéma américain. Mais qu’en est-il du Roger Corman post-New World Pictures ? En 1982, après avoir vendu la firme qui fit office d’écurie pour de nouveaux talents, Corman en refonda derechef une nouvelle : la Concorde, complétée peu après par la New Horizons (les deux fusionneront pour donner jour à ce qui est aujourd’hui la « New Concorde Home Entertainment »). La première devait produire, et la seconde distribuer. Le marché ouvrait alors ses portes à un tout nouveau média : la VHS. Et c’est ainsi que l’estampille « Roger Corman » devint peu à peu galvaudée, s’appliquant à des films dont Corman se contenta d’obtenir les droits au lieu de s’impliquer lui-même dans leur création. Ce qui explique pourquoi, au XXIe siècle, les productions Corman se limitent désormais à de banales productions semblables à bien d’autres, à base par exemple d’animaux mutants perdus au milieu d’une surabondante concurrence. D’où l’image du pape de la série Z. Triste ! Tant et si bien qu’à partir de la revente de la New World, l’esprit insufflé par Corman se retrouve davantage dans d’autres boîtes : la Troma de Lloyd Kaufman, ou mieux encore l’Empire International Pictures de Charles Band. Quant au Corman de l’ère Concorde / New Horizons, plus le temps passa, moins il sut se distinguer. Sorti en 1987, à l’heure de Freddy Krueger et des slashers tous publics, Sorority House Massacre est un cas d’école.
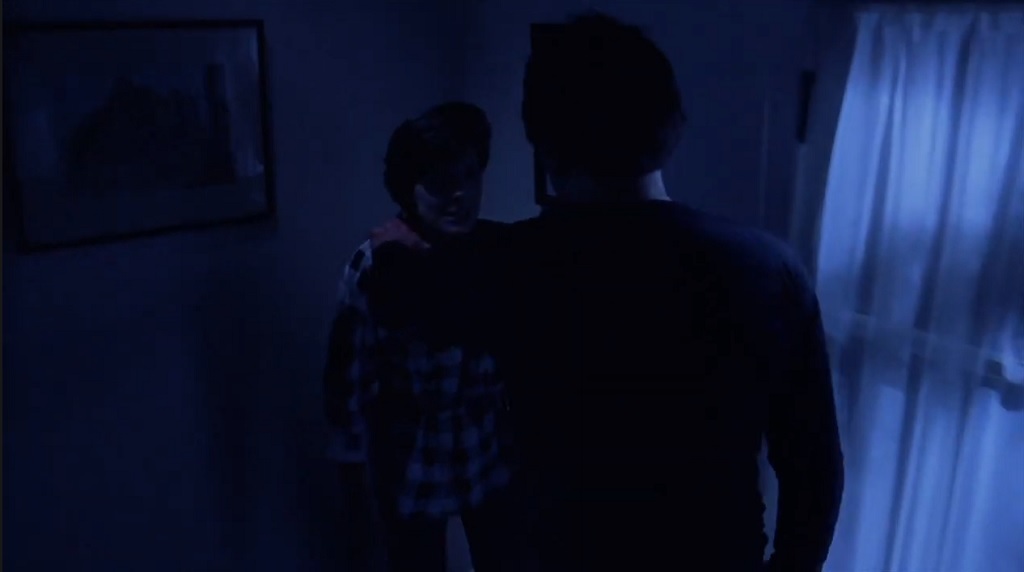
C’est en étant mal à l’aise que Beth vient se fondre dans une petite sororité comptant trois autres filles logées dans une cossue maison de banlieue. Non que ses colocataires soient particulièrement malveillantes : elles sont au contraire fort compréhensives pour la nouvelle venue qui semble obsédée par des cauchemars récurrents et des hallucinations choquantes. Dans ceux-ci, un horrible tueur décime un à un toute une famille. Et croyez-le ou non, cette histoire fait écho à ce qu’il s’est réellement passé dans cette maison : il y a plusieurs années un certain Robert Henkel y avait effectivement assassiné toute sa famille à l’exception de sa petite soeur… Coïncidence ? C’est ce que nous verrons très bientôt, puisque Robert vient de s’évader de l’asile et projette un retour au bercail…

Est-il possible de faire plus passe-partout que cette intrigue tout droit piquée à Halloween ? Pourtant depuis le film de Carpenter, de l’eau a coulé sous les ponts, et les slashers ont évolué… Certes pas forcément en bien : les tueurs sont devenus plus folkloriques qu’effrayants, le second degré a pris le pas sur l’angoisse hitchcockienne, et disons-le, le genre s’est petit à petit crétinisé. Alors faut-il en conclure que Sorority House Massacre constitue un retour aux fondamentaux ? Non pas ! C’est que Carol Frank s’est dit qu’il serait bien de copier l’intrigue de Halloween mais en la déplaçant dans un cadre qui évoque tout à fait le slasher finissant de la fin des années 80. Il va sans dire que du coup, une large part de ce qui rendait le film de Carpenter inquiétant passe à la trappe : au lieu de cette ambiance automnale agrémentée des oripeaux propres aux célébrations d’époque, nous avons donc une sororité luxueuse dans laquelle un quatuor de bêtasses (avec un B car nous sommes polis) n’en peut plus d’attendre la visite prochaine de leurs alter egos masculins. Alors elles tuent le temps en essayant la garde-robe de leur propriétaire absente. Franche rigolade à l’appui car Beth exceptée, nous sommes en présence d’une belle brochette de boute-en-train. Ah oui, et moyennant un cursus en psychologie suivi par l’une d’entre elles, elles aiment également à disserter sur les cauchemars dont est victime la pauvre Beth. D’où il découle que rêver d’un tueur armé d’un couteau serait, symbole phallique aidant, le signe évident d’une peur de l’acte sexuel… alors que les mâles seront bientôt là ! Une expertise sous forme de tarte à la crème freudienne qui a tôt fait d’être battue en brèche par une explication plus prosaïque : et si Beth était en fait la petite sœur de Robert Henkel et que ses cauchemars n’étaient que le traumatisme refoulé du massacre ? Tout l’indique, et pas uniquement en se rappelant du passif Laurie Strode. Aussi, on se demande bien pourquoi la réalisatrice fait mine de laisser planer le suspense… Les personnages n’en apparaissent que comme plus débiles encore, et le film d’avoir l’air de s’adresser à des spectateurs au même niveau. Mais il faut dire qu’en plus de faire de l’œil à Halloween, cette histoire de famille constitue une sorte de trompe l’œil pour faire croire à un semblant de profondeur que Carol Frank se plait à entretenir dans des séquences de cauchemars (là encore destinées à meubler)… qui de leur côté lorgnent furieusement du côté des Griffes du cauchemar.

Ce qui nous amène donc au boogeyman du jour : le brave Robert, dit « Bobby ». Lui qui se voudrait un Michael Myers mâtiné de Freddy Krueger n’est en fait qu’un pauvre bougre qui peine à se forger une quelconque personnalité. Il s’habille en sombre, n’est guère bavard et nous est généralement montré sous la forme d’une silhouette, mais la mayonnaise ne prend pas. La faute à un flagrant manque de charisme (un peu pataud, le bonhomme), à une totale absence de signe distinctif (même pas de masque !) et à un médecin traitant -l’équivalent de Sam Loomis, donc- qui n’est pas là pour gloser sur le mal incarné que représente ce tueur. Non : au moment de l’évasion, la Dr. Lindsey n’était pas chez elle et le téléphone a sonné dans le vide. Ce qui n’a pas empêché la réalisatrice de retourner régulièrement à l’asile, sûrement histoire de voir s’il y avait là quelque chose de plus intéressant qu’à la sororité. Et bien non ! Par contre, ce petit stratagème venant s’ajouter à divers autres (les cauchemars de Beth, les scènes du Robert en liberté, quelques visions subjectives superflues…) est là pour témoigner qu’elle a au moins essayé d’éviter l’écueil habituel des slashers, à savoir s’enfoncer dans un vide soporifique séparant l’entame du film du jeu de massacre échevelé. C’était bien tenté, mais c’est raté : s’il n’est pas soporifique, son film n’en est pas plus dynamique pour autant. Si c’était encore le prix à payer pour en arriver au croustillant… Mais même pas. Le méchant Robert est décidemment un tueur bas de gamme : aucune inventivité dans l’exécution, aucune tension dans l’assaut qu’il donne à la maison et même aucun penchant pour le sanguinolent. Juste une poignée d’acteurs platement poignardés l’un après l’autre, non sans faire preuve (au moins ils sont cohérents) d’une imbécilité crasse tant dans les mots que dans les actes. Carol Frank se limite au strict minimum, s’inspire très vaguement de la mise en scène de John Carpenter, ainsi que des quelques péripéties qu’il emploie (la chute du balcon), balance une musique qui à tout prendre est encore ce qui est le plus efficace (quoique là encore bien dépourvue d’originalité), tente un peu de rendre le tout moins visuellement agressif en éteignant les lumières, trouve le moyen de rendre Robert indestructible… et ne se défait toujours pas de son fil rouge, à savoir établir la parenté entre Beth et lui. Elle croit même bon de faire soudain parler ce brave Robert, histoire d’entériner ce qui était évident depuis le début. Bref, elle fait grand cas de bien peu de choses, concluant même en laissant augurer d’une suite selon le schéma bien établi par moult autres productions du même acabit.

On ne vas s’appesantir longtemps sur le cas de ce Sorority House Massacre globalement insipide. Un slasher tout ce qu’il y a de plus générique. En revanche, notons (incroyable mais vrai) qu’il signe le point de départ d’une trilogie elle-même inscrite dans une trilogie de sagas estampillés Corman : celle des « Massacre« . Slumber Party Massacre (1982, 1987 et 1990), Sorority House Massacre (1986 puis deux volets en cette prolifique année 1990) et, tardivement, Cheerleader Massacre (2003 et 2011). Pour moitié, tout cela a été réalisé par des femmes -Corman étant un farouche paritaire avant l’heure-, l’autre moitié étant assurée par le prolifique mais limité Jim Wynorski. Signe que ces « Massacre » avaient abandonné toute trace d’ambition, s’ils n’en on jamais eu.





