Ça – Stephen King
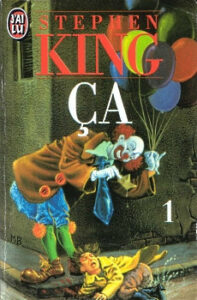 |
It. 1986Origine : Etats-Unis
|
« Ça fout les jetons ! » me disait récemment un camarade, rédacteur sur ce présent site. Et bien, effectivement, M. Arellano, Ça est considéré comme l’un des plus effrayants livres de son auteur. Il est vrai qu’il doit en partie sa notoriété à l’adaptation sous forme de mini-série qui en a été faite, très chaudement reçue par le public (bien que j’avoue ne pas vraiment comprendre la vigueur de cet engouement). Cela a certainement motivé la découverte du pavé écrit par King, et le livre étant ce qu’il est, c’est à dire nettement mieux que son adaptation, sa réputation s’est faite. Cependant, il ne faudrait pas réduire Ça à un livre d’angoisse. Cet aspect n’est qu’une partie, et pas forcément la plus réussie, du roman. On sait que Stephen King a toujours réservé à l’enfance et aux enfants une place de choix dans ses romans. Qu’ils soient héros ou victimes, voire les deux, les moutards de ses livres sont caractérisés par leur crédibilité. Ils sont faillibles et peuvent mourir dans d’horribles conditions (cf. le très dur Simetierre), comme tout un chacun. Ce n’est donc pas le fait de les mettre en avant par une glorification horripilante qui intéresse tant Stephen King. Pour lui, ils représentent plus un lien avec une époque révolue et un mode de pensée axé sur l’imaginaire qui s’oppose en de nombreuses façons avec les autres âges de la vie. A vrai dire, au fil de son imposante bibliographie, King a abordé à peu près tous ces âges et a même consacré un recueil complet, l’excellent Cœurs perdus en Atlantide, à nous décrire le passage du temps autour d’un seul personnage. Mais l’enfance semble être la période de la vie qui le fascine le plus, et Ça en est l’aboutissement.
En 1985, Mike Hanlon, bibliothécaire de la petite ville de Derry, Maine, prend la décision d’appeler ses six amis d’enfance pour leur rappeler la promesse qu’ils s’étaient faite en août 1958 : qu’ils reviendraient à Derry si « Ça » recommençait. Frappés durant toutes ces années d’une anormale amnésie concernant le sujet, les six « ratés », tels qu’ils se définissaient à l’époque, doivent se replonger dans leurs souvenirs, afin de se préparer à affronter Ça à nouveau. L’un d’entre eux, Stan, incapable d’y faire face, préfère se suicider.
En cet été 1958, Bill le bègue, Richie le binoclard, Eddie l’asthmatique, Ben le gros, Stan le juif, Beverly la gonzesse et Mike le noir formaient donc la bande des ratés de la ville de Derry, où tous les 28 ans environ une entité maléfique se réveille pour entamer une série d’atrocités, surtout perpétrées sur les enfants desquels elle se nourrit. En octobre 1957, les massacres avaient commencé par le meurtre sordide et non élucidé de Georgie, le petit frère de Bill, en réalité mutilé dans une bouche d’égout par un clown, forme que Ça revêt le plus souvent. Âgés de 11 ou 12 ans, les ratés s’étaient liés d’amitié, réunis par leur solitude mais aussi peut-être par la destinée. Car leur groupe fut appelé à affronter Ça, soudant entre eux une amitié intense née d’une convergence de préoccupations qui ne peut se résumer uniquement à ce monstre.
Voici un bien pâle résumé d’une intrigue dont toutes les composantes ne sauraient être condensées, pas même par une mini-série télévisée de trois heures pourtant caractérisée par une évidente volonté de fidélité. Elle n’a même pas couvert le tiers de l’étendue imaginative dont Stephen King a fait preuve dans son roman. Riche de mille et une petites histoires venant composer une ville-univers qui nous devient aussi familière que ne l’est Castle Rock (mais la « construction » de celle-ci a pris sept livres), Ça est bien autre chose qu’un roman de clown tueur. Ce dernier n’est guère plus qu’un socle commun permettant d’unifier toutes les peurs enfantines, et c’est très certainement la moins intéressante des formes que revêt Ça. La véritable nature de ce monstre se trouve dans chacun des enfants dont il croise la route. La raison de la peur qu’il inspire est qu’il matérialise les frayeurs profondes de ses proies, et qu’il les rend mortelles… Les peurs enfantines peuvent se baser sur une imagination fertile et sur une croyance en des choses ou des créatures dont l’impossibilité ou l’inexistence se révèle manifeste avec l’âge, mais dont la véracité demeure pour des enfants du domaine possible . C’est ainsi que Ça peut se transformer en monstre de cinéma, à savoir un loup-garou, pour terrifier et massacrer les jeunes spectateurs marqués par la vision d’un film d’épouvante (on ressent là une certaine implication autobiographique, et c’est loin d’être la seule fois). Ou au contraire, pour les enfants vivant dans un climat familial difficile, il peut aussi représenter la violence parentale, voire ce qui est peut-être encore pire, la provoquer (c’est sur ce terrain qu’il s’en prend à Beverly). Ou bien il peut prendre l’apparence d’un lépreux pour terroriser Eddie, hypocondriaque sous la contrainte d’une mère hyperprotective. Ou encore faire ressurgir des traumatismes oubliés (l’oiseau de Mike) ou tout frais (le meurtre de Georgie pour Bill)… Ses capacités n’ont pas de limite et touchent au plus profond de chaque gamin, ce que Stephen King s’emploie à faire ressentir en développant chaque personnage, y compris les victimes ne jouant pas de rôle majeur. Étant au centre du récit, les ratés ont pour leur part droit à de véritables biographies et analyses psychologiques, sans pour autant que cela ne devienne stérile, car King prend soin de ne parler que de ce qui fut, est ou sera utile.
Enraciné dans l’intimité de chacun, Ça l’est aussi dans la ville même de Derry. Toute cette ville est sous son emprise, c’est une ville hantée. Ce n’est pas seulement parce que Ça peut apparaître à n’importe qui, n’importe quand, sous n’importe quelle forme, mais c’est aussi parce que tout ce qui s’y déroule se passe dans un relatif anonymat. Les gens sont influencés par le mal de leur ville, ils ferment les yeux sur les évènements les plus monstrueux et se sont accoutumés aux faits étranges qui s’y déroulent régulièrement. Un gamin comme Henry Bowers, le caïd de l’école en bisbille avec les ratés, devient même l’émissaire de Ça. Comme à son habitude King créé de toute pièce une communauté, avec une exhaustivité peut-être seulement égalée par Le Fléau. A travers les intermèdes rédigés par Mike Hanlon, historien de la ville et de Ça, il lui fabrique même un passé sanglant, en s’attardant bien sûr sur chaque sortie de Ça depuis le début du XXème siècle. Le but d’une telle méticulosité est bien entendu de diaboliser la ville, mais elle relève aussi d’un procédé stylistique : elle permet d’enfermer les ratés au sein de leur groupe, de les isoler du reste de cette ville acceptant le mal sans même s’en rendre compte. Par la conscience du mal qu’ils ont acquise, leur solidarité s’en trouve renforcée, tout en rendant le roman encore un peu plus inquiétant. Et puis il y a également là dessous une portée symbolique : l’indifférence des adultes et leur incapacité à comprendre le raisonnement des enfants, de les prendre au sérieux. Ce qui nous amène donc à l’âge « adulte » du club des ratés.
Pour vaincre Ça, il n’y a pas 36 solutions : il faut se remettre dans la tête des enfants qu’ils furent. Car si leurs croyances naïves permettaient au monstre de les pourchasser, elles permettaient également de le combattre. Par exemple, la force d’une balle d’argent est intrinsèquement liée au mythe du loup-garou, et bien plus que la balle en elle-même c’est la foi en son utilité qui la rendait potentiellement létale. Ça mise sur le passage à l’âge adulte pour laver l’affront qui lui fut fait naguère. En devenant adultes, les ratés ont de fortes chances d’avoir modifié leur façon d’aborder l’imaginaire. Ils gardent leurs peurs, mais seraient dorénavant désarmés face à leurs concrétisation. En dominant Bowers et ses copains à de multiples reprises, ils ont pris confiance en eux, sont devenus plus durs, et avoir (temporairement) vaincu Ça leur a attiré la bonne fortune d’une étrange façon qu’ils reconstitueront lors de leur rencontre. Pour autant, ont-ils bien cessé d’être des ratés ? Il faut bien l’avouer, la partie des adultes est nettement moins attractive que celle des enfants, du moins en ce qui concerne la confrontation avec Ça. En revanche, elle est intéressante d’un point de vue plus « auteurisant ». C’est le lien créé entre cette époque et le passé qui permet à Stephen King d’exprimer clairement sa vision de l’enfance, et le lien qu’il entretient avec elle. Il s’agit d’une hantise permanente logée dans le subconscient. Les ratés ont progressé depuis 1958, ils ont pratiquement tout oublié de cet été là, mais ils n’ont pas rompu avec cette période. Ainsi, de nombreux éléments de leur vie proviennent de leur enfance, qu’ils en aient conscience ou non : Eddie le souffreteux s’est marié à une femme aussi névrosée que sa mère, Beverly a épousé un homme aussi violent que l’était son père, dans ses romans (puisqu’il est écrivain) Bill ne cesse de rejouer les drames de Derry, les constructions de Ben l’architecte ne font que reproduire certains lieux de la ville… Revenir se confronter à Ça et à Derry leur permettrait, du moins si ils sont vainqueurs, de couper ce cordon ombilical qui les a toujours empêché de passer définitivement à autre chose. Fait symbolique, aucun d’entre eux n’a d’enfant… comme si ils n’étaient pas mûrs pour cela. Ils ne sont pas en paix avec leur passé, ce qu’on peut attribuer à leur incapacité à achever définitivement leurs némésis (puisque ni Ça ni un Henry Bowers envoyé depuis à l’asile ne les ont oubliés). Il y a quelque chose de très freudien dans ce retour vers le passé pour lutter contre de vieux démons mal évacués. Il n’est guère étonnant que l’antre de Ça se trouve dans les égouts : il s’agit de la partie la plus sombre et la plus labyrinthique de la ville où tous les déchets sont évacués. Ça -et tous les traumatismes qu’il représente- n’a pas été détruit, il reste dans les égouts. Le travail se doit donc d’être achevé, ce qui ne pourra se faire qu’en retournant en enfance et en affrontant ses frayeurs. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une introspection, que Stephen King conduit brillamment en faisant se succéder les chapitres de 1958 et ceux de 1985 jusqu’à un final très hallucinatoire où les deux affrontements pourtant séparés de 28 ans s’intercalent l’un dans l’autre.
Ça n’est pas loin d’être le meilleur livre de Stephen King. Du point de vue de l’épouvante et de l’horreur, c’est un livre qui va très loin dans l’analyse de la peur et qui prouve sa justesse de vue par les résultats qu’il obtient, sans négliger à certaines occasions de se montrer carrément malsain (l’épisode sur un certain Patrick Hockstetter). Thématiquement, c’est d’une richesse appelant à le lire et à le relire. Stylistiquement, cet entrecroisement d’époques et de faits est mené de main de maître, et le choix d’un narrateur omniscient permet d’appréhender comme elle le mérite la ville effrayante de Derry. Enfin, et c’est peut-être sa plus grande qualité, Ça nous attache à ses personnages, auxquels il est facile de s’identifier. King a incontestablement ménagé une place pour que ses lecteurs se sentent directement impliqués. Les ratés ne sont rien d’autre que des gamins classiques, certainement pas des gamins au profil hollywoodien, et leurs expériences (les surnaturelles exceptées, encore que certains y verront peut-être leurs propres peurs), leur vie avec ses aspects négatifs et même positifs, bien qu’elles se déroulent dans les années 50, ont forcément des points communs avec la vie de n’importe quel enfant. Ça est un livre qui ne prône pas le syndrome de Peter Pan, bien au contraire, c’est un livre qui affirme non sans une certaine violence qu’il faut savoir en terminer avec cette époque pour mieux en garder une saine nostalgie.

