Nuit noire, étoiles mortes – Stephen King
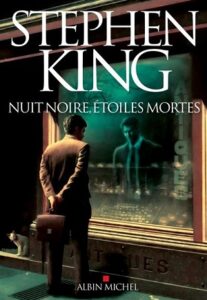 |
Full Dark, no stars. 2010Origine : Etats-Unis
|
A peu de choses près, tous les dix ans, Stephen King nous sort une collection de novellas, ces histoires trop longues pour être des nouvelles et trop courtes pour être des romans. Il y eut d’abord Différentes saisons en 1982, puis Minuit 4 (divisé en deux chez J’ai lu) en 1990, et enfin Cœurs perdus en Atlantide en 1999. Trois livres pour un bilan largement positif. Sans être brillant de bout en bout, Minuit propose des histoires accrocheuses, finalement assez dignes d’être comparées aux recueils que sont Danse macabre, Brume ou Rêves et cauchemars. C’est à dire que le livre contient des récits variés (horreur, science-fiction, thriller) qui ne semblent être que des nouvelles ayant eu tendance à enfler. En revanche, les deux autres collections de novellas se démarquent de ce simple empilement d’histoires en possédant une vraie cohérence interne, voire même une unité en ce qui concerne le méconnu Cœurs perdus en Atlantide. Dans les deux cas, King n’aborde pas le fantastique pour le simple plaisir de faire du fantastique, et encore moins de l’horreur (certaines nouvelles ne sont même pas du genre fantastique). En 1982, il adopte un style intimiste pour quatre récits tout en gravité et en introspection, parcourus par une certaine poésie liée aux souvenirs personnels. Rebelote en 1999, et cette fois il se permet même le luxe de relier ouvertement les quatre histoires par la présence obsédante d’un seul personnage qui n’est jamais le protagoniste principal mais qui constitue malgré tout la clef de voute du livre entier. Différentes saisons comme Cœurs perdus en Atlantide se forment en fait autour du thème du temps, que ce soit les saisons pour le premier ou la vie d’un être humain pour le second. Très ambitieux et très réussis, ces deux opus comptent parmi ce que King a fait de mieux. En publiant Nuit noire, étoiles mortes plus de dix ans après sa dernière collection de novellas, King ne peut ignorer que ce format fait naître d’autres attentes que celles de ses recueils standards. Peut-être même l’utilise-t-il désormais uniquement dans le but de répondre à ces attentes. Cependant, vu la nature très personnelle de Différentes saisons et de Cœurs perdus en Atlantide, il peut difficilement se lancer dans cette entreprise sans disposer d’un matériau digne des ses prédécesseurs. Voyons voir ce qu’il en est.
Dans « 1922 », King prend pour cadre la campagne du Nebraska, près de Hemingford Home, lieu connu des lecteurs du Fléau puisque Mère Abigaël vivait dans le coin. Toutefois, en dehors du fait que l’action se déroule dans une ferme au milieux des champs de maïs, pas grand chose ne relie cette novella au roman publié en 1978. Contée en 1929 par un narrateur proche de sa fin, l’histoire se déroule comme le titre l’indique en 1922. Il s’agit d’un fait divers qui pourrait passer pour relativement quelconque si King n’avait pas pris pour point de vue la confession de Wilfred James, lequel assassina sa femme Arlette en 1922 avec l’assistance de son fils Henry. Décidé en raison du conflit foncier opposant le couple (elle veut vendre et partir en ville, lui est solidement attaché à sa terre), ce meurtre a miné Wilfred et Henry et les a conduits là où ils sont, c’est à dire dans un hôtel minable pour l’un et dans un cimetière pour l’autre. Il s’agit d’un cas de hantise, mais pas vraiment une hantise à base de fantôme : une hantise psychologique conduisant à la déchéance. Plus que son spectre, c’est le souvenir de Arlette et du meurtre sordide dont ils se sont rendus coupables qui poussèrent le père et le fils dans la misère. L’élément fantastique, minime, tient dans la présence de rats symbolisant la survivance du soir fatidique. Après avoir égorgé avec bien du mal leur victime, les deux James jetèrent son corps dans un puits abandonné, dans lequel ils firent ensuite tomber une vache avant de le remblayer. Mais entretemps, en jetant un coup d’œil, Wilfred y aperçut les rats, venus faire leur festin des restes de madame et qui n’allaient plus sortir de la vie de monsieur, au point que ce dernier vit en eux les émissaires du spectre de son épouse. Mythe ou réalité, cela reste globalement ambigu. Peu importe, de toute façon : l’important est que les rats symbolisent cette hantise venue attirer la famille James au fond du trou. Car c’est bien de cela dont parle King dans cette nouvelle. Davantage encore que le meurtre en lui-même. Le récit de cet instant est détaillé, très cru, mais dans l’optique d’en faire l’obsession de Wilfred et de Henry, les rats en étant l’élément le plus évident. Tout le reste, qui peut se résumer en l’acharnement du sort, en découle. Aucune des mésaventures qui arrivent aux deux assassins n’est en soit extraordinaire : Henry faisant un enfant à sa copine et voisine, l’animosité qui en sort avec le voisin jusqu’ici ami des James, aggravée par la fuite criminelle des deux tourtereaux, les ennuis financiers, les ennuis de santé… Rien que de très classique. En revanche, la plongée dans la misère interpelle. D’une part d’un point de vue social, car indépendamment du meurtre King évoque la crise du monde rural en ces années 20 qui a effectivement produit de grands drames dont celui-ci n’est finalement pas très différent, puisque l’on y retrouve les manœuvres des banques et des grands industriels pour spolier les petits paysans, mais aussi (pour la destinée de Henry) la morale rigide de l’époque capable de plonger une famille dans la détresse. En un sens, l’assassinat d’Arlette peut être placé à un point de vue symbolique, si l’on considère que l’épouse incarnait les ambitions citadines, consuméristes et bourgeoises, en opposition à celui des paysans refusant une modernité signifiant le déracinement. Le meurtre a donc établi le refus définitif de cette modernité. Sauf que l’on ne peut échapper au mouvement, et que par conséquent les deux James se sont retrouvés acculés, puis broyés. Humainement, King cherche à faire naître la compassion, ce qu’il parvient à faire sans jamais verser dans le pathos. Son style d’écriture n’y est pas pour rien. Wilfred, le narrateur, a bien conscience d’avoir lui-même provoqué l’élément déclencheur de ses propres ennuis, et d’avoir entraîné à sa suite son fils profondément transformé. De fait, il est atteint d’une forme de résignation et de désolation qu’il ne fait peser que sur lui-même, avant même d’incriminer le voisin, les banques, la police, les rats ou quiconque aurait pu lui servir de bouc émissaire. Venant en complément du point de vue social, l’aspect humain est la seconde facette de ce drame. Et cela parce que ni Wilfred ni Henry ne sont de mauvais bougres, alors qu’ils sont bel et bien des meurtriers, ayant agit d’une façon inexcusable et qu’ils regrettent sitôt le méfait accompli. Le conflit venant les ronger les rend étranges, un peu à la façon des personnages minables des films noirs signés par les frères Coen, que l’on ne peut ni pleinement prendre en affection ni totalement rejeter.
Bien écrite, sensible tout en étant raisonnée, « 1922 » est une bien belle novella, très sombre. Évidemment, King n’est pas Steinbeck, mais il n’empêche qu’il ouvre son livre par une louable surprise.
« Grand chauffeur » nous ramène au présent, et aborde un style d’horreur différent. Cette fois, le fantastique n’y est même plus un symbole : il en est purement et simplement absent. King se frotte à ce que l’on appelle au cinéma le « rape and revenge ». L’histoire est assez simple : de retour d’une conférence donnée dans un bibliothèque, Tess, écrivain de romans policiers à succès, s’engage dans un raccourci que lui a suggéré la bibliothécaire. Des clous sur la chaussée font crever ses pneus. Un « grand chauffeur » se propose de l’aider, mais la viole et l’étrangle, la laissant pour morte dans une canalisation où se trouvent d’autres cadavres de femmes. Décidée à se venger, Tess cherche alors à retrouver la trace de son agresseur.
Là encore, on ne peut pas dire que ce soit l’originalité qui étouffe King. Et là encore, les détails glauques sont employés de façon à orienter l’état d’esprit de l’héroïne, et par ricochet le style d’écriture. C’est que « Grand chauffeur » ne se veut pas une novella d’exploitation scabreuse, mais bien un drame humain intimiste dans lequel King recherche la crédibilité avant le sensationnel. D’où un net penchant pour la psychologie de sa protagoniste face au viol et à la tentative de meurtre dont elle a été victime. Le sentiment d’être sale, le dégoût, la honte (accentuée par sa notoriété et donc les retombées médiatiques si l’affaire venait à être connue), la colère de celle qui n’a rien à perdre et qui veut également éviter la récidive pour d’autres femmes… Tel est le cheminement suivi par Tess expliquant qu’elle recherche la vengeance plus que la la justice civile. Ce biais personnel permet aussi d’éviter le syndrome « Un justicier dans la ville« , avec les manipulations sentimentales et le sous texte politique sécuritaire qui sous-tendent ce genre de productions. Au point où Tess en est arrivée, n’étant plus que le fantôme d’elle-même, repliée dans sa carapace pour se remémorer sans cesse le viol (via les détails avec lesquels King l’a évoqué), elle s’engage à jouer à quitte ou double. Bien que King ait de toute évidence voulu soigner l’évolution psychologique de son personnage, on ne peut pas dire que la réussite soit éclatante. N’étant pas particulièrement au fait de la psychologie des victimes de viol, je me garderais bien d’émettre un jugement sur la véracité de celle de Tess. En revanche, il règne une certaine précipitation dans le récit qui empêche le tout d’être vraiment convaincant. D’autant plus que si King évite l’exploitation, il n’évite pas d’avoir recours à l’action lorsque le moment s’y prête, avec les quelques rebondissements d’usage (les éventuelles complicités de la bibliothécaire et du frère du chauffeur) qui certes lui servent à continuer sa réflexion sur la psychologie -on ne peut pas vraiment parler de scènes gratuites- mais n’aident pas au réalisme. Il faut dire que ce défaut, King l’avait bien cherché en doublant son histoire par une hardie comparaison entre fiction et réalité. Profitant du fait que son héroïne soit écrivain -comme souvent chez lui-, il truffe les passages d’action de suppositions sur ce qui arriverait dans un film ou un livre, et compare cela à ce qui arrive dans la réalité à Tess. Dans la plupart des cas, la réalité colle à la fiction. C’est même après avoir vu La Dernière maison sur la gauche et À vif que Tess se sent prête à aller au bout. Il est facile de voir là où King veut en venir : dans certaines circonstances, la réalité peut rejoindre la fiction. Le problème étant que sa novella finit par se déséquilibrer, et malgré les efforts déployés « Grand chauffeur » laisse une impression d’histoire crue mais dense jusqu’au point de devenir un peu factice. Trop en tous cas pour être le modèle de réalisme glacial qu’elle promettait d’être au début.
« Extension claire » est la nouvelle la plus proche du genre fantastique. Encore qu’il s’agit ici d’un fantastique de prémices ne servant qu’à établir une situation où King fera bien autre chose que du fantastique. Atteint d’un cancer ne lui laissant guère d’espoir, Dave Streeter croise le chemin d’un certain George Dabiel, qui lui propose la guérison moyennant finances et surtout, moyennant l’évocation de ses haines. Car le mal qui ronge Dave ne va pas vraiment disparaître : il va être transféré à son ennemi le plus proche. L’infortuné remplaçant se nomme Tom Goodhugh, et c’est en principe le meilleur ami de Dave. Celui-ci a en fait toujours été jaloux de la réussite insolente de Tom, qui lui a piqué sa fiancée et en a fait sa femme lors de leurs années d’étudiants, se construisant une vie de rêve tout en continuant à porter à Dave une amitié semblable à celle qu’un fort porterait pour un faible.
Récit sur la bassesse humaine, « Extension claire » explore le côté sombre d’un homme aigri au dernier degré jouissant secrètement de voir son fantasme se réaliser. Car Tom n’a pas hérité du cancer qui rongeait Dave, mais peut être de quelque chose d’encore pire : il voit sa vie familiale et professionnelle jusqu’ici florissante partir en lambeaux sous le coup de ce qui apparaît comme l’acharnement du sort. Rien de ce qui lui arrive n’est hors norme. La maladie de ses proches, les accidents, les affaires qui partent à vau-l’eau… De son point de vue, c’est la loi des séries, ce qui en soit se révèle bien plus sordide qu’une quelconque malédiction à base de démons. King ancre son histoire une nouvelle fois sur le réalisme, avec comme but avoué de déranger, et de retourner le ressenti de ses lecteurs faces à des personnages il est vrai un tantinet mal dégrossis. Au départ, la compassion allait pour Dave et l’animosité pour Tom. Puis les choses s’inversent et dépassent même la symétrie des situations respectives. C’est cette fois à Dave de connaître la réussite et d’afficher pour son ami une pitié d’autant plus humiliante qu’elle est complétement simulée. Il en devient encore plus imbuvable que Tom, qui au départ n’avait pas de haine consciente pour Dave, lequel avait d’ailleurs un peu trop tendance -par jalousie- à faire retomber sur son ami la responsabilité de ses propres échecs. C’est ainsi que King rédige sa novella, afin d’en faire le point de vue hypocrite de son héros fanfaronnant en son for intérieur. « Extension claire » respire donc la méchanceté, non pas cette méchanceté trempée dans l’humour noir caractérisant bien des écrits de l’écrivain, mais une méchanceté misanthropique censée mettre mal à l’aise. Et la novella fait traîner cela en longueur, ajoutant toujours plus de drames à la vie de Tom, et toujours plus de bonheur à celle de Dave. Une fois le principe cerné, cela reste assez répétitif, et bien que celle novella soit d’assez loin la plus courte des quatre elle aurait probablement gagné à être condensée. Histoire d’éviter de charger la mule. Mais après tout, cette insistance sur les mésaventures de Tom rappelle l’origine fantastique de cette déchéance orchestrée par un George Diabel (Elvid en anglais) dont la nature n’échappera pas aux amateurs d’anagrammes. Le mythe du pacte avec le diable en perd son côté moraliste, puisque cette fois ci le vendeur n’est nullement promis à la damnation, laquelle échoit à un bougre qui n’avait rien demandé.
Enfin, « Bon Ménage » clôt le recueil avec une histoire simple et inspirée d’un fait réel (le cas Dennis Rader) : Darcy et Bob Anderson vivent une vie saine et épanouie, avec de beaux enfants volant de leurs propres ailes, jusqu’à ce que Darcy se rende compte que son mari est un tueur en série. King y aborde le sujet de la connaissance d’autrui, jamais intégrale, ce qui en un sens prolonge le thème de « Extension claire ». Si l’auteur évoque bien les meurtres perpétrés par Bob avec les détails sordides qui vont avec, ce n’est encore une fois que pour mieux faire ressurgir l’horreur ressentie par Darcy, laquelle n’a jamais perçu le moindre indice laissant à penser que son mari puisse être le fameux « Beadie » dont les meurtres défraient régulièrement la chronique depuis une trentaine d’années. Au contraire : homme raisonnable, doux et aimant, passionné de numismatique au point d’en avoir fait son métier, Bob est à ses yeux le mari et le père de famille parfait. Ce qu’il ne cesse de vouloir être même après que Darcy soit tombée sur son secret par hasard, en faisant un peu de rangement dans le garage. En s’immisçant dans les pensées de sa principale protagoniste, King nous confronte au dilemme vécue par elle, c’est à dire mettre un terme brutal à une union parfaite pour des raisons certes très graves mais qui en un sens ne la touchent pas d’un point de vue personnel. La question est de savoir si Darcy est prête à faire une croix sur sa propre aspiration au bonheur par devoir envers la société. Si oui, cela veut dire qu’elle se condamne également, et par ricochets, ses enfants. C’est donc une histoire avant tout personnelle que King mène avec sobriété et sensibilité, sans effet choc et sans faire ne serait-ce qu’une once de morale. Il n’y a que la psychologie d’une femme qui le motive ici, au risque de provoquer une controverse (ce qui n’a pas été le cas). Afin de mieux éviter tout effet sensationnel, il se détache -et Darcy avec lui, vu que la police ne semble pas prête d’appréhender Beadie- des pressions sociales, laissant véritablement la place à la réflexion. Il n’y a pas péril en la demeure, et Bob, après avoir brossé son historique et ses motivations, a même juré de combattre ses démons, acceptant de payer le prix d’une nouvelle faiblesse. Il n’y a donc qu’une froide torture mentale se déroulant dans un même cadre demeuré inchangé, en compagnie d’un homme qui lui non plus n’a pas changé. Après tout, il était déjà tueur avant de rencontrer Darcy… La véritable différence demeure cette brutale révélation et tout ce qu’il y a derrière. L’isolement est absolu, le ton est intimiste, et la personnalité de Bob, sympathique (si ce n’est pour la nuit de ses aveux à Darcy, où tout en restant pacifique montre une inquiétante folie), met mal à l’aise. Montrer un tueur sous un jour anodin est une bonne idée, pas forcément originale, mais une bonne idée tout de même que King exploite en ayant à l’esprit la réaction des proches de tueurs. Tout ceci conduit encore à une histoire bien triste, très sombre, mais qui paradoxalement, se solde par un happy end, aussi amer soit-il.
La cohérence de Nuit noire, étoiles mortes se trouve donc dans cette noirceur systématique à chaque fois traitée d’un point de vue intimiste. Doté de cette vision globale, King s’inscrit dans la tradition de Différentes saisons et de Coeurs perdus en Atlantide. L’ambition est là, l’inventivité se retrouve dans les points de vue (faire passer des méchants pour des gentils ou inversement), la profondeur aussi même si parfois approximative… Toutefois, le recueil n’est pas au même niveau que ses deux prédécesseurs. Cela est du au fait que Nuit noire, étoiles mortes ne puise pas sa source dans la vie de King lui-même, et que de ce fait l’auteur a parfois du mal à rester dans les limites du réalisme sordide, ayant alors recours à des tours de passe-passe. Pour faire simple, Nuit noire, étoiles mortes est globalement un bon livre, pétri de bonnes idées, mais auquel il manque un certain panache pour être en mesure d’exploiter toute la détresse humaine qu’il voulait dépeindre.

