Delirium – Charles Winkler
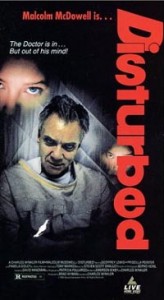 |
Disturbed. 1990Origine : Etats-Unis
|
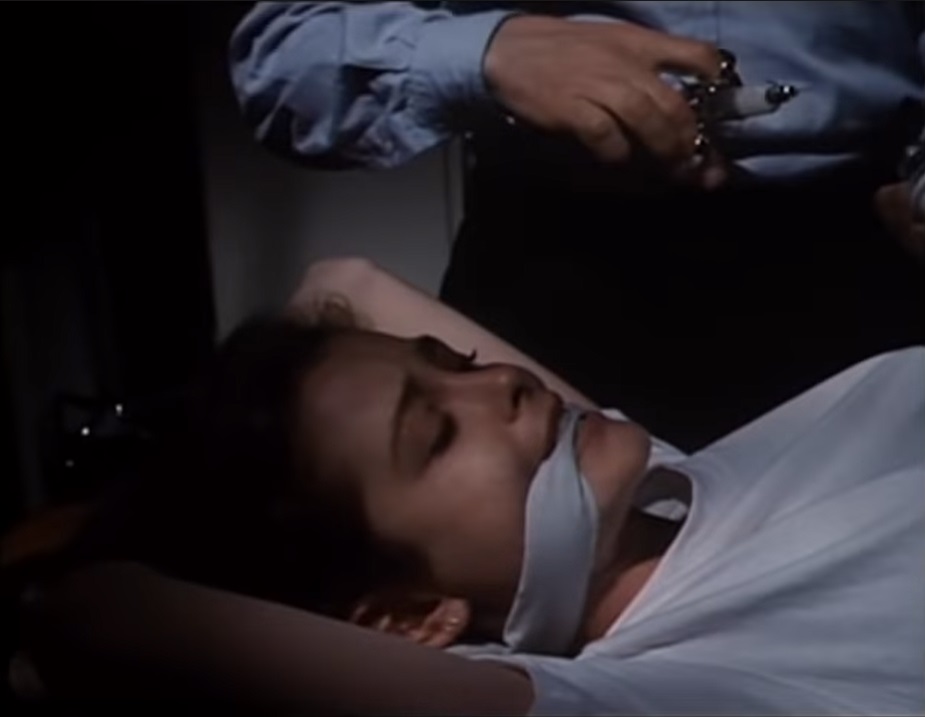
A la tête d’un établissement psychiatrique privé, le Dr. Derrick Russell (Malcolm McDowell) fait ce qui lui plait avec ses patientes. C’est à dire qu’il les viole après les avoir drogué. Lorsque l’ex mannequin fougueuse Sandy Ramirez (Pamela Gidley) est internée dans sa clinique, il fonce tête baissée. Ce qui lui vaut de confondre la drogue habituelle avec la pénicilline, à laquelle Sandy est allergique. Paniquant devant les convulsions de sa patiente, il accueille favorablement l’arrivée dans la pièce de Michael Kahn (Geoffrey Lewis), un patient aux pulsions homicides qui lui conseille d’injecter une dose fatale à la jeune femme, de la ramener dans sa chambre, et de faire passer cela pour suicide. Le lendemain, au petit déjeuner, Sandy n’est pas à table. C’était prévu. Mais elle n’est pas non plus dans son lit, et ça, ça l’est beaucoup moins. Le Docteur est alors obligé de faire équipe avec Michael afin de retrouver le cadavre avant que la police ne s’intéresse à cette disparition. Pris d’hallucinations, il en vient petit à petit à perdre l’esprit…

Être le fils d’un producteur influent, ça aide. C’est ainsi que Charles Winkler commença sa formation en se retrouvant sur les plateaux de Martin Scorsese (New York, New York, Raging Bull) et qu’il finit bien des années plus tard à succéder à son papa Irwin pour la production de Rocky Balboa, dernier né de la franchise familiale. Sa carrière de producteur avait été toute tracée. En revanche, pour devenir réalisateur, il démarra comme tout le monde : dans la série B. Delirium est son second film, et à défaut de marcher sur les traces des grands films de studio auxquels son paternel l’avait habitué, il peut s’enorgueillir de disposer de Malcolm McDowell en tête d’affiche. Un nom vendeur dont la présence s’explique aussi par l’ironie que constitue le rôle d’un psychiatre dégénéré pour l’homme qui souffrit tant et plus dans la peau d’Alex, le criminel martyrisé par les scientifiques d’Orange Mécanique. Le casting inclue aussi du joli monde, adapté aux circonstances : Priscilla Pointer reprend du service dans le rôle d’une médecin vacharde, ce qu’elle était déjà dans Les Griffes du cauchemar, et Clint Howard ramène sa trogne de cinglé pour incarner l’un des patients. On y trouve aussi Deep Roy, le nain chanteur du Big Fish de Tim Burton.

Série B, donc, mais pourtant objectif hitchcockien d’un film reposant sur un cadavre disparu. Un sujet bourré d’humour très noir dans lequel le psychiatre pervers se trouve à la merci d’un de ses patients, Michael, véritable tête pensante d’un duo homicide. Car là où le docteur perd ses moyens mentaux face aux pressions, le malade affiche un flegmatisme qui fait de lui l’élément « sain » du complot. En adoptant un style très « british » avec fine moustache et veston démodé (on se prend à songer aux membres du gang des Pirates du métro), Geoffrey Lewis donne la réplique à Malcolm McDowell, dont le visage marqué et le regard noir que Kubrick avait si bien su mettre en valeur deviennent progressivement non plus des éléments de sadisme, mais des éléments d’une folie de plus en plus évidente. Saluons la magnifique prestation de McDowell, qui retranscrit cette folie croissante aussi bien ouvertement (en privé avec Michael ou d’autres patients) que secrètement (face à ses collègues, à la police ou aux familles). Ainsi sa performance se trouve sur deux niveaux. D’un côté, le fou furieux qui s’en va creuser dans le jardin en pleine nuit avec Michael, et de l’autre le directeur d’asile qui maintient une bonhommie imbécile pour préserver des apparences qu’il ne fait que détruire davantage. Le meilleur du film est atteint lorsque les deux commencent à fusionner, comme par exemple avec la plongée pieds joints du docteur en plein milieu d’un bassin pendant un après midi « portes ouvertes ». Il avait cru voir le corps de Sandy au fond de l’eau, et il n’a pu se retenir… Sur lui pèse la responsabilité du crime, le regard de ses collègues, les doutes de la police et les interrogations des patients, qui pour être dérangés n’en comprennent pas moins les modifications du comportement de leur médecin.

Winkler s’immisce donc dans l’esprit du Dr. Russell, le fait agir sur des coups de tête et truffe ainsi son film de surprises humoristiques ou macabres. Bien ficelé, le scénario fait aussi intervenir un autre patient, celui-ci nettement plus fou que le bon Michael, qui se souvient avoir enterré le cadavre de Sandy sans pour autant se souvenir avec exactitude de l’emplacement. Et le voici qui promène donc Russell à travers la propriété, lui indiquant des endroits saugrenus parce qu’il a enterré la fille sous un oiseau et lui faisant creuser dans le vide, ce qui a pour conséquence d’entrainer la fureur du médecin, qui se met à gérer son établissement en tortionnaire. L’humour est véritablement noir, puisqu’en devenant fou, Russell devient de plus en plus ignoble avec ses patients, lesquels le font tourner en bourrique et se moquent même de son stress permanent. En clair, le psychiatre s’abaisse au même niveau que ses pensionnaires, voire en dessous puisqu’il est dominé par Michael. Le voir revêtu de son pyjama en train de piquer une crise de nerf dans la chambre capitonnée tandis que le flegmatique psychopathe essaie de lui remonter le moral est un vrai délice porteur de sens. Winkler mène sa barque avec brio, doublant généralement son excellent scénario d’une mise en scène très surréaliste, assez proche de celle des gialli italien par l’usage d’effets baroques du plus bel effet. Que ce soit le cadrage, le montage, les effets d’optiques, les effets sonores, toute la mise en contribue à décrire l’état d’esprit confus du Dr. Russell. Le réalisateur agit méticuleusement, mais avec un sadisme absurde parfois à la lisière des Monty Python, témoin cette scène du télégramme chanté tout droit sortie du Brazil de Gilliam. Et là encore, loin d’être gratuit, ce gag marque l’accentuation de la folie du personnage, qui n’est alors plus sûr d’avoir effectivement tué sa patiente, laquelle est la signataire dudit télégramme.
La seule chose pouvant être reproché à Delirium est la facilité de son dénouement, annoncé dans l’introduction. Autrement, il s’agit d’un film tout simplement brillant, à classer dans le voisinage de L’Antre de la folie au rayons des « films fous ».





