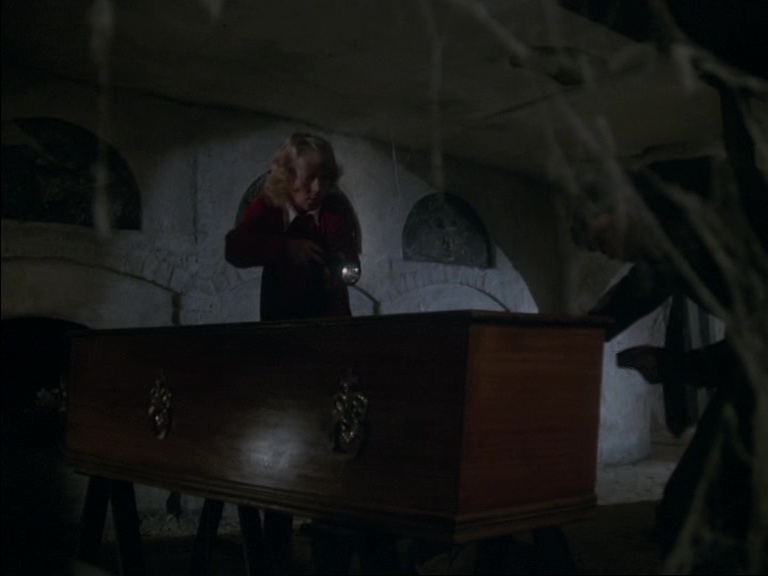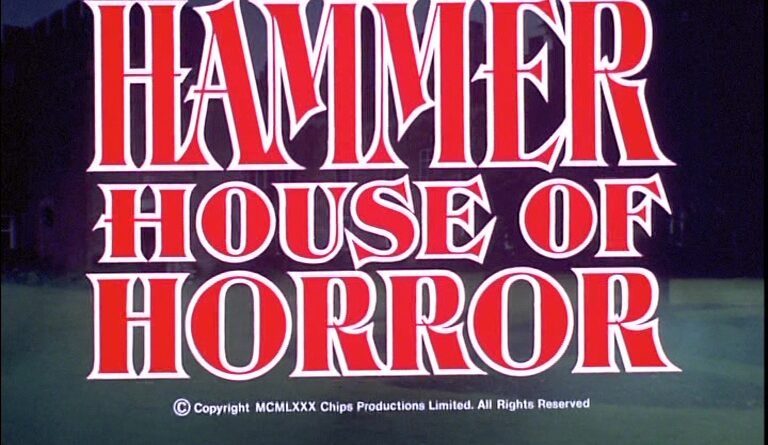Hammer, La Maison de tous les cauchemars. Episode 2 : La Treizième réunion – Peter Sasdy
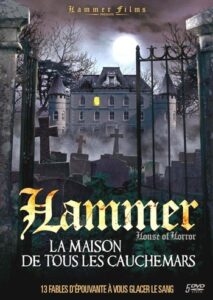 |
Hammer House of Horror. Episode 02The Thirteenth Reunion. 1980.Origine : Royaume-Uni
|
Ayant entendu dire que les méthodes employées au centre d’amaigrissement Chesterton n’étaient guère recommandables, la patronne d’un magazine y envoie une reporter grimée en patiente. Cela n’est guère gratifiant pour Ruth, mais si elle veut un jour faire du grand journalisme, elle n’a d’autres choix que de se plier à la demande… Sur place, il est vrai que les méthodes humiliantes ont de quoi choquer. D’autant que certains patients sont félicités de leurs progrès « psychologiques » à grand coup de victuailles… C’est le cas de Ben, un homme timide avec lequel Ruth se lie très vite d’amitié et plus si affinité. Affinité il y a bien, mais leur relation sera de courte durée puisque le soir même de leur premier flirt, la voiture du gars s’encastre dans un arbre. Après les obsèques, un jeune employé des pompes funèbres contacte Ruth pour lui faire part des actes étranges de ses patrons, qui pour la seconde fois ont voulu prendre eux-mêmes en charge les soins d’un des patients de la clinique. Il y a anguille sous roche…

Deux épisodes de la série Journey Into the Unknown (dont un recyclé dans un long-métrage à sketchs baptisé Journey Into Darkness), Une messe pour Dracula, Comtesse Dracula et La Fille de Jack l’éventreur pour la Hammer. Nothing But The Night et Evil Baby pour la Rank. Doomwatch pour la Tigon… S’il n’est pas exactement au même niveau quantitatif ou qualitatif que Terence Fisher, Roy Ward Baker, John Gilling ou Freddie Francis, Peter Sasdy reste malgré tout une figure de la Hammer et du cinéma de genre britannique. C’est donc avec soulagement que l’on voit son nom au générique de plusieurs épisodes de La Maison de tous les cauchemars. Il faut dire que dans le cas de La Treizième réunion, il a la lourde tâche de remplacer Terence Fisher, décédé peu avant le tournage. Il faut croire qu’il aurait été malvenu de confier le poste à un novice… Et pourtant, ce second épisode n’a pas spécialement de quoi rappeler la grande époque. Écrit par Jeremy Burnham, co-auteur d’une série horrifique pour enfants (Children of the Stones, visiblement fort appréciée outre-Manche mais qui ne semble pas avoir débarqué sur le continent), il ne compte à son casting aucun nom ronflant. Un « Droog » de Orange Mécanique par-ci, un ancien des Femmes préhistoriques par-là, et une tête d’affiche qui écume la télévision britannique. Et surtout, son intrigue reste encore largement ancrée dans son époque de réalisation, bien éloignée de ce qui a fait la renommée du studio. C’est ainsi que l’épisode s’ouvre sur une criante satire de la misogynie ambiante. A raison, Ruth n’est guère contente d’être cantonnée dans des pages féminines où les reportages frivoles témoignent du peu d’estime que porte le monde de la presse au lectorat féminin. Après tout, il n’y a pas de pages masculines, ceux-ci n’étant visiblement pas demandeurs de sujets légers et nombrilistes. Et puis l’envoyer dans une clinique d’amaigrissement comme patiente, quel affront ! D’autant que c’est une femme qui l’y envoie. Ce n’est pas avec ce genre de directrice que la cause progressera. Pire encore, si cela est possible : dès sa première réunion à la clinique, Ruth assiste médusée à l’humiliation publique d’une femme en surpoids à laquelle un mâle viril balance tout un tas d’horreur telles que « votre mari n’a pas envie de rentrer chez lui pour ne pas voir un tas de graisse »… Bref, La Treizième réunion frappe fort dans son entame et pousse la misogynie très loin. Ses excès font rire jaunes, et s’ils ne sont absolument pas typés « Hammer Films », ils sont pourtant bien vus. D’autant que la personalité piquante de Ruth, qui se double d’un sens certain de la solidarité (y compris envers les hommes), a de quoi faire dérailler le train bien huilé des convenances. Et puis l’épisode part incompréhensiblement dans tout autre chose consistant à relier la mort du copain de Ruth à un prégénérique nous montrant deux gus en train de découper un cadavre.

Inconsistant, La Treizième réunion ne sait pas exactement où il veut aller. Ce en quoi il ressemble d’ailleurs un peu au premier épisode, qui de façon moins marquée affichait potentiellement lui aussi des vélleités féministes avant de vouloir singer les productions Hammer de la grande époque. Il s’agissait alors d’une histoire de sorcellerie. Ici, comme l’un des protagonistes le mentionne, il s’agit d’une répétition contemporaine du cas de Burke et Hare, c’est à dire un trafic de cadavres. Mais encore faut-il le prouver ! C’est ce que Ruth, bientôt aidée par le jeune employé des pompes funèbres, va s’évertuer à faire. Ce faisant, cet épisode se transforme alors ni plus ni moins qu’en un épisode de série policière : son enjeu consiste à relier le point A du prégénérique au point B, c’est à dire le lien entre les morts et la clinique. Une investigation qui ne brille guère par son côté recherché : la personnalité de Ruth s’efface devant sa filature, et son charisme devant le manque de maîtrise d’un scénario qui ne fait guère de surprise. La manigance n’étant pas élaborée, les spectateurs ont toujours un train d’avance sur les protagonistes et passent donc leur temps à attendre que ceux-ci soient arrivés aux conclusions qu’ils ont eux-mêmes tirés des grosses ficelles de cette machination et des moyens hasardeux par lesquels Sasdy la fait avancer (rien que le fait d’avoir fait démarrer l’épisode par les deux croque-morts s’avère contreproductif : il n’y a même plus à faire d’effet de surprise pour dévoiler par la suite que les médecins sont de mèche avec eux). Ce n’est que dans la conclusion, il est vrai assez audacieuse, très « Contes de la crypte« , que les connaissances de Ruth rejoindront celles devinées par les spectateurs… Et pendant ce temps là, les méthodes de régimes employées à la cliniques sortent tout à fait du cadre, remplacées par ce jeu de devinettes mené avec la létargie propre à la télévision de l’époque, et que Sasdy croit pouvoir réhausser ici ou là via quelques incartades gothiques sonnant faux, mal insérées dans l’intrigue et mal fichues (il ne suffit pas de montrer un tombeau pour raviver la splendeur des années 50 et 60…). Quand le dialoguiste ne croit pas bon d’invoquer directement Dracula lorsque Ruth et son allié se rendent nuitamment dans un cimetière. La Treizième réunion partait pour être bon sans se parer des horripeaux de la Hammer avant de tomber dans une platitude toute télévisuelle insultant à l’occasion ce que la firme était à son âge d’or. Dès le second épisode, pourtant aux mains d’un historique de la maison, La Maison de tous les cauchemars laisse craindre ce que les derniers longs métrages du studio laissaient craindre : il n’y avait alors plus moyen de sauver un style définitivement dépassé tout en s’accrochant à ses lauriers. Et le style télévisuel, très fauché, n’aide pas beaucoup.