Rue de la Sardine – John Steinbeck
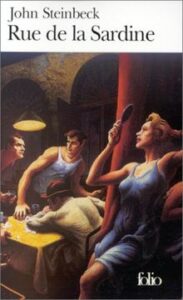 |
Cannery Row. 1945Origine : Etats-Unis
|
Les choses ont bien changé pour John Steinbeck depuis son premier véritable succès commercial, le léger mais pourtant excellent Tortilla Flat en 1935. Avec Les Raisins de la colère, Des souris et des hommes et une paire d’autres livres écrits sur un mode assez grave, l’auteur a acquis une réputation d’homme engagé, voire de dangereux gauchiste. Parallèlement, ce succès s’est accompagné de changements dans sa vie personnelle. Un divorce puis un déménagement l’amenèrent à s’éloigner de Ed Ricketts, biologiste marin dont l’influence et le mode de vie influencèrent beaucoup Steinbeck. Au sortir de la guerre, pendant laquelle il fut correspondant, on pouvait donc s’attendre à un livre fortement lié au contexte agité de l’époque, tant au niveau privé qu’international. Il n’en fut rien : avec Rue de la Sardine, Steinbeck revient à la modestie de Tortilla Flat, adoptant le même style humoristique et nostalgique pour dresser le tableau d’une petite communauté immergée dans un quotidien en apparence anodin, mais qui au même titre que Les Raisins de la colère révèle le profond attachement de Steinbeck à une certaine catégorie sociale.
Rue de la Sardine est donc loin de la gravité de l’épopée tragique de la famille Joad entre l’Oklahoma dévasté par les tempêtes de poussière et le faux eldorado californien. Non seulement le livre est bien plus court, mais il concentre également son action sur une seule rue, celle qui lui donne son titre. Très accessible, et même digne d’être étudié dans les collèges, le roman brosse en fait le tableau idyllique d’une rue semi-fictive de Monterey (son équivalent sera renommé Cannery Row après le succès du livre de Steinbeck) à proximité de laquelle l’auteur vécu durant toutes les années 30, et où son ami Ed Ricketts disposait d’un laboratoire. Notons que l’intrigue du roman se déroule durant ces mêmes années 30, ce qui semble indiquer que le Steinbeck d’après-guerre, ayant déménagé et s’étant éloigné de Ricketts (sans avoir coupé les ponts) éprouve pour cette époque et cet endroit une profonde nostalgie qui le touche non seulement du point de vue humain, mais également du point de vue social. Les Etats-Unis de 1945, année de publication du livre, sont désormais loin de cette époque. L’heure est à la prospérité, et avec elle les lieux et les gens changent. Le progrès a fait son apparition, faisant disparaître le cadre matériel et humain d’une solidarité qui durant la grande dépression prévalait sur tout sentiment individualiste. Mais toute cette conception du présent n’est qu’une déduction effectuée par le lecteur à partir d’un texte qui ne sort jamais de son cadre temporel, et qui est empreint de nostalgie dès son ouverture : « La Rue de la Sardine, à Monterey, en Californie, c’est un poème; c’est du vacarme, de la puanteur, de la routine, c’est une certaine irisation de la lumière, une vibration particulière, c’est de la nostalgie, c’est du rêve. »
Et pour retranscrire tout cela, Steinbeck ne commet pas l’erreur de donner au livre une véritable intrigue allant d’un point A à un point B et proposant un défi à relever pour je ne sais quel personnage qui aurait fait figure de héros. Si il avait agi ainsi, l’auteur aurait très certainement rompu le charme de son livre, plaçant un personnage au-dessus des autres, brisant ainsi le climat de solidarité et donnant un objectif concret à des hommes et des femmes qui n’ont justement pas d’horizons futurs, et qui en un sens n’en sont que plus libres. Rue de la Sardine est l’éloge d’une façon d’être, d’une marginalité assumée qui ne demande de compte à personne et à qui personne ne demande de compte. Les aventures entreprises par les personnages (aménager un entrepôt en maison, organiser une fête, aller capturer des grenouilles…) n’ont rien de sensationnel, ce sont des évènements de la vie quotidienne qui ne prennent jamais le pas sur l’objectif central du livre, qui est de saisir la vie de cette rue, une vie en sans remous, mais au flux très intense. Le mouvement occupe une place centrale : Mack et ses gars, des clochards ayant élu domicile à l’entrepôt du pingre épicier Lee Chong, Dora et ses prostituées, Gay et ses problèmes conjugaux et judiciaires, Henri le peintre, Doc et ses bestioles, le chinois silencieux et ses mystérieuses allées et venues vers la plage, toutes les figures de la rue de la Sardine ont des profils différents, mais tous cohabitent harmonieusement, parfois à la limite de la légalité, dans cette communauté où la solidarité n’est pas un vain mot, ni même une réaction idéologique. L’esprit de camaraderie va de soi entre tous ces personnages qui chacun à sa manière contribue à la vie et au mouvement de la rue : Mack et ses gars sont le genre de types qui malgré de grossières maladresses sont prêts à remuer ciel et terre pour faire plaisir, Lee fournit à la rue tout le besoin matériel dont elle a besoin, les prostituées sont là pour subvenir aux besoins physiques, Henri change de mouvement artistique comme de chemise etc… Représentation d’Ed Ricketts, Doc est la figure la plus respectable de tous, mais il n’en a pas conscience. Son désintéressement et son altruisme sont spontanés, et il ne lui viendrait pas à l’idée de réclamer quelque chose en échange. C’est une bonne poire, c’est l’esprit même de la rue de la Sardine, et chacun des habitants a pour lui une forme d’idôlaterie dont il n’a pas conscience, immergé qu’il est dans sa science et dans son singulier laboratoire. C’est bien ce qui le rend aussi attractif pour tous : lui qui pourrait avoir une situation confortable en temps que savant (c’est lui le plus aisé de la rue, et du reste il emploie souvent Mack et ses gars) est certainement le plus innocent de tous. A côté de lui, chacun des personnages se sent conforté dans sa dignité, que ce soit les clochards, les prostituées, et tous les autres qui dans une société plus carriériste seraient certainement considérés comme « des filles, des souteneurs, des joueurs de cartes et des enfants de putains« . Ce sont en fait « des saints, des anges et des martyrs » que Steinbeck glorifie non pas à coup d’héroïsme mais à coup de simplicité. L’humilité est une vertu essentielle dans l’œuvre de Steinbeck, et à son époque il la retrouve essentiellement chez le prolétariat, qui est ici idéalisé sous la forme de personnages dont la liberté n’empiète jamais sur celle des voisins, et qui se satisfont de peu de choses, pourvu qu’on les laisse en paix. Ce qui est le cas ici : les seuls personnages susceptibles de contrarier les plans de Mack se retrouvent vite fait à picoler avec lui et sa bande. Rue de la Sardine est une sorte d’utopie dans laquelle même les erreurs, les défauts et les attitudes grotesques (tel ce couple dormant dans une chaudière abandonnée dans le terrain vague) participent à l’atmosphère conviviale. On ne saurait comparer le livre avec la réelle situation de cette rue de Monterey au cours des années 30. Mais Steinbeck l’a dit lui-même : ce roman est du rêve, de la nostalgie, et on ne saurait le considérer autrement que comme tel. L’absence de sujet politique éloigne également la gravité et favorise cette vision idyllique d’un coin où tout le monde, de l’immigré au simple d’esprit en passant par le repris de justice peut s’intégrer sans difficulté et vivre et sans êtres soumis ni à des conventions sociales. Cette rue incarne tout simplement la joie de vivre et prouve que celle-ci n’est pas synonyme de richesse matérielle.
Touchant dans son minimalisme, remplis de personnages attachants dont l’apparente banalité que peut que favoriser le sentiment d’identification, Rue de la Sardine est un livre apaisant à lire entre deux oeuvres plus graves, et qui a probablement été écrite ainsi, comme le fut Tortilla Flat plus tôt, et comme le sera Tendre jeudi (suite de Rue de la Sardine) plus tard. Ce genre de livre vient rappeler les conceptions que l’auteur se fait de la vie. Et ce style fera date ailleurs que dans la littérature, puisque le Bob Dylan de la fin des années 60 y puisera l’inspiration pour deux chansons fleuves dépeignant dans un rythme paisible un microcosme personnel à la fois comique, nostalgique et onirique (Desolation Row sur « Highway 61 revisited » et Sad Eyed Lady of the Lowlands sur « Blonde on Blonde », qui ne sont pas de la petite bière).

