Sliver – Phillip Noyce
 |
Sliver. 1993.Origine : États-Unis
|

Les lendemains de fête sont difficiles pour Sharon Stone. Propulsée star du jour au lendemain à la suite de la présentation de Basic Instinct au festival de Cannes puis de son succès international, la comédienne voit ses efforts enfin payer. Désormais connue et reconnue, elle arrive à un tournant de sa vie d’actrice. Ce moment où il ne faut pas se tromper quant à la suite à donner à sa carrière sous peine de rester enfermée dans le même genre de rôle qui l’a portée au firmament. Or Hollywood aime bien cataloguer les gens. Hissée au rang de sex-symbol, Sharon Stone se doit donc d’être une usine à fantasmes, de faire rêver les gens par sa plastique et son côté beauté glacée qui se dévergonde. Scénarisé par Joe Eszterhas, Sliver tente de reconduire maladroitement la formule gagnante du film de Paul Verhoeven, s’inscrivant dans cette veine du thriller érotique qui en a découlé avec des titres aussi inoubliables que Color of Night, Harcèlement ou encore Striptease. Sauf que si Paul Verhoeven avait su transcender un scénario quelconque par une mise en scène sophistiquée et son approche frontale de la violence et du sexe, Phillip Noyce, pourtant auteur d’un Calme blanc naviguant dans les mêmes eaux et qui possède ses adeptes dont je ne fais pas partie, assure le minimum syndical. Il se repose essentiellement sur la plastique de son actrice principale et les quelques scènes olé-olé concoctées par le scénariste, seuls véritables ajouts (à deux-trois changements de noms de personnages près) à la base romanesque de l’écrivain Ira Levin, plus connu pour Un bébé pour Rosemary, autre roman autour d’un immeuble propice aux événements dramatiques.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. A la recherche d’un appartement pour refaire sa vie à la suite d’un douloureux divorce, Carly Norris (Sharon Stone) trouve la perle rare dans un immeuble new-yorkais de haut standing. Elle ne se doute pas que loin de partir de son plein gré, la précédente locataire Naomi Singer a été éjectée tête la première par-dessus son balcon par un indélicat encapuchonné. Tout à son bonheur, elle ne se formalise pas outre-mesure de la nouvelle, pas plus qu’elle ne s’émeut de la mort – accidentelle – de Gus Hale, le voisin qui venait de l’en informer. Elle a d’autres chats à fouetter comme repousser les avances du pressant Jack Landsford (Tom Berenger) et tomber dans les bras du bellâtre Zeke Hawkins (William Baldwin), deux autres résidents de l’immeuble. Pourtant, tout ne tourne pas rond dans son nouvel havre de paix. Un mystérieux individu jouit ainsi de l’intimité de tous les habitants via un poste de contrôle qui le relie à tous les appartements, se repaissant des images de leur quotidien, capturant des moments aussi bien anecdotiques que romantiques voire dramatiques. Cette personne dénuée de scrupules aurait-elle quelque chose à voir avec la mort de Naomi ?
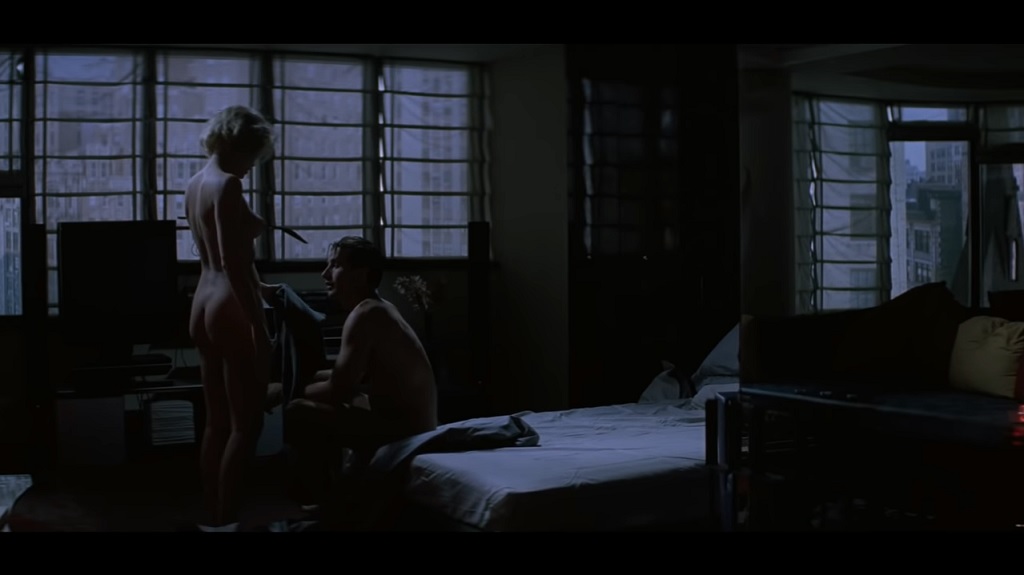
Voilà une question purement rhétorique pour un film qui se soucie peu de l’aspect policier de l’intrigue. Dans la défroque du Lieutenant Victoria Hendrix, CCH Pounder n’a en conséquence droit qu’à des bouts de scène pour présenter sa nouvelle coupe de cheveux. Sur le terrain, elle se contente de relever les témoignages des uns et des autres ou de constater les faits plutôt que mener de véritables investigations. Une police new-yorkaise qui ne sort pas grandie de ce film puisqu’elle n’hésite pas à laisser en liberté un individu que tout accuse. Le fait est que le suspense du film, ou du moins son mystère concernant l’identité du tueur, tient à peu de chose, les soupçons ne se portant que sur deux personnages : les deux prétendants de Carly Norris. Un triangle amoureux qui tourne court tant les rôles de chacun sont clairement définis dès le début. L’hésitation de Carly ne dure que le temps d’un « peut-être » adressé lors d’une fin de soirée arrosée à un Jack Landsford trop sûr de lui, convaincu que sa proposition de dîner dans un bon restaurant lui fera oublier sa séance de musculation en salles en compagnie du jeune Zeke. Or Carly a en vérité déjà fait son choix. Il ne lui reste plus qu’à le verbaliser et à s’abandonner à ses envies. Sa relation avec Zeke tient lieu de trame principale que les irruptions impromptues de Jack (décidément sans-gêne, il pénètre chez Carly en son absence et s’installe confortablement dans son fauteuil, une cigarette à la main, en attendant son retour) réorientent vers le thriller d’origine à base d’accusations répétées contre les agissements troubles de son jeune concurrent. Le personnage de Carly se construit sur le non-dit. Elle sort d’un mariage houleux qui l’a profondément meurtrie. Il en résulte une certaine défiance envers la gent masculine, à plus forte raison lorsque l’un ou l’autre de ses représentants tente le passage en force, à la manière de Jack Landsford. Au début du film, elle fait montre d’une grande force de caractère, se refusant d’être le jouet d’hommes imbus d’eux-mêmes. Elle mène sa vie comme elle l’entend, se fichant de l’interventionnisme de son patron qui, plutôt que lui octroyer l’augmentation qu’elle demande, la jette dans les bras d’un écrivain dont le succès semble avoir tari l’imaginaire. Un personnage de femme libre pas si fréquent dans le cinéma américain de l’époque qui s’altère à mesure que la dimension érotique du récit s’instaure. Elle redevient alors cette femme objet. Un être manipulé dont Zeke dispose à sa guise pour réaliser tous ses fantasmes. Derrière des élans faussement romantiques (il la couvre de fleurs après leur première nuit passée ensemble, l’inonde de messages d’amour) se cache un dessein nettement moins reluisant. Il cherche à s’introduire dans sa sphère privée par tous les moyens (il pirate son système informatique pour lui rappeler à quel point il l’aime), se fait insistant pour que ses « non » se transforment en « oui ». Il se comporte de manière toxique avec Carly mais elle ne semble pas s’en rendre compte. Elle s’abandonne totalement à lui, agissant comme une midinette qui vivrait là ses premiers émois. Une infantilisation du personnage pour le moins déroutante qui trouve un bout d’explication lors de leurs premiers ébats. Carly vit avec la peur au ventre. La peur de tomber de nouveau sur un homme comme son ex-mari. Si elle ne dit rien de lui, ou si peu, cette scène est révélatrice du trauma qui fut le sien. Elle se retrouve tiraillée entre son envie de s’oublier dans les bras de cet homme à l’insolente jeunesse et celle de garder la main sur cette relation pour ne pas revivre les mêmes tourments que par le passé. Contrairement à ce que pourraient laisser penser les commentaires de l’époque où la nomination de l’actrice au Razzie de la pire comédienne en 1994, Sharon Stone apporte beaucoup de finesse à son interprétation, nous rendant par moment son personnage réellement attachant. En fait, davantage que sa prestation, c’est son personnage qui est raillé, victime d’une caractérisation pour le moins hésitante et bâclée, orientée dans le seul but de titiller la libido du spectateur.

L’usage de la vidéo-surveillance nourrit le même but. Cet élément déjà au cœur du roman d’Ira Levin constitue la principale raison de son adaptation à l’écran. Bien avant la télé-réalité qui avivera notre penchant pour le voyeurisme, Sliver joue de cet œil inquisiteur qui dérobe des moments d’intimités aux divers résidents de l’immeuble à des fins personnelles. L’homme derrière toute cette installation vit cela comme un divertissement, une sorte de série au long cours dont il choisit les personnages principaux en fonction de son envie du moment. Par le gigantisme du dispositif (tous les appartements sont reliés au poste de contrôle), la possibilité d’une large auscultation du quotidien des divers résidents titille l’imaginaire. Les innombrables possibilités qu’offre une telle infrastructure se résument à une séquence, celle où tout fier de son joujou, son propriétaire zappe d’appartement en appartement, spectateur privilégié de la vie de ses concitoyens. La Vie mode d’emploi de Georges Pérec n’est pas loin. Sauf que là où l’écrivain oulipien s’ingéniait à livrer une description détaillée et exhaustive de l’existence des habitants d’un immeuble sans hiérarchie dans l’importance des évènements relatés, Joe Eszterhas se focalise essentiellement sur un voyeurisme à seule vocation sexuelle. Notre voyeur veut avant tout se rincer l’œil et jette son dévolu sur Carly dont il suit les moindres faits et gestes jusque dans son bain, surprise en plein onanisme. Il a une approche particulièrement désinvolte de son « pouvoir » et le film le traite de la même manière. La place consacrée au système de vidéosurveillance tient alors davantage du gimmick que d’un réel sujet. Tout au plus Sliver met-il l’accent sur le pouvoir d’attraction des images quoi que celles-ci puissent montrer. Assister à une banale conversation autour d’une table prend une autre dimension dès lors qu’elle est frappée du sceau de l’interdit. Loin d’enrichir une intrigue un peu pauvre, ce procédé accroît les défauts du film. Il rend tout à fait ridicule le suspense policier (le tueur n’a pas pu échapper aux caméras, à moins que lui et le voyeur ne fassent qu’un) et accable cette pauvre Carly qui perd définitivement tout sens commun une fois placée face à cette banque d’images. La fin faussement émancipatrice en guise de conclusion n’est qu’un leurre. Carly demeure réduite à son statut de victime. Victime de la duplicité des hommes et de ses propres aspirations. A trop vouloir croire aux contes de fées, elle s’enferre dans une réalité aux contours sordides, prison de papier glacé digne d’un roman sensationnaliste qu’en sa qualité d’éditrice elle n’aurait sans doute pas retenu.

Pour étrange que puisse paraître le choix de carrière de Sharon Stone après le carton Basic instinct, celui-ci se justifie par la nature du rôle, aux antipodes de celui de Catherine Tramell. Elle confirme des talents d’actrice certains mais peut-être aussi un manque de lucidité quant à l’exploitation de son image. Loin de faire évoluer sa carrière, ce nouveau thriller érotique tendance « Hollywood Night » (les téléfilms du samedi soir de TF1 durant les années 90) marque un temps d’arrêt. Elle n’est guère aidée par la réalisation impersonnelle de Phillip Noyce et un partenaire totalement à côté de la plaque (un William Baldwin dont l’heure de gloire était déjà passée et qui jouait un rôle voisin dans L’Expérience interdite) avec lequel les rapports furent particulièrement houleux durant le tournage.





