Contes macabres – John Woodward, Jack Garrett et Damian Harris
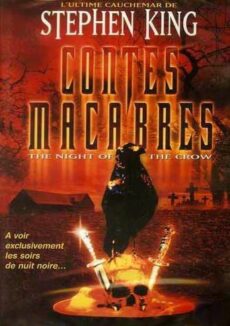 |
The Night of the Crow. 1983, 1984 et 1987.Origine : États-Unis
|

« L’ultime cauchemar de Stephen King ». Il y a comme ça des accroches qui ne peuvent laisser indifférent l’ancien arpenteur de vidéoclubs que je fus. D’autant plus lorsque le résumé au dos de la jaquette laisse entendre qu’il s’agit d’une histoire unique et que celle-ci rappelle fortement celle de Les Démons du maïs. Tout cela fleure bon la flying jaquette… alors qu’il n’en est rien. Le premier segment de ce film qui en compte trois, et qui n’ont rien à voir les uns avec les autres, n’est autre que l’adaptation de la nouvelle « Les Enfants du maïs » paru dans le recueil Danse macabre sans que le nom de Stephen King ne soit cette fois-ci mentionné au générique. Non content de s’octroyer le rôle de Billy adulte, John Woodward laisse entendre que cette histoire rebaptisée Disciples of the Crow (l’oiseau en question a droit à un gros plan à plusieurs reprises) serait entièrement de son crû. Une manière de procéder foncièrement malhonnête et quelque peu ingrate lorsqu’on sait que l’auteur cédait ses droits aux étudiants pour la modique somme de 1 dollar symbolique.

John Woodward conserve les grandes lignes de la nouvelle. Vicky et Burt forment un couple où la dispute permanente a pris le pas sur l’esprit de concorde. Même l’accident qui survient ne suffit à les ramener à de meilleurs sentiments l’un envers l’autre. Au machisme tranquille du monsieur répond les sarcasmes de madame. L’escale à Jonah, petite bourgade de l’Oklahoma qui semble figée en 1971, accroit encore les tensions. John Woodward va à l’essentiel. Pas de psychologie des personnages, pas d’explications à outrance ou de longues scènes dialoguées. D’une durée de moins de 20 minutes, ce segment se doit d’être efficace. D’autant plus que John Woodward introduit les origines du dépeuplement de Jonah via ces enfants homicides menés par Billy, au mélanome extrêmement reconnaissable, dans une sorte de croisade divine. Ce culte au dieu maïs se révèle par l’image plus que par les mots et fait l’économie de toute irruption du fantastique. Vicky et Burt se retrouvent plongés dans une folie homicide à laquelle ils auront du mal à réchapper. Paradoxalement, cet événement aussi traumatique que inattendu les amène à revoir leur position l’un envers l’autre. Si la fin se garde bien d’apporter une conclusion à leur calvaire, les laissant dans l’expectative, ils semblent de nouveau soudés. Au moins le temps de laisser passer l’orage suivant l’adage « l’union fait la force ».

The Night Waiter se déroule lors d’une nuit d’orage et suit la première « journée » de travail en tant que garçon d’étage du jeune Walter Tallent dans un vieil hôtel du bord de mer. Le responsable des lieux, Terry, se montre particulièrement facétieux à son encontre et ne prête guère attention à ses craintes. Pourtant, il semble il y avoir une présence étrange dans la chambre 321. Walter en est d’autant plus convaincu qu’il apprend de la bouche même de son patron que 40 ans en arrière, un drame s’y était déroulé lors d’une funeste lune de miel. Tout cela ne fait rien pour rassurer le jeune employé.

Nuit d’orage, vieille bâtisse dépeuplée, couloirs sombres, drame passé, … The Night Waiter déploie tout un arsenal propre à évoquer maints films de maisons hantées. Or Jack Garrett s’engage dans une autre voie. Son épisode, sa durée aidant, il l’envisage comme l’une de ces histoires horrifiques qu’on aime à se raconter à la veillée. Une histoire qui nous est d’ailleurs introduite par la voix off de l’apprenti garçon d’étage qui révèle d’emblée deux éléments d’importance : il a survécu à ce à quoi il a assisté et quelque chose d’étrange, pour ne pas dire horrible, s’est déroulé cette nuit-là. De l’hôtel en question, nous ne verrons pas grand chose. Un plan d’extérieur en guise d’introduction puis un couloir filmé dans la pénombre en tout et pour tout. Jack Garrett doit composer avec des bouts de ficelle. Il joue des différentes focales et de l’éclairage pour cacher la misère et tenter de créer un climat d’étrangeté autour de l’influençable Walter. Un climat d’étrangeté entretenu également par le comportement de Terry, responsable du lieu jamais avare d’une bonne plaisanterie. Il prend un malin plaisir à jouer avec les nerfs de son jeune employé dans une sorte de bizutage qui n’amuse que lui. The Night Waiter se fend alors d’une morale sur l’air de l’arroseur arrosé dont le final ne dépareillerait pas dans ces comics de bandes-dessinées horrifiques qui ont inspiré Les Contes de la crypte ou encore Creepshow.

Dessinateur de bandes-dessinées, Macklin tente désespérément de convaincre Kessler, éditeur de comics, de publier ses histoires. Peine perdue, le bonhomme restant hermétique à son style. Il ment à son ami Whitey, photographe, avec lequel il travaille dans une boîte miteuse pour arrondir les fins de mois. Sur le chemin du retour, il s’arrête dans une épicerie où ils reconnaissent la caissière, une ancienne amie à eux. Les yeux dans le vague, l’air hébété, elle effectue ses tâches de manière mécanique sans dire un mot, ni leur prêter attention. Whitey remarque une vilaine trace sur son bras, comme si elle se droguait. Macklin ne s’en inquiète pas au contraire de Whitey pour qui cela devient une obsession. Parler à Eileen et comprendre ce qu’il se passe pour lui venir en aide. Mais il y a parfois des choses qu’il vaut mieux ne pas savoir.

Avec ses inserts réguliers des planches de bandes-dessinées de Macklin, Killing Time se rapproche dans l’esprit de Creepshow. Pourtant, Damien Harris lorgne davantage vers le film noir. A la suite de Macklin et Whitey, il nous plonge dans les quartiers interlopes d’une mégalopole américaine où le sort des individus ne vaut pas grand chose, pour ne pas dire rien. Le patron de la boîte dans laquelle les deux amis travaillent le dit ouvertement : pour le peu qu’il paie ses employés, il peut en disposer comme bon lui semble et les virer dès que l’envie lui en prend. Il trouvera toujours des gens sans le sou disposés à les remplacer. Cynique au possible, il joue même le sort de Macklin aux dés. Adapté d’une nouvelle de Dennis Etchison (Damian Harris rend à César ce qui est à César, lui), Killing Time traite en creux de l’aliénation du petit prolétariat sous couvert d’une exploitation post mortem. Les morts ainsi revenus à la vie posent moins de problème que les vivants n’ayant aucune revendication à faire valoir. Un thème qu’on retrouvait déjà dans L’Invasion des morts-vivants de John Gilling, pas le plus cité des films de la Hammer. Une exploitation rendue possible par un aveuglement généralisé, chacun vivant pour soi sans prêter attention aux malheurs des autres. Pur produit de son époque, Macklin se comporte ainsi. Voir Eileen dans ce triste état ne l’émeut guère. Et même quand son ami lui reproche de toujours lui tourner le dos lorsqu’il sollicite son aide, son attitude ne change pas. Il reste passif et hermétique aux problèmes alentours, sauf lorsqu’il s’agit de nourrir son imaginaire pour ses bandes-dessinées. Il préfère être observateur de son monde, toujours dans la pénombre d’où émerge parfois un semblant de conscience morale. Pour son premier travail, Damien Harris démontre un savoir-faire évident. Il soigne ses cadres, joue constamment des clairs-obscurs et retrouve cette lumière blafarde propre à bon nombre de films d’horreur de la fin des années 70 et du début des années 80. Du travail bien fait de la part d’un réalisateur qu’on sent mûr pour passer à l’étape suivante.
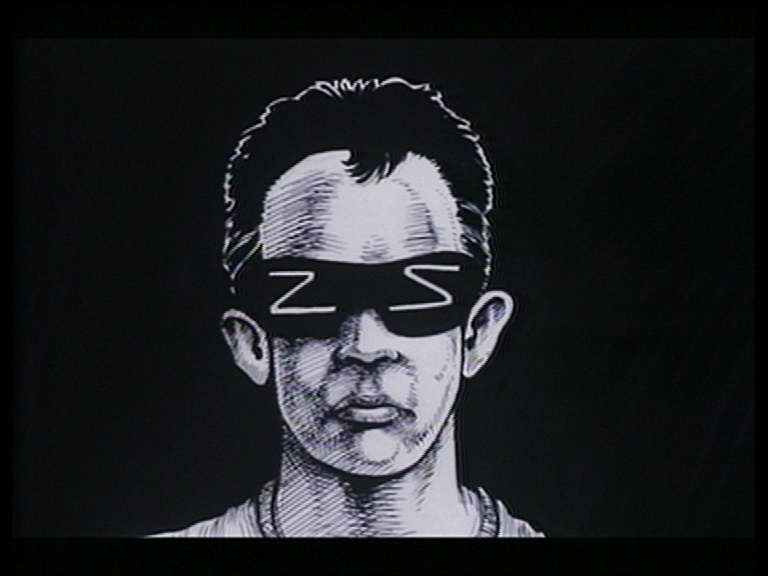
Sous couvert de son accroche mercantile – et d’une grande efficacité, il faut le reconnaître – Contes macabres est une compilation de courts-métrages plutôt recommandable. Si l’amateurisme est parfois flagrant, aussi bien au niveau de l’interprétation que de la mise en scène ou du montage (Disciples of the Crow en fournit l’exemple le plus flagrant), l’ensemble se suit sans déplaisir et se conclut en beauté avec Killing Time, une carte de visite de qualité.




