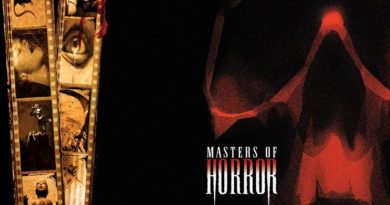Aguirre, la colère de Dieu – Werner Herzog
 |
Aguirre, der Zorn Gottes. 1972Origine : R.F.A.
|

Vers le milieu du XVIe siècle, suivant une légende évoquée par les autochtones, les conquistadors espagnols se sont lancés à la recherche de ce paradis de l’or qu’est censé être l’Eldorado. Devant l’impossibilité de faire avancer tout un régiment avec le ravitaillement que cela inclut, Pizarro choisit de stopper l’expédition et d’envoyer par voie fluviale un groupe d’éclaireurs commandés par Don Pedro de Ursúa (Ruy Guerra) secondé par Don Lope de Aguirre (Klaus Kinski), incluant aussi Don Fernando de Guzmán, représentant de la couronne espagnole ainsi que le missionnaire Gaspar de Carvajal (Del Negro). Pas plus aisé, le voyage, effectué sur un radeau de fortune et perturbé par les indiens hostiles, tourne bien vite à la folie douce et dure. Aguirre y est pour beaucoup, lui qui s’est vite arrangé pour écarter Ursúa, prendre le commandement et proclamer Guzmán empereur de la contrée de l’Eldorado, laquelle demeure introuvable.

Bien que leur traitement des populations indigènes ait été indigne, les pionniers du far west occupent une place de choix dans le panthéon culturel américain. Aujourd’hui encore, cette époque de conquête revêt une signification particulière au pays de l’Oncle Sam, au moins auprès d’un certain public plus ou moins relayé par un monde politique qui peut lui-même avoir besoin de convoquer l’esprit de l’ouest pour se lancer dans de grandes aventures. Souvent sous le couvert d’aller défendre la démocratie, la liberté ou autres concepts grandioses, ce qui n’est rien d’autre qu’une variante modernisée de l’argument civilisateur que revêtaient aussi bien la conquête des territoires indiens que la colonisation européenne d’antan. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de mettre un voile pudique sur des motivations bien moins reluisantes. Culturellement, il faut bien admettre que cet état d’esprit a bien été entretenu par le western, et ce malgré les points de vue non conformistes apparus à partir des années 50 (et ayant fleuri en écho à l’opposition à la guerre du Vietnam). Plus modéré, le point de vue du vieux continent n’a jamais vraiment osé faire ses gorges chaudes de l’esprit des colonisateurs. Il est plutôt rare de tomber sur un film en costumes saluant l’esprit des explorateurs partis soumettre l’Afrique, l’Amérique, l’Asie ou l’Océanie. Question de morale… ou plutôt question de garder un profil bas de circonstance : le contraire serait en effet bien mal venu de la part d’un continent qui au moment même ou le cinéma apparaissait et se développait, commençait à décliner via des guerres d’ampleur, via sa propre inféodation aux États-Unis et via une inexorable décolonisation. Il ne reste alors plus qu’une certaine frange de l’extrême-droite pour ressortir l’argument civilisateur, le ton étant plus à la préservation d’un tabou gêné aux entournures, avec à la clef quelques repentances histoire de préserver la sensibilité des ex colonies abritant toujours des intérêts nationaux.

Allant bien au-delà de cette hypocrite -ou naïve- autocritique, l’allemand Werner Herzog aborde le sujet avec une brutalité rare, coïncidant avec le renouveau du cinéma (ouest) allemand, lui-même relié aux remous sociopolitiques des années 60 et début 70. Son Aguirre n’a rien d’historique : la fidélité aux véritables évènements et aux récits du missionnaire Gaspar de Carvajal est extrêmement ténue, le réalisateur / scénariste ne conservant que ce qui peut lui fournir de la matière pour sa propre ambition portant sur la thématique du pouvoir, à la fois minimaliste et démesurée. Minimaliste car son film fut bricolé plus qu’il ne fut conçu, depuis l’écriture du scénario en deux jours (la légende veut qu’il ait été écrit dans un bus et que des pages se soient perdues après qu’un type eut vomi dessus) jusqu’à l’égarement temporaire des négatifs à l’aéroport de Lima en passant par le staff très réduit (8 personnes), les improvisations techniques et artistiques, sans oublier les très violentes prises de becs entre Herzog et Kinski, qui démarraient en grande pompe leur fructueuse et mouvementée collaboration. Tout ceci a bien entendu participé à la sensation que Aguirre progresse à vue, et ne doutons pas que Herzog a eu ceci en tête au moment de songer à la production de son oeuvre. C’est précisément ce côté « rustique » qui fait aussi sa démesure : par l’épreuve que fut sa conception, la désolation qu’il inspire n’en fut que décuplée.

L’absurdité infinie de Lope de Aguirre, la rupture avec une réalité historique pourtant elle-même pas piquée des vers, tout cela est une charge à l’encontre non pas de la colonisation en elle-même (le mal fait aux cultures écrasées n’est pratiquement pas évoqué si ce n’est par la présence de quelques esclaves, dont cet ex-prince indien et ce noir qu’on déshabille parce « qu’un noir fait peur »), mais plutôt de ses motivations, et de celles qui guident nombre d’aventures en territoires étrangers. L’appât du gain et la volonté de puissance à leur paroxysme, de la quête aveugle pour une contrée dont l’existence ne repose que sur des fantasmes à ces ubuesques projets qu’évoque encore Aguirre lors des dernières minutes. Les richesses et la puissance détenues par ces conquistadors sont à l’origine même de la folie de leur expédition. Ils en ont retiré une arrogance qui les a plongés dans le ridicule le plus achevé, puis à une mort certaine. Cette fatalité domine le film, dénué de tout aspect grandiloquent là où on aurait pu s’attendre au contraire à un rythme échevelé fait d’épreuves en tous genres. Or, il n’y a pas d’épreuves : les espagnols commencent dans la merde et finissent ainsi, qu’elles qu’aient pu être les décisions prises. Entre temps, il n’y a que la jungle, les fleuves et les indiens cachés dans les fourrés pour jeter leurs flèches empoisonnées. Il n’y a pas de spectacle, il n’y a que la caméra de Herzog qui jette là dessus un regard détaché. Comme on observerait une crise de démence dans un asile, avec cette impression d’être dans un autre monde et surtout dans un autre esprit. Et il faut bien l’admettre avec un certain humour né d’une sensation de malaise face à l’inconnu psychologique auquel nous sommes confrontés. Ainsi, l’absurdité de ces espagnols saute aux yeux dès les premières minutes, avec ces grandes dames en chaises à porteur au beau milieu de la jungle, trimballées par des esclaves crapahutant dans la boue (l’objectif de la caméra est d’ailleurs un moment embué). Mais l’absurdité devient vraiment hors norme lors de la prise de pouvoir de Aguirre.

Fou furieux, Aguirre ferait passer Idi Amin Dada pour un sage. Sans aucune entrave à partir du moment où il a écarté Ursúa et les alliés de celui-ci, coupé de la civilisation, sa folie éclate subitement au grand jour. Dans les gestes comme dans la parole, il ne subsiste aucun bon sens, ni chez lui ni chez les quelques hommes qui lui restent fidèles, les autres étant menés autant par la terreur que par l’épuisement ou l’absence d’autre perspective (à un certain point, faire demi tour devient inutile). Le but déclaré, c’est à dire trouver l’Eldorado et en faire le centre d’un nouvel empire au nez et à la barbe du roi d’Espagne renié, constitue la seule motivation d’un Aguirre qui met toute son énergie au service de cette chimère, et qui tente d’agir en fonction de la mission grandiose qu’il a conçu. S’ensuivent des visions assez hallucinantes -au sens propre vers la fin- de grotesque, comme ce couronnement du pitoyable Guzmán au beau milieu de la jungle. Ce nouvel empereur est on ne peut plus éloigné du profil d’un conquérant : adipeux, sans charisme, tout juste bon à se gaver comme un porc au milieu de ses hommes morts de faim et à déféquer dans des chiottes en rondins, il incarne bien la mission que s’est fixée son premier serviteur. Là où des hommes plus raisonnables sont au contraire mis à l’écart, voire décapités sans ménagement sur ordre de « la colère de Dieu » ainsi que se nomme Aguirre, dont les rodomontades et les promesses sont au moins aussi folles que ses actes. L’écrasement des quelques individus à peu près sains d’esprit, comme le missionnaire Carvajal, participe également de la singularité du film, qui en plus de ne laisser aucune place à l’espoir prend un malin plaisir, via Aguirre, à humilier tous ceux qui auraient pu en porter. Et pas qu’eux, d’ailleurs : sa propre fille, qu’il prévoyait d’épouser pour donner une lignée au « sang pur » à son Empire, pâtit comme tout le monde de son délire. Extrêmement passive, elle semble attendre la mort, que ce soit par épuisement, par faim ou par les flèches des indiens qui finissent par faire mouche sans que les victimes, trop faibles, ne s’en rendent compte. Au milieu de cette fuite en avant apocalyptique, seul Aguirre demeure plutôt fringant, porté par sa folie fiévreuse. Encore qu’on ne puisse pas dire qu’il demeure debout, puisque son physique aussi bien que son mental est tordu. Kinski trouve là un rôle parfait, qu’il est d’ailleurs impossible de ne pas associer à son propre caractère, lui qui est bien connu pour ses frasques et ses déclarations tapageuses. Son charisme hors norme permet d’associer l’idée de ridicule à la fascination qu’il inspire et qui explique, outre le recours à la terreur, le fait qu’il ait été suivi dans son entreprise insensée.

Dans l’illustration d’un avilissement total et d’une mégalomanie pathologique menant jusqu’à la mort, Aguirre n’est pas sans se rapprocher d’un autre film très violent, Salò ou les 120 Journées de Sodome de Pasolini. Ce sont deux films traitant de la fièvre du pouvoir, jamais aussi dangereuse que lorsque ce pouvoir est obtenu dans des conditions désespérées. Ce n’est peut être pas un hasard si ces deux films ont été tournés par des réalisateurs issus de pays ayant connu le fascisme, né du chaos et qui y est retourné en entraînant avec lui les nations qu’il proposait de mener sur la voie d’objectifs chimériques. Tout comme son confrère italien, Herzog a su donner vie à cette sensation de désolation, tournant une épopée maudite qui n’a pas grand chose à voir avec les épopées glorieuses qui ont fait les beaux jours du cinéma un peu partout dans le monde. Au contraire, la méfiance à l’encontre de ces grands projets est nécessaire, et plutôt que de faire une leçon de morale, Herzog a préféré décrire leur violence dans tout ce qu’elle a d’absurde. Pas nigaud, Coppola s’en est inspiré pour son Apocalypse Now, et le cinéma des années 70 doit beaucoup à cette forme d’engagement désabusé. Aguirre est bien une œuvre phare du renouveau cinématographique, allemand ou non.