Souvenirs – Nikita Krouchtchev
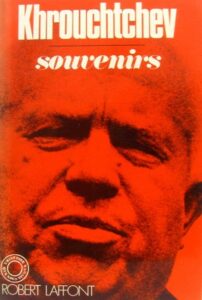 |
Khrushchev remembers. 1970Origine : Etats-Unis / U.R.S.S.
|
A la fin des années 60, l’ex principal dirigeant de l’Union Soviétique Nikita Khrouchtchev n’est plus personne dans son pays. Depuis son éviction du poste suprême en 1964, il est officieusement assigné à résidence dans sa maison près de Moscou. En fin de vie, il a tout son temps pour rédiger ses mémoires. Le résultat, un pavé de près de 500 pages, ne fut pas publié en URSS mais parvint à gagner les Etats-Unis. Comment ? Edward Crankshaw, l’historien chargé de la mise en forme de ce vaste récit, ne le sait pas. Mais il se dit en tout cas certain que ces mémoires furent bel et bien rédigées par Khrouchtchev et non par un quelconque propagandiste d’un côté ou de l’autre du rideau de fer (ce ne serait pas la première fois qu’un faux document soit rédigé pour porter atteinte ou au contraire glorifier un individu). Son hypothèse principale est que Khrouchtchev, en constatant l’amorce d’un retour au “stalinisme” en Union Soviétique, chercha à faire indirectement pression sur Leonid Brejnev et sa nomenklatura par le biais de l’opinion publique occidentale. Avec le recul, on ne peut pas dire qu’il y soit franchement parvenu, pas plus qu’on ne peut dire que Brejnev se rapprocha des conceptions de Staline. Quoi qu’il en soit, ces mémoires sont indiscutablement un document de grande valeur pour les historiens ou les simples amateurs d’histoire, qu’ils soient ou non communistes. Ceci, on ne peut le remettre en cause : Souvenirs est un témoignage de première bourre de la part d’un acteur de premier plan non seulement de la guerre froide, mais également de l’URSS stalinienne d’avant la seconde guerre mondiale, Khrouchtchev ayant intégré le comité central du Parti Communiste dès 1934. Conscient de l’importance de ces mémoires, Crankshaw les destine à deux publics différents, comme il l’explique dans son introduction. D’une part, le livre s’adresse aux soviétologues déjà rodés au système politique soviétique et étant déjà familiers avec les diverses personnalités mentionnées dans le livre. Pour eux, les noms et les situations historiques présentées sont déjà connues, et le livre est un inestimable complément d’information, bien entendu à prendre avec des pincettes puisque Khrouchtchev s’y livre pour une large part à une auto-justification. D’autre part, l’historien adresse également le livre aux curieux qui ne maîtrisent pas forcément les rouages soviétiques. Pour eux, il introduit chaque chapitre du livre par une remise en contexte, il annote les déclarations de Khrouchtchev et il se livre dans les annexes à un récapitulatif biographique de l’auteur, des personnes qu’il mentionne le plus fréquemment et il décrit les institutions soviétiques. Tout ceci participe à une démarche assez nauséabonde, Crankshaw se posant en puits de science, contredisant Khrouchtchev dès que l’envie lui en prend (et bien entendu sans affirmer ses dires : on annote pas une note de bas de page, y’a qu’à acheter les livres du même auteur déjà publiés !). Plus grave, son air méprisant et accusateur, ses soupçons purement intuitifs voire même ses insultes. Il est intolérable de lire une phrase telle que “il semble étonnant qu’une femme de la sensibilité de Nadiejda Alliluyeva ait pu apprécier le rustre mal dégrossi qu’était Khrouchtchev à l’époque“. Accusation sans fondement, supputation, insulte… Du vrai travail d’historien impartial en perspective. Le curieux sera donc bien avisé de consulter Souvenirs en parallèle avec d’autres livres d’histoire, rédigés dans une démarche scientifique. Peut-être ceux de Crankshaw, d’ailleurs, puisqu’après tout on ne saurait réduire le travail de cet homme aux seules annotations du présent ouvrage et que je n’ai pas lu ses autres travaux.
Maintenant, en faisant l’impasse sur les ajouts occidentaux, restent les témoignages du principal intéressé, Nikita Khrouchtchev. Souvenirs n’est pas à proprement parler une autobiographie : le chantre de la déstalinisation n’y fait que peu de références à sa vie privée. Tout juste peut-on y lire quelques pages sur sa jeunesse pré-communiste, lorsqu’il n’était pas encore membre du Parti Communiste (il ne le devint que quelques mois après la Révolution d’Octobre 1917). Fils d’un mineur russe immigré en Ukraine, mineur lui-même avant de devenir ajusteur, marié à une première femme qui décéda lors de la famine provoquée par la désorganisation dûe à guerre civile en 1921 (il n’attribue d’ailleurs nullement cette famine à la politique des bolchéviks), il obtint son premier poste à responsabilité à l’issue de cette même guerre : délégué du parti de Youzovka pour les mines de Routchenkov. Il ne tarda pas à grimper les échelons, d’abord sur le plan local, ce qui l’amena à être délégué suppléant au XIV congrès du Parti en 1925 (sa première visite de Moscou -dont il joua plus tard le rôle de maire-), puis ukrainien, puis soviétique. Selon ses dires, sa promotion doit beaucoup à Nadiejda Alliluyeva, la femme de Staline, rencontrée à l’Institut d’Études Industrielles de Moscou. Un établissement universitaire, truffé d’opposants à Staline que Khrouchtchev réussit à épurer. C’est la première véritable révélation du livre : le déstalinisateur qu’il deviendra fut un stalinien convaincu et non un carriériste. Reconnaissons à Khrouchtchev d’être honnête : venant se sa part, il eut été aisé de mentir en affirmant avoir toujours travaillé en s’efforçant discrètement de ne pas suivre une voie stalinienne. Encore au moment d’écrire ses mémoires, il reste persuadé d’avoir choisi la bonne voie face aux partisans de Trotsky, et plus tard face à ceux de Boukharine. Du reste, sa fascination pour Staline est toujours intacte : “il avait le droit de prétendre à un rôle de tout premier plan dans notre histoire car il était effectivement un homme d’une adresse et d’une intelligence exceptionnelles. Il dominait vraiment, de très haut, tous ceux qui l’entouraient et malgré mon implacable condamnation de ses méthodes et de la manière dont il a abusé de son pouvoir, j’ai toujours reconnu ses dons remarquables et je leur ai toujours rendu hommage“. Tout le livre, largement plus centré sur les 20 années de collaboration de Khrouchtchev avec Staline que sur le travail du Khrouchtchev principal dirigeant, est traversé par cette contradiction, ce double sentiment bizarre d’admiration et de répulsion exprimé en ces termes : “dans tous les aspects de la personnalité de Staline, il y avait à la fois quelque chose d’admirable et de juste et quelque chose de sauvage“. Ce langage franc au sujet de Staline est surtout présent dans le prologue, le reste du livre étant majoritairement dominé par la virulence des dénonciations (à ce titre, de très nombreux chapitres peuvent être vus comme un prolongement au rapport secret du XXème congrès annonçant la déstalinisation -qui est d’ailleurs présent dans les annexes-), Khrouchtchev balayant les mérites de son ancien chef en se réfugiant sous le prétexte du “ça a déjà été dit et redit“. Toutefois, l’admiration pour le “Petit Père des Peuples” n’est jamais totalement éteinte. Elle prend une forme plus subtile, culminant lors du récit qui est fait des dernières heures de Staline, où l’aspect humain cohabite avec l’aspect politique, parfois avec sensiblerie : “Puis il nous serra la main, l’un après l’autre. Je lui donnai la mienne et il la pressa dans sa main gauche, sa droite étant morte. Par ces poignées de main, il nous transmettait ses sentiments. A peine était-il tombé malade que Beria commença à rôder autour, crachant sa haine contre lui, le couvrant de sarcasmes. L’entendre était absolument insupportable.” Il est difficile de ne pas voir l’attachement que Khrouchtchev portait à un homme avec lequel il travailla étroitement pendant presque vingt ans, passant à travers les purges malgré une période de grand froid vers 1947, en raison d’une divergence de vue sur la reconstruction de l’Ukraine. En réalité, si Khrouchtchev semble bien répudier la politique de Staline à partir de 1934, il semble que sur le plan humain, il l’affectionna puis le prit en pitié, notamment en raison de la solitude éprouvée par l’oncle Joe (surnom donné par les alliés à Staline pendant la guerre) à la fin de sa vie, qui pour Khrouchtchev ne fut en gros qu’une longue agonie démarrée à la fin de la guerre.
Le livre en dit finalement plus sur Staline que sur Khrouchtchev lui-même, et c’est assurément l’un des gros manquements, de toute évidence volontaire. Ainsi, si Khrouchtchev écrit des tartines sur ses oppositions (déclarées ou passées sous silence) à Staline, il ne dit pratiquement pas un mot sur l’application qu’il mit à exécuter la politique du chef. Il évoque bien cette politique, et va loin dans les détails, mais il ne dit pas un mot sur son implication personnelle dans les purges, pas un mot sur la famine en Ukraine. Son livre reporte toutes les accusations sur le seul Staline et sur quelques complices, principalement Lavrenti Beria, chef du NKVD (futur KGB) de 1938 à la mort de Staline et dans une moindre mesure Lazare Kaganovitch, chef du Parti en Ukraine (pourtant premier mentor de Khrouchtchev) et Gueorgui Malenkov, second de l’État soviétique, décrit comme un pion docile. Rien n’est dit non plus sur la prise du pouvoir par Khrouchtchev lui-même, une fois débarrassé de ses collègues. Ainsi la partie consacrée à Staline s’arrête-t-elle lorsque les membres du Bureau du Soviet Suprême complotent ensemble pour éliminer Beria, que Khrouchtchev considérait comme un traître n’ayant jamais rien eu de communiste. Pour lui, le système stalinien était tel que disposant d’une aussi grande liberté d’action, le NKVD et son chef Beria en étaient venus à menacer Staline lui-même, incapable d’enrayer la machine qu’il avait lui-même renforcée depuis l’ère de la Tcheka. Staline aurait ainsi vécu ses dernières années dans la peur de Beria et de ses hommes, tandis que la brave Khrouchtchev, conscient du péril, manoeuvrait déjà en coulisse pour essayer de préparer l’isolement de Beria après la mort de Staline. Bref, Khrouchtchev se donne le beau rôle, et forcément, cela laisse des béantes impressions de non-dit.
La même impression est valable pour les trop succins chapitres consacrés aux affaires gérées par Khrouchtchev après que celui-ci soit devenu le maître du Kremlin. On restera ainsi perplexes devant les explications politiques du fameux schisme sino-soviétique qui divisa le bloc communiste jusqu’ici monolithique, qui au contraire des affaires internes à l’URSS staliniennes, vraiment très pointues, est ici réduit à peau de chagrin. Il s’agit pourtant d’un évènement essentiel dans l’histoire du mouvement communiste mondial et il est vraiment très frustrant que l’un des deux principaux intéressés n’y consacre que quinze pages pour y avancer des arguments avant tout personnels (notamment sur le caractère hypocrite et égocentrique de Mao) et politiquement peu explicites (Mao est un petit-bourgeois trahissant le marxisme en s’appuyant sur la paysannerie et non le prolétariat… d’accord, mais concrètement, que dire sur l’évolution de la politique de Mao en Chine et dans le mouvement mondial ?). Que ce soit pour les crises de Berlin, de Suez, des missiles cubains, du Vietnam, de Budapest, Khrouchtchev adopte à chaque fois la même stratégie, se faisant passer pour l’honnête homme désireux de ménager ses interlocuteurs, y compris ceux dont il doutait le plus, et de s’ouvrir au monde tout en continuant à construire le socialisme. Très frustrant. Encore plus pour vous, chers lecteurs, puisque pour les trop rares choses qu’il en ressort, je vous renvoie au Tortilla Mag N°1 ! Quoi qu’il en soit, c’est ainsi que si plus de 300 pages sont consacrées à la période stalinienne, moins de 150 sont consacrés à la politique de Khrouchtchev une fois au pouvoir. Il en résulte que le règne de Khrouchtchev semble s’être construit sur le sentimentalisme et non sur le matérialisme dialectique, impliquant le détachement émotionnel pour une meilleure analyse des situations. Ou plus exactement, c’est le sentiment que Khrouchtchev laisse paraître, car il n’est pas interdit d’y voir une certaine gêne quand aux propres erreurs qu’il aurait pu commettre. Mettre en avant sa politique extérieure et les nobles sentiments qui l’accompagnait est après tout un bon échappatoire pour éviter d’aborder ce qui fâche : le bilan de sa propre politique intérieure, faites de réussites, d’échecs et d’hésitations qui finirent par lui coûter sa place (principalement ses atermoiements au sujet de l’agriculture). Tout de même, tout n’est pas à jeter dans ces chapitres consacrés à la politique extérieure. Quoique l’aspect purement politique fait cruellement défaut, on ne peut pas dire qu’il n’est pas plaisant d’avoir des récits de voyages -parfois presque dignes du “Guide du routard” lorsque Khrouchtchev se met à parler d’hôtels et de nourriture- des coulisses de la diplomatie mondiale. Khrouchtchev y évoque son regard sur différents politiciens du monde, son attachement réel à des hommes de différents horizons tels que Edgar Faure (“un homme charmant qui se mettait en quatre pour être amical et hospitalier avec nous“), Kennedy (“Je fus impressionné par Kennedy […] c’était un homme raisonnable“), Nehru (“un des êtres les plus attachants que j’ai rencontré“) et surtout Ho Chi Minh (“un des “saints” du communisme“). On y trouve aussi des jugement négatifs sur d’autres personnalités, comme l’anglais George Brown, ponte du parti travailliste (qui par ses remarques antisoviétiques provoqua le départ de Khrouchtchev d’une réception), Nixon (“ce salaud“), Eisenhower (“il y avait quelque chose de mou dans son caractère […] il dépendait trop de ses conseillers“) ou Truman (“qui n’avait rien d’un homme d’État, ni la moindre souplesse d’esprit et qui se montrait hostile et méprisant à l’égard de l’Union Soviétique“). On retrouve là les racines paysannes qui ont fait la renommée de Khrouchtchev, l’homme qui tapa de sa chaussure sur son pupitre à l’ONU. Certaines conversations “off” qu’il évoque sont franchement amusantes, loin du sérieux affiché par les diplomates dans la presse. Pour un peu, on croirait lire une novélisation d’un film de Frank Capra type Mr. Deeds ou Mr. Smith, avec Khrouchtchev dans le rôle du naïf débarquant dans le grand monde. Ce qui n’est pas vraiment à son honneur, d’ailleurs. Le PCUS lui en tiendra rigueur, et l’occident se souviendra de lui comme d’un père spirituel de Georges Marchais. Bref, cette seconde partie et la conclusion qui l’achève, dans laquelle Khrouchtchev fait part de son envie de voir l’URSS se démocratiser et ouvrir plus largement ses frontières, est avant tout très bien pour comprendre l’homme qu’était Khrouchtchev. Ce n’est qu’en dissertant ses dires que l’on comprend son échec au point de vue marxiste-léniniste : dominé par ses bonnes relations avec les dirigeants de l’ouest, il en a perdu le sens de la méfiance, et il a fini par nier purement et simplement la lutte des classes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’URSS, qui elle ne découle pas des personnalités individuelles des chefs d’État provisoires. Pour Khrouchtchev, affirmer que la lutte des classes était encore d’actualité en URSS pendant son règne, et pendant celui de son successeur Brejnev, est un “argument pour les imbéciles“. Khrouchtchev a pavé la voie au règne de Mikhail Gorbatchev, et l’on sait comment tout cela s’est terminé à force d’entente cordiale entre les deux blocs. Et pourtant, compte tenu de ses déclarations très enthousiaste sur le communisme, on ne peut douter de la sincérité avec laquelle il mit en œuvre sa politique. Mais les bonnes intentions ne font pas forcément de bonnes politiques.
Quand à ce qui est de Souvenirs, le livre (par ailleurs très bien illustré, avec des photos rares) reste malgré tout indispensable, ne serait-ce que parce qu’il présente la vision -même tronquée- d’un homme qui a assisté aux premières loges et qui a participé à l’évolution d’un pays au système totalement inédit, qui porta les espoirs de millions de personnes à travers le monde. C’est aussi une vision alternative originale à opposer à l’anticommunisme érigé dans nos pays en système de pensée unique, et c’est une bonne base d’analyse pour les marxistes-léninistes désireux de se pencher sur les conditions qui aboutirent à la politique de de Nikita Khrouchtchev, homme qui remit en question l’Union Soviétique alors qu’elle était encore cette “grande lueur à l’est“.

