Sur la route – Jack Kerouac
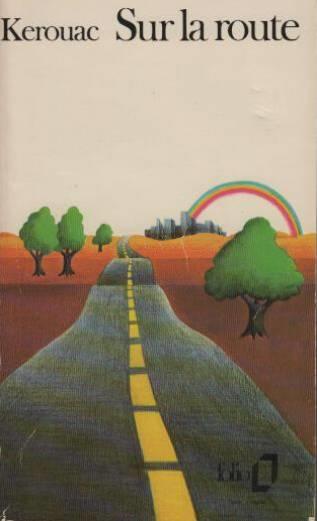 |
On the road. 1957Origine : Etats-Unis
|
Les États-Unis d’après guerre sont florissants. Le pays est le plus puissant au monde et le mode de vie est en pleine transformation. La société de consommation s’impose petit à petit et avec elle un mode de vie résolument bourgeois, propre et conservateur, aguichant des classes sociales qui n’avaient jusqu’à présent guère eut l’occasion de s’affranchir de leurs conditions. Telle est du moins la vitrine représentant ce pays épargné et enrichi par la guerre, celle qui est véhiculée par la télévision et le cinéma, deux médias en pleine expansion touchant aussi bien l’étranger que la vaste étendue nationale. Et pourtant, la nouvelle donne sociale ne peut gommer intégralement toutes les conséquences d’avant-guerre, cette époque de crise économique génitrice de milieux marginalisés ayant traversé ces années avec les moyens du bord, parfois à la limite de la légalité. John Steinbeck nous en avait déjà donné deux brillants aperçus avec Tortilla Flat (1935) et Rue de la Sardine (1945), mais une nouvelle génération d’auteurs se profilait à l’horizon pour développer ce thème, forte à la fois de sa jeunesse et d’un vécu déjà important, qui plus est concentré sur une décennie ayant vu se succéder la pauvreté (et les conséquences familiales et professionnelles qui en découlent), la guerre puis la nouvelle prospérité. Certains ont vécu tout cela, l’ont bien analysé et en sont sortis avec une soif de vivre sortant du cadre établi par des normes sociales trop rigides. La Beat generation, puisque c’est le nom que prit la forme artistique de ce mouvement, n’a pas cherché à plier la réalité à sa conception du monde. C’est elle qui est née d’une nouvelle donne réunissant à la fois un optimisme béat d’une ère de prospérité et un pessimisme forcené face à un passé trop lourd à porter dans une société dont le mode de fonctionnement n’avait dans le fond guère changé, et qui restait sous la menace d’une nouvelle guerre. La leçon tirée de cette expérience fut en gros de vivre pleinement et intensément, sans se soucier du lendemain. C’est cette dernière donnée qui introduit le paradoxe de la beat generation, dont la philosophie très “carpe diem” se marie consciemment avec l’idée que ce mode de vie ne construit pas l’avenir, voire le détruit. Et c’est en cela que les beatniks sont différents des hippies : les premiers sont forts différents les uns des autres (du patriote conservateur Kerouac au communiste Ginsberg, du baroudeur Cassady à la loque casanière qu’est devenu Burroughs) ne sont unis que dans leur volonté de vivre intensément, chacun selon ses critères, tandis que les seconds veulent changer le monde sur un modèle unique, celui du “peace and love”. Il est bien plus difficile de se représenter la beat generation dont les principales figures sont souvent entré en conflit de style, de préoccupations immédiates et d’opinions philosophiques que le flower power. Sur la route de Kerouac est considéré comme le manifeste de la beat generation, mais il est fort différent des autres œuvres majeures que sont Howl, le poème de Ginsberg ou Le Festin nu, le roman hallucinatoire de Burroughs. Ce statut, le livre de Kerouac le doit sûrement en bonne partie au fait qu’il soit bien plus accessible au public que la poésie, certainement la forme d’écriture la plus employée par les artistes beatniks. En cela, Kerouac peut remercier -ou non, puisqu’il vécut assez mal son succès et ses retombées- ses éditeurs, qui le contraignirent à revoir sa copie pendant de longues années avant d’accepter la publication de son roman.
L’écriture de Sur la route est en elle-même aussi révélatrice que le livre sur la beat generation, pour laquelle l’art découle de l’expérience de la vie. Et quelles vies que celles menées par Kerouac, Neal Cassady et les autres protagonistes au cœur du roman ! Sur la route a été conçu non pas comme une forme artistique travaillée, mais bien comme le déversoir de Kerouac alignant ses souvenirs de l’époque 1947-1950, pendant laquelle il fut sur la route. Au niveau purement littéraire, le livre est loin d’être un chef d’œuvre, ce n’est pas du Faulkner et encore moins du Hemingway (écrivain aux antipodes de Kerouac, qui adresse d’ailleurs plusieurs piques à son stoïcisme et à son écriture minimaliste toute en non-dits). Son but n’est pas là, souvenons nous que les beatniks ne faisaient que manier l’art pour retranscrire leur goût de vivre. Et la vie racontée par Kerouac méritait d’être retranscrite telle qu’elle fut vécue, c’est à dire sans aucune pause. La première version du roman fut écrite en une courte période sur un gigantesque rouleau aux feuilles collées bout à bout (36 mètres de manuscrit aujourd’hui exposés à la bibliothèque publique de New York) et n’était pratiquement qu’un bloc de texte, sans marges, sans découpage en chapitres, en paragraphes ni même de mise en page. Bref une version -récemment publiée- programmée pour ne pas laisser le temps au lecteur de reprendre son souffle et de le laisser aussi lessivé que ne le sont les personnages à la fin du livre. Et également la preuve de la frénésie créatrice d’un auteur ayant des choses à faire partager. Mais forcément, ce texte fut jugé impubliable en l’état, et entre le démarrage de sa rédaction et sa publication il s’écoula plus de 6 ans de tractations, qui virent également passer à la trappe les scènes les plus érotiques. Il est loin d’être sûr que les concessions de la part Kerouac aient été faites pour plaire. Selon ce que l’on devine dans le livre, l’auteur était en fait plus en quête d’argent pour financer ses virées que de reconnaissance publique. Dans Sur la route, Kerouac n’évoque l’écriture que comme moyen de subvenir à ses besoins ou payer ses dettes, d’autant plus que le roman concerne les débuts de sa propre place au sein de la “beat generation” et qu’il est tout entier consacré à la gloire d’un homme, le pilier de cette génération (du moins pour Kerouac) qui n’est lui-même pas un auteur ni même un artiste, très certainement parce qu’il n’a pas le temps pour cela.
“Les seuls gens qui existent sont ceux qui ont la démence de vivre, de discourir, d’être sauvés, qui veulent jouir de tout dans un seul instant, ceux qui ne savent pas bailler“, telle est la plus célèbre phrase du roman, celle qui condense la beat generation. Sa représentation la plus parfaite tient dans le personnage de Dean Moriarty, nom littéraire de Neal Cassady (puisque ses éditeurs refusèrent à Kerouac le droit d’employer les vrais noms). L’arrivé de cet homme jeune tout juste sorti de prison dans la vie de Sal Paradise (Kerouac lui-même, le narrateur puisque le livre est logiquement écrit à la première personne) ouvre le roman, et sa présence coïncide avec ses moments les plus denses, tous les autres semblant vaguement ternes, Paradise semblant quelque peu perdu et désabusé, voire en passe de se ranger à la vie bourgeoise comme le font plusieurs personnages du livre. Dean Moriarty est son ami, son mentor, peut-être même son amant (le livre se fait parfois ambigu), en tout cas celui qui lui donne toujours envie de reprendre la route et il finit même par le percevoir comme un ange, un personnage insaisissable et tellement éloigné de la raison qu’il en devient irréel. Les multiples défauts de Moriarty ne font pour ainsi dire que renforcer sa perfection en temps que beatnik (mot jamais employé dans le livre, et pour cause : il n’existait pas encore et on imagine que Kerouac ne l’ait de toute façon pas aimé des masses). On ne peut pas avoir confiance en lui, il est bien trop occupé à vivre sa vie telle qu’il la souhaite, quitte pour cela à laisser Sal “crevant de faim sur un trottoir ou sur un lit d’hôpital“, comme ce dernier annonce qu’il le fera dès les premières pages du livre. Mais il ajoute aussitôt “qu’est ce que cela pouvait me foutre ?“, comme l’aveu de la chance dont il se juge bénéficiaire, celle de partager les épopées homériques de Dean Moriarty à travers les Etats-Unis, puis finalement jusqu’à Mexico en quête de la vie.
La soif de vivre qu’éprouve Moriarty, et qu’il transmet à Paradise, n’est pas uniquement la volonté de prendre du bon temps. C’est bien plus que cela : c’est une énergie permanente affectant aussi bien les sens physiques que les choses de l’esprit et qui se consume jusqu’à laisser ceux qui l’éprouve dans le dénuement le plus total, sans un sous vaillant, dans un état de santé précaire, affamés et parfois seuls, loin de leurs domiciles (lorsqu’ils en ont), laissés sur le bord de la route par ceux qui ont encore de l’énergie. Tout le monde peut se joindre à Moriarty et à sa bande, mais pas grand monde se montre capable de tenir la distance, et surtout pas les femmes. Grand amateur de plaisirs sexuels, Moriarty aime toutes les femmes et il n’en aime aucune au point d’être capable de composer une famille, laissant derrière lui quelques enfants reconnus ou non et quelques compagnes avec lesquelles il ne prend pas la peine de rompre officiellement. Ce ne sont pas les responsabilités qu’il fuit en étant sur la route : plusieurs fois il tenta d’endosser le rôle de père et d’époux, notamment en obtenant un emploi, mais à chaque fois il est rattrapé par son désir de vivre, incompatible avec la fidélité et le confort sédentaire moderne, et il finit par tout plaquer sur un coup de tête une fois ses penchants devenus trop forts. Malgré leur patience, Marylou et Camille sont les deux premières “victimes” de Dean, rendues pratiquement folles par ce compagnon dont la seule constante est d’être imprévisible. Il va sans dire que le commun des américains est d’emblée choqué par cet homme qui malgré ses efforts de respectabilité laisse toujours transparaître sa nature hors-normes. Les conversations de Dean Moriarty -en fait surtout des monologues- sont des galimatias témoignant non pas d’une grande confusion mentale comme on pourrait le croire au premier abord, mais d’une déferlante de pensées hétéroclites (de la plus primaire à la plus philosophique) impossibles à retranscrire clairement. Tout lui vient en même temps, mais la parole ne lui permet pas de s’exprimer comme il le voudrait. Sa curiosité intellectuelle et sont sens analytique ne lui laissent jamais de répit, ce qui est valable pour ses réflexions autant que pour les actions dont elles découlent. Dean Moriarty veut tout voir, tout faire, tout savoir, il veut rencontrer et connaître tout le monde, ce qui le pousse à être de toutes les fêtes, de toutes les soirées et de toutes les invitations. Il s’adonne à la drogue à la Nouvelle-Orléans chez le vieux misanthrope Old Bull Lee (William Burroughs), à l’art avec le fantasque Carlo Marx (Allen Ginsberg) et aux orgies sexuelles dans un bordel mexicain recommandé par un autochtone qu’il ne connait pas… Tout ceci au rythme du bebop à la radio ou dans des bars, une musique jazz très rapide jouée des des vagabonds comme lui, qu’ils soient connus ou non, et qui atteint ce qu’en mélomane il nomme le “it”, ce moment durant laquelle le musicien atteint une certaine intensité qu’il s’évertue à ne plus lâcher, et qui s’apparente en fait pour Moriarty à un orgasme musical (il est d’ailleurs pratiquement en transe lors de ces instants). Pour connaître tout ceci, il traverse plusieurs fois l’Amérique d’est en ouest par tous les moyens imaginables, avec toutefois une nette préférence pour les voitures, achetées, empruntées, louées ou volées qu’il conduit comme un véritable cinglé pour rétrécir les distances de ce pays-continent dont les variations humaines se creusent en même temps que la géographie entre New York et San Francisco (ses deux points de repère, auxquels ont peut ajouter Denver, où il a grandit et où il laisse pas mal de monde). La route, Moriarty y passe le plus clair de son temps : elle porte à ses extrémités le passé et l’avenir, elle symbolise les expériences passées et celles à venir, la mélancolie et l’espoir, bref elle représente tout le paradoxe de la beat generation.
Dean Moriarty incarne la liberté totale et sans entrave (il réussit toujours à contourner les difficultés de la loi ou de la police). C’est en cela que Sal Paradise le considère comme étant au-dessus de tous : c’est la figure la plus affranchie et la moins terre à terre que l’on puisse rencontrer. Cependant cela a un coût : le mode de vie frénétique imposé par Moriarty est profondément destructeur. Plus le personnage se montre “angélique”, plus il glisse vers la folie, avec en plus ce que cela suppose comme dégradation physique. Cette constatation est effectuée par Sal Paradise, Moriarty étant lui-même toujours trop occupé pour réfléchir aux retombées à long terme. Sal sait qu’il ne peut rivaliser avec Dean -bien qu’il soit son disciple le plus tenace- et cela lui laisse plus de temps pour conserver la tête froide. Séparé de lui, il peut dès lors porter un regard lucide qui ne l’empêche cependant pas de céder aux appels de la route, dont il est prêt à payer le prix. Connaître d’avance l’avenir qu’il se construit, ou plutôt qu’il se déconstruit, n’est qu’une raison de plus pour renforcer l’admiration éprouvée pour celui qui a bien “la démence de vivre“, et qui paradoxalement ne fait que rapprocher toujours un peu plus sa fin. La fin de Dean Moriarty / Neal Cassady interviendra effectivement comme on pouvait s’y attendre, en 1968, à 42 ans, après de nombreuses autres années de vagabondages beat (entrecoupée d’un un passage en prison pour détention de marijuana). Il fut retrouvé mort le long d’une voie de chemin de fer, au Mexique, au terme d’une soirée bien acidifiée. Kerouac, le disciple si fasciné, ne connaîtra pas un sort très différent, puisqu’il mourra âgé de 47 ans en 1969 suite à une hémorragie internes provoquée par l’abus d’alcool, non sans avoir entretemps cherché à atteindre la paix intérieure via une conversion bâtarde entre bouddhisme et catholicisme. Mais pour l’heure, dans Sur la route, Kerouac est encore en quête d’expérience et se forge sa philosophie de vie au gré de l’allure démentielle et intempestive de Neal Cassady, un personnage réel qui a tout du mythe et qui a joué un très grand rôle dans la contre-culture des années 50 et 60. Les auteurs, les musiciens et les artistes en tous genres sont nombreux à avoir rendus hommage à cet homme qui n’était pour reprendre des expressions de Kerouac qu’un “ange vagabond” ou qu’un “clochard céleste”. Au-delà même de la conception de la vie qu’il présente -et qui fut à la base de ce que le cinéma appellera road movie-, Sur la route est également la parfaite illustration d’une conception artistique pour laquelle la création ne fait pas que retranscrire la vie, elle est en le produit naturel (d’où le procédé d’écriture de Kerouac, qui devant sa machine cherche à retrouver la frénésie de ses aventures comme un jazzman bop cherche à atteindre le “it”). Cet ultra-réalisme ne fait qu’ajouter à la fascination que l’on éprouve pour Dean Moriarty / Neal Cassady, pour son anticonformisme naturel, loin de l’effet mode, dont il a fait part à Kerouac et que celui-ci parvient à nous retranscrire dans tout ce qu’il a de plus intense et de spontané. Sur la route n’est pas prosélyte, bien au contraire : il démontre le caractère exceptionnel d’un personnage mythique que finalement peu de monde ne saurait suivre, à commencer par Kerouac lui-même, ce qui transparaît à la fin du roman et qui se révélera exact si l’on observe la vie toujours aussi agitée mais aussi grandement empreinte de mélancolie de l’auteur après l’écriture de son œuvre phare.

