Le Fléau – Stephen King
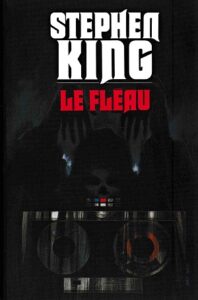 |
The Stand. 1978Origine : Etats-Unis
|
Fin amateur de fantasy et de fantastique, Stephen King avait toujours rêvé d’écrire un livre épique contemporain qui mélangerait l’ésotérisme du Seigneur des Anneaux aux références populaires américaines dont l’auteur a toujours été très friand. Il ne mit pas longtemps à s’y coller : au tout début de sa carrière, alors que seulement quatre de ses livres avaient été publiés (plus un sous pseudonyme), il entreprit l’écriture du Fléau, dans le prolongement de « Une sale grippe », nouvelle parue dans le recueil Danse Macabre. Le résultat n’a plus rien d’une nouvelle : encore à ce jour, c’est le plus gros roman de King. 1200 pages ! Comme Tolkien, King divise son histoire en trois livres : « Le Grand voyage », « La Frontière », « L’affrontement ». Effrayé devant l’épaisseur du pavé, l’éditeur demanda à l’auteur de sucrer 400 pages pour la sortie du livre en 1978. En 1990, Le Fléau ressortit dans sa version d’origine… ou presque. King en profita pour remettre son livre à jour, corriger les dates, mettre à jour les références à la politique américaine, modifier le passé de personnages devenu trop jeunes pour avoir pu faire le Vietnam… Qu’une telle réactualisation ait pu être menée à bien signifie que le sous-texte politique de King ne se basait pas sur des faits précis mais sur une vision globale du monde transformée en métaphore. L’épidémie déclenchée par les maladresses dans la gestion militaire du projet Bleu (des expérimentations sur des armes bactériologiques) aurait aussi bien pu intervenir dans les années 50 qu’en 1990 ou même maintenant. En l’absence de données relatives à l’évolution du projet Bleu (le Président n’intervient jamais, seul deux militaires ont droit à quelques pages, les autres pays ne sont pas pris en compte), l’épidémie de Super-Grippe n’est pour King qu’un moyen de lancer son histoire. Bien sûr, on peut aussi y voir une condamnation des bidouillages bactériologiques, mais ce discours demeure minimaliste, et se retrouve d’ailleurs de façon identique dans toutes les séries B qui des années 50 à nos jours ont pullulé dans le seul but d’amener une autre menace : des humains mutants, des monstres géants, ou ici la super-grippe. Tout le premier livre, « Le Grand voyage » est en fait une série B littéraire à grande échelle dans laquelle King décrit la destruction de l’Amérique à travers une poignée de personnages appelés à devenir les piliers de la nouvelle civilisation. Mais au début, ils restent isolés, seuls à survivre à l’épidémie qui emporte tous leurs proches. C’est incontestablement la meilleure partie du livre. King y décrit de vraies scènes d’apocalypse, que ce soit à New York (autour de Larry Underwood), dans une ville balnéaire du Maine (Frannie Goldsmith et Harold Lauder), dans un patelin de l’Arkansas (le sourd muet Nick Andros) ou de l’Indiana (le cinglé pyromane surnommé « La Poubelle »), dans une prison d’Arizona (Lloyd Henreid), ou même ailleurs, certains chapitres étant consacrés à la propagation de l’épidémie, aux réactions de la presse ou des masses anonymes. Le cas du texan Stu Redman est probablement le plus intéressant : mis en quarantaine après avoir été au contact de Campion, le gardien du centre d’expérimentations militaires et le premier des contaminés, il est arraché à sa ville d’Arnette pour se retrouver enfermé dans un centre de recherches. Maintenu en isolement, il est coupé du chaos extérieur par une séquestration dictatoriale à laquelle il résiste vaille que vaille, ce qui lui donne déjà des allures de héros au milieu des héros. Sujet toujours très accrocheur, la destruction de la civilisation est décrite par King jusque dans ses moindres détails humains, ce qui parvient à compenser la frustration de ne pas connaître les coulisses politiques ou militaires au delà des simples poncifs (les militaires qui instaurent l’état d’urgence et tirent à vue). King se place du point de vue du peuple maintenu dans l’ignorance, ce qui fait du Fléau cette œuvre très premier degré, marchant davantage au ressenti qu’à l’intellect.
Déjà à la fin du premier livre, alors que les quelques survivants errent sur les routes comme des hobbits en débâcle, les premiers signes de ce que va être le second livre se fait sentir : la reconstruction d’une communauté, ou plutôt de deux, antagonistes. Les survivants rêvent chacun à deux alternatives : ou rejoindre mère Abigaël, une centenaire noire vivant au Nebraska, ou rejoindre Randall Flagg, « l’homme noir » dont la capitale sera fixée à Las Vegas. C’est à cette occasion que King plonge dans un fantastique de fantasy, assez proche du Seigneur des Anneaux : les personnages doivent arriver au terme de leurs périples, qui les placera dans la position extrêmement manichéenne du bien (Abigaël, représentante de Dieu) contre le mal (Flagg, dit « Légion »). Les relents de la Bible et même des simplifications politiques à la Reagan (l »axe du mal ») deviennent flagrantes, et parfois exaspérantes. Dieu n’a jamais été un bon personnage : toujours à provoquer des coups de théâtres improbables (quel dénouement ridicule !), toujours à exiger que les personnages se comportent stupidement… Malgré ses allures de vieille femme débonnaire, Abigaël est un personnage antipathique au possible, entraînant dans son sillage les survivants (qui entre-temps ont été rejoints par d’autres plus ou moins importants comme le vieux prof Glen Bateman et son chien Kojak, Nadine Cross et son enfant adoptif Joe, Ralph Brentner, l’arriéré Tom Cullen…) qui ont vite faits de reconstituer une caste d’élite. King n’est alors plus au niveau du peuple : il est au niveau de la classe dirigeante de Boulder, là où les troupes d’Abigaël élisent domicile. Tous des gens braves, humbles, intelligents qui parviennent à recréer une vie sociale parfaite en espérant que Dieu laissera Frannie Goldsmith (devenue compagne de Stu Redman) avoir son enfant sans problème. De l’autre côté, le démon Randall Flagg instaure une dictature à Las Vegas, forcément mal intentionnée pour nos pauvres gens de Boulder, et scrute les pays à l’aide de son « Œil » probablement piqué à Sauron en Mordor. Difficile de ne pas voir là un relent de guerre froide, surtout compte tenu de la rhétorique très « populaire » de Flagg (lequel selon King est en fait inspiré par Donald DeFreeze, leader de l’Armée de libération symbionaise, qui attira à lui la bourgeoise Patricia Hearst, victime du syndrome de Stockholm). Très étonnant de la part de Stephen King, qui n’a jamais manqué d’évoquer son mépris pour plusieurs administrations américaines, Nixon et Reagan en tête. Seuls deux personnages échappent à ce manichéisme : Harold Lauder et Nadine Cross, tout deux attirés par le mal pour des raisons diverses (le premier agit de dépit après avoir vu Fran partir avec Stu, et la seconde est destinée à devenir l’épouse de Flagg). Leurs contradictions personnelles tranchent avec la bonté incarnée de tous les autres habitants de la « Zone libre » de Boulder, qui ne sont en fin de compte que les pantins d’Abigaël, privés de leur libre choix. Les maigres hésitations de Stu, Larry ou Fran ne sont que de la poudre aux yeux, puisque tous sont gagnés par la foi d’Abigaël et que Dieu ne manquera pas de les délivrer du mal. Les deux derniers livres (le dernier étant l’affrontement de tous les gentils contre Flagg sur son propre terrain après une traversée purificatrice du désert) sont systématiquement accaparés par Abigaël et son Dieu, King passant à côté d’un sujet pourtant au moins aussi palpitant que la lutte contre le mal absolu, si ce n’est plus : la reformation d’une société et des relations diplomatiques, tué dans l’œuf par la vieille peau qui vient réaffirmer la volonté divine. De l’autre côté, à Las Vegas, King nous en dit soit trop soit pas assez : trop précis pour faire laisser le flou sur les plans de Flagg et pas assez pour que l’on connaisse les rouages du pouvoir dans le camp du mal. Flagg est largement démythifié et apparaît comme un méchant quelconque, du type de ceux qui partent d’un rire machiavélique sitôt qu’ils évoquent leurs diaboliques projets, bien moins impressionnant que certains de ses successeurs ou réincarnations (Flagg apparaîtra sous ce nom ou sous un autre dans d’autres récits) dans l’œuvre de King. Petit à petit, au lieu du sentiment épique qu’il cherche à donner avec toutes ces allusions mystiques, King tombe dans la banalité. Bien sûr, le livre reste facilement lisible (entre autre grâce à un bon découpage des chapitres), les 1200 pages défilent assez facilement grâce au très bon premier livre et aux péripéties qui pimentent le reste. Mais niveau épique, à moins de se satisfaire de cette banale opposition entre le bien et le mal, nous sommes loin du compte. L’ambitieux pavé (ou plutôt le parpaing dans sa version longue) qu’est Le Fléau est en fait un roman mineur dans la bibliographie de son auteur. Le Talisman des territoires, Les Yeux du Dragon et dans une moindre mesure la saga de La Tour sombre achèveront de prouver que King n’est décidément pas fait pour les fresques.

