La Route – Cormac McCarthy
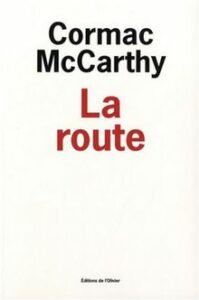 |
The Road. 2006Origine : Etats-Unis
|
Il y a des livres dont il est facile de parler. Les personnages sont bien définis, l’histoire est structurée, rythmée par l’action, et puis il y a ces romans dont il est difficile d’exprimer quoique ce soit.
La Route est de ceux-là.
S’il est difficile d’en dire quelque chose de concret et de critique, ça n’est pas non plus impossible.
Pour résumer, La Route raconte l’histoire d’un homme et de son fils qui marchent vers le sud à travers des terres ravagées par le feu. On ne sait pas ce qu’il s’est passé, seulement, les voilà fuyant l’hiver avec l’espoir de ne pas être rattrapés par le froid.
En quatrième de couverture, nous apprenons que l’Apocalypse a eu lieu. Jamais il n’en est fait mention. La terre semble complètement brûlée, recouverte par les cendres de tout ce qui a pris feu. Les deux personnages marchent alors sur la route, espérant ne jamais croiser qui que ce soit. Chaque rencontre est un danger potentiel. On découvre alors un monde où quelques êtres humains ont survécu, vivant en bande et attaquant ce qu’ils peuvent. Ils leur volent leur nourriture et les mangent.
Cormac McCarthy peint là un tableau très sombre d’une humanité poussée dans ses retranchements. Il n’y a plus de civilisation, plus de culture, plus rien n’est fabriqué, plus rien n’est produit. Il ne reste même pas l’espoir, la fin du monde est arrivée et certains s’accrochent encore à leur vie au détriment de leur humanité.
Mais le père et le fils ont gardé leur humanité. Ils sont les gentils comme aime à se rappeler l’enfant pour se rassurer. Il veut aussi s’assurer qu’il ne sont pas les seuls gentils et que d’autres êtres humains sont restés civilisés.
Survivre dans un monde où la vie n’existe plus est des plus difficiles. Rien à chasser, rien qui ne pousse, ils sont alors contraints d’espérer trouver des boîtes de conserve dans des maisons abandonnées. Mais bien sûr, ce n’est pas si simple. Entrer dans les villes, c’est prendre le risque de croiser des bandes.
D’ailleurs ils vont en croiser.
La force de ce roman est avant tout l’univers que l’auteur nous décrit. Un monde de rien, un monde sans espoir, un monde de violence. La violence, voilà un des thèmes fort de ce livre. Si l’œuvre de McCarthy est imprégnée par la violence des hommes, ce roman met en avant une violence qui découle de la perte de l’espoir. Avec la fin du monde, ce n’est pas tant Dieu qui a tué l’humanité, c’est surtout les êtres humains qui s’entretuent pour survivre. Quelle étrange idée ! Ainsi, McCarthy nous brosse le portrait d’une humanité qui n’a toujours su que se développer dans une violence, qui s’est détruite, et qui a volontairement participé à la misère. Mais l’écrivain n’oublie pas que si les guerres ont marqué l’Histoire de l’humanité, des hommes et des femmes ont tenté de s’éloigner de la haine.
L’homme et le petit, c’est ainsi qu’ils sont nommés tout au long du livre, eux qui ont tout perdu, jusqu’à leur identité, ce qui faisait d’eux des êtres humains, sont de ces gens qui ont toujours refusé d’être les méchants, qui ont fuit la bêtise mais qui inexorablement sont rattrapés par ce que l’humanité laisse trop souvent aux générations suivantes : l’horreur.
Alors ils marchent le jour sur la route, et la nuit, ils la quittent pour ne pas se faire surprendre par d’autres groupes. Parfois, le contact est inévitable. Parfois ça se passe bien parfois non. McCarthy en profite pour plonger tout le roman dans une ambiance oppressante où le danger est omniprésent. Tout peut arriver à n’importe quel moment. Ils ne sont jamais à l’abri.
Autre thème que celui de la violence et de la peur, Dieu. Rien n’est dit dans cette œuvre que Dieu est responsable de tout cela. D’ailleurs, l’homme ne croit plus guère en lui, il ne croit plus en grand-chose. Il attend sa mort tout en la craignant, ne voulant pas laisser son fils livré à lui-même. Pourtant tout est prévu. S’ils sont attaqués, le petit a appris à utiliser le pistolet pour se suicider. Le malaise est omniprésent aussi, on s’attache à ces êtres humains déshumanisés. Car l’humanité, ce n’est pas que le choix du camp des gentils. En faisant le choix de fuir les autres survivants, ils ont perdu toute identité.
Dieu donc, présent et absent, Dieu qui abandonne ou qui punit, pour McCarthy, la question n’est pas autant Sa présence. C’est l’épreuve de la foi. Peut-on croire en Dieu quand on pense qu’Il a brûlé toute Sa Terre et qu’Il a abandonné Ses enfants ?
Pas de prière, pas de supplique, juste des questions sans réponses.
McCarthy est fasciné par la Bible, par les textes. Tout son style est terriblement lyrique, souple, pesant. Il fonctionne avec de courtes phrases qui parsèment ses courts paragraphes comme si tout ne tenait qu’à un fil. Le drame est posé, le destin est scellé, l’ambiance shakespearienne est indéniable. Les personnages sont liés l’un à l’autre et liés à un destin qu’ils n’ont pas choisi. Ils sont les jouets d’une destinée qui se joue d’eux et qui leur offre parfois un peu d’air pour mieux les faire souffrir ensuite. Faire durer le supplice.
Avec cette œuvre, McCarthy réalise là quelque chose de complètement intemporel et de terriblement terrifiant. L’humanité perd toute raison, la foi, dans laquelle les Hommes aiment tant se réfugier n’a plus de sens. Tous les repères qui ont fait les êtres humains, civilisation, religion, tout cela n’a plus de signification, n’a même plus de raison d’être.
Couronné par le Prix Pullitzer 2007, ce livre s’impose comme une œuvre majeure du 21ème siècle et s’inscrit dans cette littérature dramatique et d’anticipation. Peut-être que la fin du monde ressemblera à cela, peut-être pas, mais le plus terrifiant, c’est que si un tel scénario arrivait, il ne serait pas étonnant que les hommes et les femmes réagissent de la sorte. Le portrait est saisissant, la peinture tout de noire, sans une once de lumière, le soleil ne pénètre pas l’épaisse couche de cendre qui vole dans l’air.

