Juste avant le crépuscule – Stephen King
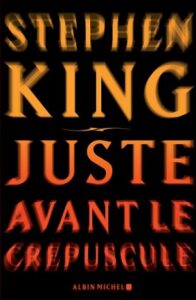 |
Just After Sunset. 2008Origine : Etats-Unis
|
Quand l’envie lui prend, Stephen King fait comme à ses débuts, lorsqu’il n’était qu’un jeune auteur tentant péniblement de gagner sa vie : il écrit des nouvelles et les envoie à des magazines susceptibles de les publier. Et désormais, rares sont ceux qui les refusent… A charge pour les éditeurs de compiler régulièrement le tout pour en faire un recueil. A l’exception de « Le Chat d’enfer », remontant aux années 70 et qui sans être inédite n’avait jamais paru dans un recueil (en revanche, elle fut adaptée dans Darkside, les contes de la nuit noire, en 1990), les nouvelles présentes dans Juste avant le crépuscule datent toutes des années 2000, période du regain d’intérêt de l’auteur pour l’écriture d’histoires courtes. Une soudaine lubie qui s’explique par la lecture de nombreuses nouvelles dans le cadre de sa mission d’éditeur chargé de sélectionner les nouvelles à paraître dans la compilation Best American Short Stories de l’année 2006.
Bien qu’il se soit désormais spécialisé dans la rédaction de pavés, Stephen King n’a jamais vraiment démérité en ce qui concerne les nouvelles. Tout est fatal, son précédent recueil, était plutôt sympathique, quoi qu’on pouvait regretter l’abandon toujours plus prononcé du style « DC Comics » de Danse Macabre voire de Brume. Plus le temps passe, et plus King perd en causticité. Une mauvaise pente confirmée par Juste avant le crépuscule, dont seules deux nouvelles sur treize auraient pu trouver leur place dans les premiers recueils de l’auteur, à savoir l’excellent « Un très petit coin » et (mais ce n’est pas une surprise vu sa date d’écriture) l’amusant « Le Chat d’enfer ». La première nous narre la mésaventure d’un homme qui à cause de l’amertume de son vieil ennemi cancéreux se retrouve enfermé dans une sanisette renversée sur sa porte au milieu d’un chantier abandonné. Cinquante page d’un type se débattant dans la pisse et la merde qui auraient pu être d’un ennui mortel si King n’avait pas joué via son style d’écriture la carte de la dérision pour donner de la saveur (si l’on puis dire) à ce huis-clos original, au sujet duquel il ne cache pas son plaisir de s’être laissé aller à la vulgarité (le recueil se conclut par de brefs commentaires pour chaque nouvelle). Quant au « Chat d’enfer », il s’agit de nous compter les démêlés d’un vieux snob impotent faisant appel à un tueur à gages pour se débarrasser de son chat maléfique. Deux histoires très ironiques se concluant sur une pirouette d’humour noir du plus bel effet. Dommage que tout n’ait pas été du même ressort. Donnons quand même un gros satisfecit à « N. », récit à base de malédiction et de monstres cherchant à gagner notre monde, que l’on croirait Lovecraftien mais en réalité inspiré de Arthur Machen et de son livre Le Grand Dieu Pan. C’est l’occasion pour King d’honorer cet auteur méconnu, qui eut aussi une grande influence sur Lovecraft et que l’on ne peut dès lors que vouloir découvrir. Plein de mystères et de menaces latentes que l’on ne peut repousser qu’en s’adonnant sans retenue aux TOC superstitieux (l’histoire est en fait racontée par un patient à son psychiatre) « N. » est un récit brillant, effrayant, et finalement guère à sa place dans le présent recueil.
D’horreur il est également question dans « La Fille pain d’épice », qui n’est rien d’autre qu’un survival où une femme est séquestrée par un sadique sur une île touristique désertée. Le genre de nouvelle qui ne vaut que pour la façon dont elle est écrite. Pas trop mal en l’occurrence, mais si ce n’est le suspense immédiat il n’y a rien de mémorable là-dedans malgré les vains efforts de l’auteur sur le gore et sur le transparent drame familial de l’héroïne. Ce qui nous amène au thème le plus en vogue à travers toutes les nouvelles : le drame. Je ne sais quelle mouche a piqué Stephen King, mais il privilégie ici les récits à base de sensiblerie, se voulant pudiques tout en traitant de traumatismes. Le fantastique n’est alors plus qu’un élément secondaire, employé parce que cela fait au choix poétique ou symbolique. Les gros sabots sont de sortie avec « Laissés pour compte », dans laquelle un rescapé du 11 septembre reçoit les objets associés dans son esprit à ses collègues morts. Pas d’explication à cela, pas non plus la recherche de frissons : avec une tonalité toute en retenue King joue la carte de la mémoire pour les vies brisées. C’est sa petite pierre au grand mur de la compassion que les artistes américains sont en train de nous édifier depuis 10 ans. Encore plus intime, la femme de « Le New York Times à un prix spécial », qui quant à elle reçoit carrément un appel de son mari fraichement décédé dans un accident d’avion… Il vient lui dire adieu et lui donner un sage conseil. Les cœurs d’artichaut seront aux anges. L’avalanche spielbergienne (car c’est bien à la mièvrerie d’un Always et consorts que tout cela fait penser) se retrouve également dans « Willa », où un couple lui aussi fraichement décédé -accident de train- prend conscience de la réalité et apprend à accepter la mort tout en abandonnant les rancœurs. A écouter avec la BO de Bodyguard ou autre Ghost. La mort, les époux du « Rêve d’Harvey » vont bientôt y être confrontés, via un cauchemar sur la mort de leur fille. Cauchemar qui devient prémonitoire pendant que monsieur raconte sa vision à madame. Un peu plus dérangeant, certes, mais aussi assez pompeux (c’est quasi si l’on imagine pas les roulements de tambours). Dans « Ayana », la mort d’un vieil homme en phase terminale de son cancer est évitée par l’intermédiaire d’une petite fille miraculeuse dont le don n’est pas sans évoquer celui de Caffey dans La Ligne verte. Le fils du rescapé hérite alors de ce pouvoir, dont il ne peut se servir à sa guise. King nous parle encore de tragédies personnelles et de compassion, toujours avec ce ton doucereux passant pour de la pudeur. Enfin, « Fête de diplôme » s’ajoute à la lignée et nous parle de l’amertume et des espoirs de cette jeune fille invitée chez son antipathique belle famille. Récit qui se veut littéralement apocalyptique, compte tenu d’un dénouement bien sombre à la morale de carpe diem.
Restent trois nouvelles : « Aire de repos », « Velo d’appart » et « Muet ». Ici non plus le fantastique ne joue pas un très grand rôle. Il est même inexistant dans « Aire de repos », dans laquelle un homme prend son courage à deux mains pour mettre fin à une violente dispute conjugale dans des pissotières de bord d’autoroute. Ou plutôt, l’homme étant un auteur connu sous pseudonyme, il revêt la hargne de son alter ego littéraire pour mieux se confronter à une situation qu’il se pensait trop couard à affronter. Richard Bachman, cette nouvelle est pour toi… Mais les ligues féministes y trouveront aussi leur compte. Rien de mièvre là dedans, mais ce genre de combat est-il vraiment ce que l’on attend de Stephen King ? Certes, les réussis Jessie et Dolores Claiborne étaient aussi féministes, mais leur développement était bien plus fouillé qu’une simple intervention chevaleresque.
Le sujet de « Velo d’appart » serait trop long à expliquer. Contentons-nous de dire qu’il s’agit de la confusion d’un homme dont le quotidien est envahi par les figures de son l’imagination. Agréable à lire, d’autant plus que cette fois le ton se montre inquiétant, mais là encore la morale « carpe diem » qui parcourt l’histoire gêne un peu le plaisir.
Enfin, dans « Muet », un homme raconte ses déboires conjugaux à un autostoppeur muet… et peut-être sourd. Un exercice de confession routière… qui se terminera dans un confessionnal. Questionnements sur le mariage et sur la réaction aux trahisons et tout le tintouin…
Le problème n’est pas tant que les nouvelles de Juste avant le crépuscule sont mal écrites ou mal pensées. Le problème est que la plupart d’entre elles abordent des thèmes généralistes sous un angle consensuel. King a souvent traité de sujets intimes, mais en règle général la longueur disponible dans un roman lui permettait d’aller au delà de la symbolique et de cet irritant ton mi mélancolique mi optimiste (on se croirait dans des mauvais Spielberg, mais aussi parfois dans l’énervante série Les Routes du paradis). Il serait intéressant de voir si les nouvelles qu’il a sélectionné pour Best American Short Stories ne sortent pas du même moule, auquel cas elles auraient très bien pu trouver en lui et en ses préoccupations personnelles (son accident de 1999 qu’il mentionne une fois de plus, ses ennuis de santé, son âge -il atteint la barre symbolique des 60 ans-) une oreille attentive. Toujours est il que King écrit ici comme un pieux vieillard fasciné et terrifié par la mort. Barbant.

