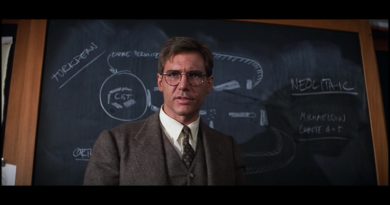Une fille… pour le diable – Peter Sykes

Lors d’une réception privée organisée par ses attachés de presse dans une galerie d’art de Picadilly Circus, l’écrivain es satanisme John Verney (Richard Widmark) se fait accoster par Henry Beddows (Denholm Elliott), un notable qui montre de gros signes d’affolement. Ce dernier supplie l’écrivain d’aller chercher sa fille (Nastassja Kinski) à l’aéroport afin de la soustraire à la néfaste influence d’une secte sataniste adoratrice d’Astaroth. Quelque peu dubitatif, l’écrivain s’exécute néanmoins dans l’espoir de trouver là le sujet de son prochain ouvrage. En interceptant la jeune fille, il contrarie les projets de longue date du père Michael Raynor (Christopher Lee), chez tout-puissant de ladite secte et bien décidé à récupérer sa brebis égarée.

Les années 70 marquent le retour des difficultés financières pour le prestigieux studio de la Hammer après le désistement de la Warner à l’issue de la sortie d’Une messe pour Dracula. Sans contrat de distribution, la firme multiplie alors les partenariats pour la production de films bien éloignés de leurs standards d’antan. Le studio cède aux modes du moment et se fait plus racoleur sans que cela n’infléchisse son inéluctable chute. Avant dernier film estampillé Hammer, Une fille… pour le diable tente de renouer avec l’Adn du studio jusque dans le caractère maléfique du personnage incarné par Christopher Lee, star maison au même titre que Peter Cushing et qui lui sera resté fidèle jusqu’au bout. Sauf qu’en lieu et place d’un Terence Fisher, dont le dernier baroud d’honneur date de Frankenstein et le monstre de l’enfer en 1974, voire d’un Val Guest, c’est au réalisateur australien Peter Sykes que revient la réalisation du film. Guère passé à la postérité, le bonhomme a fait toute sa carrière en Angleterre, réalisant entre autres deux épisodes de la série Chapeau melon et bottes de cuir période Tara King et, déjà pour la Hammer, Les Démons de l’esprit en 1972.

Lors de ses plus belles années, la Hammer garantissait des films au gothique flamboyant, d’une grande richesse visuelle tout en dépoussiérant de manière magistrale les grandes figures du cinéma fantastique. A son sommet, le studio avait d’ailleurs déjà traité du satanisme via Les Vierges de Satan de Terence Fisher en 1968, pour lequel Christopher Lee était déjà de la partie mais du côté du Bien, pour une fois. Un film qui partage avec Une fille… pour le diable une même ascendance, un roman de l’écrivain anglais Dennis Wheatley, également auteur du livre qui inspira Le Peuple des abîmes de Michael Carreras, pour une approche radicalement différente. Il n’est désormais plus question d’un châtelain désireux de sortir sa nièce des griffes d’une secte satanique aux costumes colorés mais d’un écrivain à succès acceptant une mission improbable dans l’espoir d’en tirer matière à un nouveau best-seller. C’est donc davantage l’appât du gain – tout hypothétique qu’il soit – que l’envie de sauver une innocente qui pousse John Verney à agir. Pour le moins léger, ce postulat se justifie par la dimension symbolique que revêt l’antagonisme entre l’anglais Christopher Lee et l’américain Richard Widmark. A travers ces deux monstres sacrés, ce n’est ni plus ni moins que le cinéma d’horreur anglais, alors à bout de souffle, et américain, en plein effervescence, qui s’affrontent. Preuve du basculement qui s’opère sous nos yeux, le personnage de John Verney s’avère plus intéressant que celui du père Michael Raynor. Prêtre excommunié à cause de son ardent désir de créer un avatar de son dieu qui n’est autre que Satan, il ne désarme pas et , entouré de fidèles, met à exécution son démoniaque dessein. Christopher Lee campe une figure du Mal à l’impérieuse solennité comme il en a tant interprété tout au long de sa carrière. La conviction est là mais son personnage manque trop de relief pour rendre homérique le combat qui s’annonce. D’ailleurs leur antagonisme, pourtant entretenu tout au long du récit par des conversations téléphoniques et une fugace apparition dans une église, sera rapidement expédié au moment de leur opposition physique.

Sans non plus être d’une extraordinaire complexité, John Verney se révèle donc bien vite plus amusant, notamment par ce machisme tranquille qu’il dispense au détour d’un échange anodin avec la jeune Catherine. Jouant les hôtes attentionnés, il s’enquiert de savoir si son invitée a faim afin de lui préparer à manger. Et puis sans l’air d’y toucher, il lui demande si elle sait cuisiner, sous-entendant par là que ce sera à elle de passer derrière les fourneaux. Célibataire endurci, ou en tout cas présenté comme tel, John n’est pas homme à se formaliser, bonne sœur ou pas bonne sœur en face de lui. Cependant, le récit ne l’entraîne guère sur les chemins de la tentation. Il porte constamment sur sa jeune protégée un regard compatissant plutôt que concupiscent même si, au terme d’une nuit particulièrement agitée, il la surprend la chemise de nuit trempée de sueur, première étape dans l’érotisation du personnage. A mesure que Catherine s’ouvre au monde – à 18 ans, c’est la première fois qu’elle quitte la quiétude de son couvent bavarois pour le tumulte de la ville – elle perd en rigorisme. La blanche colombe devient femme et Peter Sykes n’hésite pas à jouer de l’image de la bonne sœur qu’on encanaille, quand bien même sa comédienne ne fusse seulement âgée de 15 ans. Pour sa deuxième expérience au cinéma après Faux mouvement de Wim Wenders, Nastassja Kinski se retrouve déjà réduite à son physique. Beauté diaphane dont le port de la guimpe ne révèle au début que le joli minois d’où émergent ses lèvres pulpeuses, Catherine/Nastassja sera ensuite placée au cœur d’un simulacre de rapport sexuel avec une représentation du Malin puis se dévoilera dans le plus simple appareil devant un John Verney médusé. Le rapport au corps féminin se fait plus direct que par le passé comme en atteste cette cérémonie de la procréation où tous les membres de la secte partent dans une transe charnelle, forniquant et se flagellant à tout va, suivant leurs bons plaisirs. La suggestion laisse place à l’illustration mais sans la folie visuelle d’antan. Les personnages s’ébattent dans des décors naturels certes plutôt jolis – l’église de l’affrontement final, par exemple – mais guère magnifiés par une photographie désespérément terne, hivernale même. A titre de comparaison, le choc visuel est de la même teneur qu’entre la période de Chapeau melon et bottes de cuir de la deuxième moitié des années 60 et celle de sa renaissance avec Purdey et Gambit autour de ce bon vieux John Steed la décennie suivante. Et en guise d’ultime lien avec la série, Honor Blackman – première Steed’s girl de l’histoire – joue ici les utilités.

En soi, Une fille… pour le diable n’est pas déshonorant. Il bénéficie globalement d’une interprétation solide (mention spéciale à Denholm Elliott en père terrassé par la peur) et contient quelques belles scènes. Je retiendrai notamment ce montage alterné entre le difficile enfantement de l’avatar d’Astaroth et son ressenti par sa prochaine mère porteuse. Mais tout cela manque d’emphase et de caractère. La Hammer n’avait alors plus grand chose de singulier à apporter et cela se sent.