Ticks – Tony Randel
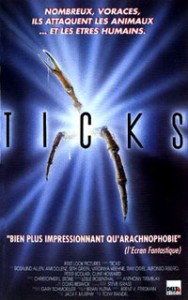 |
Infected. 1993Origine : Etats-Unis
|
Une poignée de jeunes à problèmes s’en vont passer quelques jours en forêt en compagnie de leurs deux éducateurs et de leur fille. Ils quittent la jungle urbaine de Los Angeles pour la vraie jungle, ou plutôt la forêt, tout aussi dangereuse : des paysans psychopathes y font pousser de la marijuana à l’aide de stéroïdes, ce qui a donné naissance à de voraces tiques mutantes.

Des jeunes en forêt, des bestioles méchantes, un casting plein d’acteurs issus de séries télévisées (dont Alfonso Ribeiro, sous-fifre de Will Smith dans Le Prince de Belair), trois raisons de penser que Ticks n’est qu’un direct-to-video comme il en existe tant d’autres, avec effets spéciaux ratés, humour au ras du gazon et horreur inexistante. Et pourtant si tous les films du genre étaient comme Ticks, il y a longtemps qu’une firme comme Nu images aurait égalé le prestige de la New World Pictures de Corman au rayon du cinéma indépendant. Tony Randel, qui vient d’ailleurs du giron de Corman et n’avait plus fait grand chose de terrible depuis l’excellent Hellraiser II, réalise là un film tel que devraient l’être toutes ces modestes productions animalières. Ses jeunes ont beau être caricaturaux (le gentil héros rêveur, le dur, le latino aux gros bras et sa blondasse, la gentille fille, la jeune timide), ils n’intéressent pas le réalisateur plus que de raison. Randel les détourne même de leur destin programmé. Ainsi le dur des quartiers chauds de Los Angeles cesse très vite de jouer les petites frappes, le mexicain adepte de la gonflette fait preuve d’un sang-froid qu’on ne lui imaginait pas, sa copine remise sa coquetterie au placard lorsque le moment s’en fait sentir, la fille enfermée dans son mutisme ne s’épanche pas et le héros est comme tout le monde : il ne la ramène pas, même pas pour impressionner la fille de ses éducateurs, avec laquelle il ne construit rien de plus que de l’amitié. Pas de démagogie, pas d’humour graveleux. Tout ce petit monde ne revient pas pour autant dans le droit chemin sitôt placé face à l’adversité : ils restent eux-mêmes, c’est à dire ni trop bêtes ni trop intelligents, ni trop rebelles ni trop intégrés.

Contrairement à beaucoup de ses collègues qui placent leur jeunes protagonistes au premier plan tout en les tournant en ridicule, Randel les utilise de façon fonctionnelle, en les laissant à leur place (c’est à dire en ne leur permettant pas de devenir plus importants que les tiques mutantes) tout en les développant suffisamment pour provoquer l’empathie, jusqu’à ce qu’aucun d’entre eux ne paraisse plus comme une victime en puissance. Lorsque l’un d’entre eux meurt, cela devient donc une surprise, surtout que cette mort est un véritable acharnement étalé sur de longues minutes. Même après sa mort, ce personnage n’a pas finit son calvaire ! C’est même là que son corps est le plus martyrisé. Les tiques ne sont pas des tueuses de slashers boisés : elles sont là pour se gonfler de sang. Le film se montre très généreux en gore, et même lorsque les bêtes ne sont pas présentes -au début-, Randel les remplace efficacement en dissimulant leurs larves purulentes là où les personnages ne peuvent les voir, ou même en s’attardant sur les difficultés d’un type (Clint Howard, l’un des deux Howard du film avec Rance, son père, qui joue le shérif du coin) qui se meurt à petits feux et en petites giclés sanguinolentes du fait de la présence des insectes à l’intérieur de son corps. Assez semblables aux araignées dans leur animation, les tiques sont utilisées en fonction de la répulsion qu’elles inspirent, décuplée lorsque l’une d’elles vient à être écrasée et que le sang contenu dans son corps bouffi gicle partout.

Elles ne sont pourtant pas les seules menaces pour nos citadins, puisque leurs créateurs ne valent pas mieux qu’elles. Ce sont deux péquenots qui pour palier à une économie en crise se sont mis à cultiver la marijuana, ce qui contrairement à ce que l’on peut penser (c’est le réflexe « Vendredi 13« ) ne leur vaut pas l’amitié des jeunes à problèmes. Eux aussi sont pourtant des caricatures : leur personnalités beaufs et leur usage des stéroïdes aurait pu conduire Randel à se montrer excessif, mais comme pour les jeunes ce n’est pas le cas. Ils sont utilisés pour apporter quelque chose à l’action, à savoir un danger supplémentaire. Munis de fusils, ils tombent le masque dès que la présence des tiques est connue de tous. Ce qui conduit à une très bonne dernière partie de film, un huis-clos dans une cabane à l’intérêt double : les tiques à l’extérieur (pas pour longtemps), les deux cinglés à l’intérieur. Plus qu’à Evil Dead, traditionnelle référence des films d’horreur forestiers, Randel évoque La Nuit des morts-vivants voire même Les Oiseaux via la sortie pour atteindre la camionnette.
Tout en respectant scrupuleusement le cahier des charges des films à bestioles, Ticks tire son épingle du jeu en se montrant aussi direct qu’un film des années 50 et aussi gore qu’un film des années 80. C’est la bonne série B typique, produite par un Brian Yuzna décidément plus fortiche en producteur qu’en réalisateur.





