Passez une bonne nuit – Jeannot Szwarc
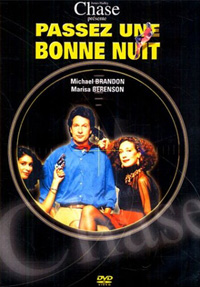 |
Passez une bonne nuit. 1990.Origine : France
|

Après 2 ans loin du circuit, la comédienne Barbara Jenkins (Marisa Berenson) revient en pleine lumière pour mener une action caritative en faveur de la lutte contre le Sida. Détentrice d’un joyau assuré pour 5 millions de dollars, elle doit composer avec les présences insistantes de Tom Lepski (Michael Brandon), mandaté par son employeur pour veiller sur le bijou, et du commissaire Ottavioni (Guy Marchand), en charge de sa sécurité. Une sécurité mise à mal dès la veille de son arrivée à l’hôtel Majestic lorsqu’un importun, surpris par Tom dans la suite réservée à la star, a préféré se suicider plutôt que répondre de ses actes. Bien qu’informée des événements, Barbara Jenkins ne fera rien pour faciliter la tâche d’un Lepski qui s’en arracherait les cheveux à la voir sortir en toute circonstance, le précieux bijou attaché autour du cou.

Sergio Gobbi se fiche comme d’une guigne que ses très libres adaptations des romans de James Hadley Chase doivent momentanément quitter le grand écran pour le petit. Avec les maigres moyens dont il dispose, il tente malgré tout de conférer une patine grand luxe à ce Passez une bonne nuit. Transposer les aventures de Tom Lepski sur la Riviera lui impose un certain standing auquel il se conforme en requérant les services de quelques noms plus ou moins prestigieux à la carrière déclinante. C’est ainsi qu’il a pu attirer dans son escarcelle l’actrice Marisa Berenson (Mort à Venise, Barry Lyndon) et le réalisateur Jeannot Szwarc (Les Dents de la mer 2e partie, Quelque part dans le temps, Supergirl), des noms pas forcément très connus du grand public au contraire de certains de leurs films dont les titres suffisent à titiller l’imaginaire, et donc propices à encourager les ventes à l’étranger. Tout cela n’en demeure pas moins de la poudre aux yeux, le résultat s’avérant tout aussi insipide et mollasson que Le Denier du colt et Présumé dangereux. A l’image du héros en somme, véritable boulet à l’indolence contagieuse.

Je me doute qu’au terme du troisième film chroniqué, ma diatribe à l’encontre de ce Tom Lepski puisse être perçue pour de l’acharnement. Et vous n’auriez pas tort. Après tout, d’un strict point de vue professionnel, le bougre remplit son office. Chargé de veiller à ce que le bijou de Barbara Jenkins ne soit pas dérobé, il s’acquitte fort bien de sa tâche. Si ce n’est ce voleur à la tire trop audacieux, il n’a du reste pas grand chose à faire. Alors il trompe l’ennui en apportant son aide -peu efficace- à son ami le commissaire Ottavioni, et redonne goût à la vie à la star au cœur meurtri en couchant avec elle. N’allez pas croire, Lepski n’est pas non plus un saint. Il sait aussi se comporter en parfait goujat, préférant taper le carton avec des amis plutôt que passer une soirée en compagnie de Carole, sa chère et tendre, moyennant quelques mesquins stratagèmes. Il est comme ça, Tom, un vrai gamin ! Une fois qu’on a compris que Tom Lepski fait tout en dilettante, on a cerné le personnage. L’ennui, c’est que le héros qui prend un air détaché en toutes circonstance, et qui plus est desservi par une intrigue saugrenue, ne favorise pas la compassion. Je me répète mais le Tom Lepski employé d’une compagnie d’assurance ne revêt aucun intérêt. A tel point que le commissaire Ottavioni, passionné par les recettes de plats à base de poissons et incollable au sujet de Barbara Jenkins, lui vole aisément la vedette. En même temps, entre Michael Brandon et Guy Marchand, il n’y a pas match possible. Même au service d’un personnage ingrat, Guy Marchand s’en sort avec les honneurs. Ce qui est loin d’être le cas de Jeannot Szwarc, incapable de transcender une intrigue pour le moins volatile.

A trop vouloir s’écarter du roman original, les scénaristes se sont fourvoyés dans un salmigondis d’intrigues sans queue ni tête. Pour résumer, Barbara Jenkins doit faire face à deux menaces. La première est incarnée par Bradley. Ce voleur trop gourmand voit dans la présence de la comédienne au Majestic l’occasion rêvée de frapper un grand coup, mais toujours à l’insu de Tom Lepski. David Carradine voguant vers d’autres galères, il revient à Marc de Jonge de reprendre le rôle en toute discrétion. L’ennemi juré de Lepski n’a même plus le droit de lui donner la réplique. Il agit donc en douce, dénué de tout ressentiment envers celui qui avait tout gâché, mais toujours prêt à tout pour arriver à ses fins, même de donner sa copine en pâture -la plantureuse Daisy- à un employé de l’hôtel pour lui soutirer quelques informations en douceur. L’élaboration de son plan, et son exécution -inachevée-, occupe une bonne part du récit pour un résultat qui laisse perplexe. Bradley et ses sbires servent de manière un peu trop évidente à meubler une intrigue qui sans eux n’aurait pas grand chose à proposer. Malheureusement, la greffe a du mal à prendre tant l’extension du plan initial de Bradley au vol du bijou de la star relève de la désinvolture la plus tenace. Mais que penser alors de cette autre sous-intrigue qui tourne autour des Purificateurs, nom d’une secte de fanatiques religieux qui veulent s’attaquer à cette « horrible Babylone [qui] renaît de ses cendres » ? Qu’ils voient en Barbara Jenkins et en ce qu’elle représente les symboles de la corruption et de la déchéance de la société, pourquoi pas. En revanche, leur mode opératoire laisse dubitatif, et remet une fois de plus en question l’implication des scénaristes. Pour résumer, le plan des Purificateurs est simple : se servir de la comédienne comme d’une monnaie d’échange. Si le message que la secte adresse à la face du monde obtient les faveurs de la grande messe du 20h, alors Barbara Jenkins vivra. Sinon, couic ! Mais pourquoi diable mettre leur plan en pratique une fois qu’elle a regagné la civilisation (elle a vécu recluse deux années durant dans son château en Sardaigne) et qu’elle bénéficie de l’attention de la police et de Tom Lepski alors que la secte disposait d’une personne dans son entourage depuis 3 mois ? La question reste en suspend. A moins qu’en réalité le scénario ne se montre plus subtil que je ne le décris, et qu’il traite en filigrane de l’importance de la médiatisation dans le ressenti des gens. Ainsi, Barbara Jenkins ne devient une monnaie d’échange intéressante qu’une fois rappelée au bon souvenir du grand public, et non prostrée dans son chagrin à l’abri des regards indiscrets. J’en conviens, cela paraît quelque peu tiré par les cheveux, d’autant que la charge sur une presse plus avide de potins que de grandes causes humanitaires ne dépasse jamais le stade de l’anecdote. L’un des problèmes de la série est de justement refuser de s’aventurer plus avant sur l’envers du décor de ce monde de strass et paillettes de la jet-set azuréenne, sans doute pour ne pas froisser une municipalité déjà bien aimable d’attribuer des autorisations de tournage à la production.

Au terme de trois épisodes (sur quatre!), la série démontre une belle constance dans la médiocrité. C’est emballé sans génie, ça ne cherche pas à compenser la pauvreté des intrigues par des scènes spectaculaires, et en plus ce n’est jamais drôle. Morne est le qualificatif qui lui convient le mieux. J’en viendrais presque à regretter les héros récurrents de TF1 !
NB: Pour ceux qui s’interrogeraient sur la signification du titre de l’épisode, n’y voyez-là aucun second degré. Non, les auteurs ne nous enjoignent pas à un bon dodo bien qu’ils aient tout tenté pour nous plonger dans les bras de Morphée. Ce titre renvoie au film par lequel Barbara Jenkins marque son grand retour au cinéma, et qui n’a été possible que grâce aux bons soins du sieur Lepski. Merci à lui.





