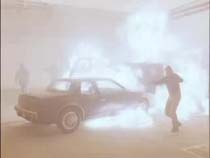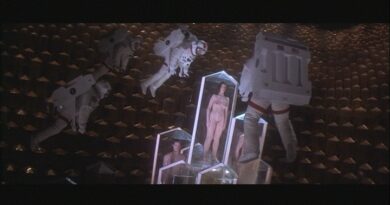Le Justicier braque les dealers – J. Lee Thompson
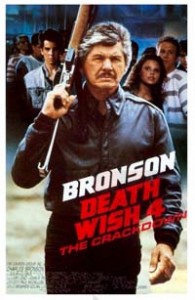 |
Death Wish 4 : The Crackdown. 1987Origine : États-Unis
|
Probablement un peu masochiste, Paul Kersey s’est remis en couple avec la belle Karen (Kay Lenz), dont la fille Erica fait naître en lui des sentiments paternels. Il n’en fallait pas plus pour que des méchants viennent une fois encore briser sa vie. Erica est retrouvée morte d’une overdose. Abattre le dealer du coin n’est qu’une broutille, et c’est pour ça que Paul accepte l’offre du riche éditeur Nathan White (John P. Ryan), dont la fille est morte dans les mêmes circonstances qu’Erica. Le marché est de plomber les deux principaux clans de la ville, celui de Ed Zacharias et celui des frères Romero. White s’engage à fournir toutes les informations sur les membres importants des deux gangs, et Paul n’a plus qu’à agir sur le terrain.
Michael Winner parti, il ne pouvait y avoir que J. Lee Thompson pour prendre sa relève à la tête de la série du Justicier dans la ville, passée depuis le deuxième volet aux mains de Golan et Globus et de leur Cannon. L’association solide de Thompson avec Charles Bronson et la fidélité des deux à la Cannon rendaient cette nomination inévitable. D’autant plus que depuis le début de la décennie, le duo ne faisait pas autre chose que de tourner autour du thème central de la série. Les voilà donc en train de faire le quatrième opus deux ans après le précédent, qui avait marqué la fin de toute prétention au réalisme et à la polémique. Après avoir fait jaser dans le premier film, Winner quittait le navire en orchestrant un feu d’artifice d’action pétaradante et outrageusement gratuite, au risque de déplaire à une critique préférant encore disserter que de se pencher sur de l’action aussi mastoc. Lui aussi naguère réputé pour les polémiques engendrées par ses films (Les Nerfs à vif notamment), Thompson est désormais considéré comme un faiseur d’action standard, et il n’est guère envisageable qu’il revienne faire du sérieux à l’occasion d’une troisième séquelle aux moyens moindres que les précédentes. Et pourtant, il revient à quelque chose de moins exubérant. Le Los Angeles qu’il prend pour cadre n’est pas un repère de gangs punks aux accoutrements pittoresques faisant régner la loi de la jungle. C’est un Los Angeles contemporain assez réaliste, dans lequel des sauvages ne viennent pas vous sauter dessus dès que vous mettez le pied dehors. Le Justicier braque les dealers opte pour un cadre de polar urbain fait d’entrepôts, de magasins, d’appartements privés, de terrains vagues… Une pléthore de lieux guère dépaysants. Le plus fantaisiste que l’on puisse y trouver est une salle d’entraînement pour adeptes du roller à l’éclairage disco (que le réalisateur exploite dans sa mise en scène, certes). A l’inverse, il ne fait pas non plus dans la grande noirceur et dans le malsain comme l’avait fait Winner en 1974 voire en 1982. Une seule scène pourrait se rattacher à cette mouvance, la première du film, mais il s’avère que celle-ci est un simple cauchemar. En réalité, peu d’attention est accordée aux décors, ceux-ci ne donnant pas véritablement de cachet esthétique au film, qui de ce point de vue manque même un peu d’identité.
La pédale douce est également mise sur les exactions commises par les méchants du film. Ceux-ci subissent la vengeance de Kersey, mais à la différence des trois films précédents ils ne commettent pas de crime direct. Ils vendent de la drogue, Erica a fait une overdose, le message véhiculé est clair (la drogue, c’est mal) mais l’effet psychologique est quand même bien moindre que les viols et les meurtres froids pour lesquels la série est connue. Même Karen, la copine de Paul, est tenue à l’écart pendant la majeure partie du film. Par conséquent, J. Lee Thompson décide de faire l’impasse sur l’implication émotionnelle du spectateur. Les petites gens sont complétement absentes du film, ne souffrent en rien ni des gangs -vivant à l’écart du vulgum pecus- ni de Kersey, lequel infiltre ses ennemis pour orchestrer sa vendetta aux plus hauts échelons, loin de la rue. Pour autant, ce n’est pas pour ça que Kersey se prend pour un enquêteur minutieux et réfrène ses élans violents. Là réside la justification du personnage de Nathan White : puisque celui-ci fournit à Kersey toutes les informations dont il a besoin, le vigilante n’a plus qu’à frapper sans se faire pincer. Tâche que l’on peut juger difficile lorsque l’on débarque à droite et à gauche avec de grosses pétoires, mais il est vrai que Kersey est épaulé par des gangsters qui ne sont pas particulièrement brillants, puisqu’ils passent tout le film à se demander si c’est la concurrence qui lance la guerre (ils souffrent aussi du syndrome des années 80 : une quinzaine de bonshommes armés ne sont pas foutus de descendre un type seul face à eux, et ils préfèrent parfois palabrer que de tirer lorsque leur proie est à leur merci), et par une police valant à peine mieux. C’est sûr, il ne faut pas être très regardant sur les modalités de la vengeance… Auquel cas il ne faudrait de toute façon pas regarder la quête de notre architecte sexagénaire, campé avec le monolithisme habituel d’un Charles Bronson qui a toujours l’air d’avoir la tête ailleurs.
En ayant recours à ce genre de subterfuges (refus du sentimentalisme, enquête prémâchée par un personnage secondaire, grossiers raccourcis pour arrondir les angles) Thompson prépare le terrain pour son seul et unique objectif : l’action. Le scénario n’est rien d’autre qu’un empilement de scènes dans lesquelles Kersey règle son compte aux gangsters, souvent avec la manière forte. On lui en a trop fait : il ne correctionne plus, il dynamite, il disperse, il ventile ! Pas de palabres inutiles, à peine quelques bons mots parfois joliment narquois de part et d’autre, Kersey est là pour dynamiter tout un atelier à lui seul, orchestrer une confrontation des deux gangs ou plus simplement mitrailler un bandit. Cela aurait pu être répétitif et lassant, mais Thompson étant un habile metteur en scène, il parvient à diversifier suffisamment le spectacle, que ce soit en changeant de cadre, en donnant une nouvelle arme à Kersey (ça va du poing au lance-grenade), en variant le nombre de figurants impliqués et en recourant à un rebondissement final qui, loin d’ajouter un supplément dramatique, vient au contraire faire virer le film à la farce (la dernière scène est un beau moment d’action maousse). Du reste, bien que l’humour ne soit pas particulièrement prononcé, le ton du film ne s’est jamais départi de cette bonhommie que trimbale Charles Bronson du fait de son jeu limité. Pas besoin d’en faire des tonnes dans les clins d’œil : Thompson et Bronson savent suffisamment ce qui plait au public de ce genre de film (à savoir de l’action non stop) pour éviter d’avoir à le réveiller en brisant le fameux quatrième mur cher aux théoriciens des arts du spectacle.
Notons enfin que ce quatrième volet du Justicier dans la ville avait pourtant débuté par cette séquence de cauchemar déjà mentionnée plus haut, dans laquelle Kersey venait en aide à une automobiliste en passe d’être violée par trois individus cagoulés dans un garage. Retournant un des assaillants gisant sur le sol, Kersey découvrait que cet homme n’était autre que lui même. Un peu de freudisme de bazar nous amenait à penser que Kersey prenait conscience qu’être un vigilante faisait aussi de lui un meurtrier. Ce cauchemar et sa signification sont sans lendemain dans le film, mais le raisonnement, que l’on peut voir comme une mise en garde adressée aux vigilantes de la vie réelle (après tout Bronson a lui-même appelé au calme après l’affaire Bernhard Goetz, du nom de cet homme qui en 1984 ouvrit le feu sur quatre agresseurs dans le métro), mérite d’être mentionné. Ni Thompson ni Bronson et encore moins la Cannon n’étant alors en mesure de porter un film qui aurait développé ce sujet, on peut se féliciter qu’il ait été réduit à une introduction en forme de parenthèses. Il valait effectivement mieux rester sage et livrer le sympathique film d’action qu’ils nous ont offert.