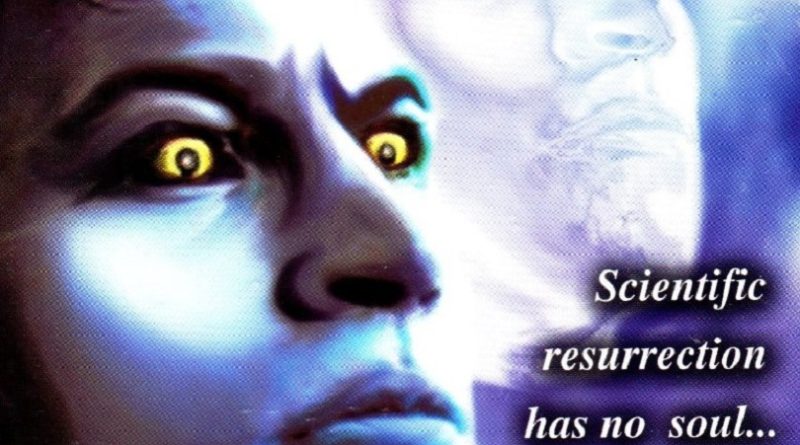Chiller (aka Terreur froide) – Wes Craven
 |
Chiller. 1985Origine : États-Unis
|
Par une belle soirée, Marion Creighton apprend le retour paradoxalement aussi probable qu’imprévu de son fils Miles. C’est une bonne surprise : voici dix ans déjà que son fils est cryogénisé dans l’attente de progrès scientifiques capables de résoudre ses problèmes cancéreux. Voilà donc le retour de Miles d’entre les morts, preuve probante du bienfondé de la cryogénisation. L’homme rentre chez lui et retrouve son travaille de PDG dans la fructueuse entreprise familiale. Mais il n’est plus comme avant : il est froid, dépourvu de sentiments et même méchant. Se pourrait-il, comme le pensent le curé de la famille et l’auteur du résumé au dos de la jaquette VHS française, que Miles ait « perdu son âme en dégelant ? ».
On aurait pu penser qu’après le succès mérité autant critique que commercial de ses Griffes de la nuit, Wes Craven allait mettre définitivement un terme à sa période creuse (qui courait depuis 1978 et L’Été de la peur), et qu’il allait enfin confirmer les espoirs placés en lui après ses deux excellents premiers films que furent La Dernière maison sur la gauche et La Colline a des yeux. Mais c’était sans compter sur l’incompréhensible plan de carrière du réalisateur, qui pour des raisons soit-disant artistiques refusa de tourner la suite des aventures de Freddy pour réaliser l’ignoble Colline a des yeux 2 et pour retourner dans le monde impitoyable du téléfilm avec ce Chiller commandité par CBS Television. Des choix assez incompréhensibles qui marquèrent l’un comme l’autre un net recul par rapport aux Griffes de la nuit. Chiller, à défaut d’être un chef d’œuvre, aurait pourtant pu être un bon film. En dépit de son budget réduit assez apparent (le côté téléfilm se fait ainsi pas mal sentir), Craven réussit malgré tout à se montrer inspiré, bien plus par exemple que pour la première Créature du marais venue. A l’instar de son personnage principal, son film est froid, sobre, visuellement épuré sans être bâclé, et Craven adopte un rythme assez lent, ancrant son film dans le plus grand réalisme possible. La gestion du retour à la vie de Miles est ainsi très réussie, le réalisateur ne faisant l’impasse sur aucune étape du processus de réanimation (dégel, opération, coma, réveil), leur conférant un climat assez macabre propice à créer un certain sentiment d’angoisse chez le spectateur, qui attend fébrilement le réveil de Miles. Quand celui-ci est définitivement revenu d’entre les morts, il répond à nos attentes : il est d’une élégance très froide, très distante, et son interprète, Michael Beck, semble nous donner sa version à lui d’un Damien Thorn devenu adulte : il vit dans un milieu aisé, et il dissimule sa méchanceté par un sourire démoniaque. On s’attend dès lors à voir le malaise s’installer dans son entourage. Pas de bol, à force de faire un film glacial, Craven dérape et se met alors à nous prouver la méchanceté de son personnage par tout un tas d’actions à peine dignes de scandaliser les ménagères confortablement installées devant leurs téléviseurs. Miles tue le chien de la famille, Miles mate sa sœur en sous-vêtements à travers un trou dans le mur, Miles ne donne plus d’argent aux bonnes œuvres (!), Miles maltraite sa secrétaire, Miles licencie celui qui le suppléa en son absence, et il va même jusqu’à lui provoquer une crise cardiaque dans une cage d’escalier. Quel enculé, ce Miles ! Tout ceci, peut-être imputable aux exigences télévisuelles, n’est que futilités venant rompre le charme installé par Craven dans la première partie de son film et dans sa mise en scène. Mais le pire n’est pas là : le pire sont les consonances chrétiennes réactionnaires que prend le film sitôt que le personnage du prêtre s’intéresse au cas de Miles (c’est à dire après qu’il eut appris que Miles cessait les donations à la paroisse !). Car ce qui n’était alors qu’une théorie va devenir certain : si le corps de Miles est revenu d’entre les morts, son âme, elle, est restée au ciel. Puisque cette explication n’est pas sujette à controverse, on en déduit que la science n’est rien face à la religion, et que seul Dieu a droit de vie et de mort sur ses ouailles. Ben voyons. Craven, que l’on pensait pourtant assez ouvert d’esprit (l’un de ses thèmes fétiches, reflété surtout dans ses deux premiers films, n’est-il pas après tout la dualité du bien et du mal chez les individus ?) verse dans le réactionnaire le plus crasse. On peut aisément lui pardonner de traiter un thème chrétien, celui de la science contre Dieu, mais en revanche on ne peut que désapprouver sa prise de position dépourvue d’ambiguïté. Là où un film comme Frankenstein, sur un thème similaire, faisait la part belle aux réflexions et évitait tout jugement catégorique (le monstre étant autant victime que bourreau), Craven sombre dans le simplisme moralisateur, descendant des films de prévention gouvernementaux des années 50 et continuant à caresser la ménagère dans le sens du poil.
Ce mélange entre La Malédiction et le mythe de Frankenstein (sans compter le générique du début, avec l’apparition du titre Chiller identique à celle du titre The Thing, dans le film également très « froid » signé John Carpenter) n’est pas la meilleure idée qu’ait eu Craven, loin s’en faut. Il y dévoile une facette idéologique que l’on ne lui connaissait pas, et que l’on n’a heureusement plus revue depuis (on venait de rater la transplantation mammaire de sa femme ou quoi ?!). Il est dommage que l’application de sa mise en scène soit au service d’un tel sujet bondieusard, s’achevant d’ailleurs sur la victoire d’une grenouille de bénitier devenue courageuse héroïne.