Halloween II – Rob Zombie
 |
Halloween II. 2009.Origine : États-Unis
|
Une année s’est écoulée depuis le massacre perpétré à Haddonfield par un enfant du pays, le tristement célèbre Michael Myers. Laurie Strode vit désormais avec son amie Annie Brackett, autre rescapée de la tuerie, dans une immense maison en bordure de la ville sous l’œil attentif et protecteur du shérif Brackett. Les deux jeunes femmes sont toujours traumatisées par les événements. Annie n’ose plus mettre un pied dehors alors que Laurie tente tant bien que mal de se reconstruire, notamment en consultant une psychiatre. Elle lui fait part des cauchemars qui troublent ses nuits lors desquels Michael Myers cherche inlassablement à la tuer. De son côté, le docteur Sam Loomis exploite le drame à son profit, sillonnant les États-Unis en compagnie de son attachée de presse pour faire la promotion du livre qu’il a écrit sur Michael Myers. Pour lui, pas de doute possible, le tueur de Haddonfield est bel et bien de l’histoire ancienne. Pourtant, cette silhouette massive qui sillonne la campagne en laissant de nombreux cadavres derrière elle, et qui semble suivre un but précis, viendra lui prouver le contraire.
Sorti dépité de l’expérience Halloween, Rob Zombie ne veut plus en entendre parler. Un sentiment que, dans une convergence d’opinions assez inédite entre critiques et critiqué, nous partageons pleinement à Tortillapolis. Contractuellement lié à Dimension Films pour encore un long-métrage, le réalisateur-musicien écarte l’idée d’une suite au profit d’un projet qui lui tient à cœur, et dont il est l’auteur, Tyrannosaurus Rex. Pour l’occasion, il délaisse l’horreur au profit du drame en suivant le dur retour à la réalité d’un boxeur déchu qui tente de reprendre pied après un séjour en prison. Pour Malek Akkad, l’homme qui préside à la pérennité de la série à la suite de son père, pas question pour autant de lâcher le filon. Tant que Michael Myers fait recette, il poursuit l’aventure paternelle, bien décidé à donner au public ce qu’il plébiscite. Dans ces conditions, que Rob Zombie boude dans son coin n’est pas un problème tant se bousculent les candidats prêts à accoler leurs noms à la franchise. Julien Maury et Alexandre Bustillo, par exemple. En relation avec le studio des frères Weinstein depuis que ces derniers assurent la distribution de A l’intérieur sur le sol nord américain, le duo français ne cache pas sa joie à l’idée de faire partie de l’aventure. Ils travaillent sur un scénario qui s’attache dans un premier temps aux 15 ans d’internement de Michael Myers à Smith’s Grove en se focalisant sur son adolescence avant de reprendre le cours des événements du premier film pour une nouvelle traque meurtrière. Ils n’iront pas plus loin dans le projet. Devant l’inintérêt que suscite le scénario de Tyrannosaurus Rex, Rob Zombie se résout à donner lui-même une séquelle à son remake. Pas rancunier, Malek Akkad accepte volontiers ce revirement, laissant les deux français à leur déception. Qu’on se rassure, ils sauront vite rebondir et quelques années plus tard, leur Leatherface reprendra les grandes lignes de leur scénario de travail. De quoi rester pantois devant tant d’inventivité.
Rob Zombie se lance dans le tournage de cette suite la rage chevillée au corps. Cette colère rentrée trouve une forme d’exutoire à travers les meurtres de Michael Myers, tous d’une grande brutalité. Chaque coup de poignard équivaut à un coup de boutoir à la gestuelle très ample et qui lui coûte tellement d’énergie qu’il en ahane. Pour la première fois, un son sort de la bouche du tueur. Rob Zombie a même poussé le bouchon encore plus loin puisque dans la scène de fin disponible dans le director’s cut, son Michael Myers accentue son retour à une ébauche d’humanité en allant jusqu’à prononcer quelques mots. Un choix qui a forcément été mal accueilli par la production mais qui illustre parfaitement la direction dans laquelle Rob Zombie souhaitait aller. Pour cet Halloween II, il ne veut plus entendre parler de l’héritage carpentérien et décide de s’écarter au maximum de ce que le public peut attendre de cette séquelle. Pour cela, il joue avec lui, notamment lors de cette longue séquence dans l’hôpital où Laurie a été admise. Mal en point, un pied dans le plâtre et couturée de toutes parts, elle tente tant bien que mal de réchapper à un Michael Myers furibard, bien décidé à finir le travail. Et au moment où le croquemitaine semble avoir partie gagnée, Laurie se réveille en sursaut. Tout cela n’était que l’un des nombreux cauchemars qui polluent ses nuits depuis sa première rencontre avec le tueur de Haddonfield. Outre la déception aux confins de l’irritation que peut procurer ce flashback (à force de films d’horreur, on sent vite venir le subterfuge), la séquence en question jette les bases de la personnalité de cette nouvelle Laurie Strode. Une femme en lutte perpétuelle avec ses démons mais qui tente de les surmonter coûte que coûte. Désormais versée dans le rock metal, sa chambre est un agglomérat de posters de groupes divers -dont Alice Cooper- et de personnalités maléfiques (un immense portrait de Charles Manson trône au-dessus de son lit) qui tend à envahir toute la maison. Avec ses pans de peintures noires et ses tags, la salle de bain ressemble davantage aux lieux de commodité fatigués d’un club miteux qu’à la pièce d’eau d’une agréable maison de campagne. Laurie trouve dans cette musique le défouloir dont elle a besoin, auquel elle ajoute des soirées de bitures en compagnie de ses deux nouvelles copines, sa collègue de boulot Mya et Harley, la croqueuse d’hommes. Rien de bien révolutionnaire, d’autant que ces éléments ne permettent jamais à Laurie d’exister autrement que comme cible désignée du croquemitaine. Ce que confirme cette aberration, au regard des intentions annoncées de Rob Zombie, de recourir au lien de parenté unissant Michael à Laurie en écho à ce qui avait été fait dans le Halloween II de Rick Rosenthal. Outre démontrer le manque d’originalité qui a présidé à la conception de cette séquelle, cet arc scénaristique souffre d’un traitement sans nuance, qui diffère peu de son prédécesseur jusque dans sa manière de tomber comme un cheveu sur la soupe en milieu de récit. Rob Zombie l’utilise pour relier deux trajectoires jusqu’alors parallèles, celle de Laurie et celle du Dr. Sam Loomis. Deux manières de surmonter un même drame pour une approche que Rob Zombie souhaite pleinement ancrée dans une forme de réalisme.
Rob Zombie se complait dans l’auscultation du Mal sous toutes ses formes. Coller sa caméra aux basques des pires salopards ne l’effraie pas le moins du monde. On peut même dire que ça l’inspire, s’ingéniant ainsi à illustrer l’extrême porosité qui existe entre le Bien et le Mal. Outre placer son cinéma dans le registre du réalisme crasseux et violent, The Devil’s Rejects démontrait une envie de complexifier les figures maléfiques, de ne pas les réduire à de simples icônes. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la première partie de son Halloween. Il ne voulait pas qu’on voit en Michael Myers le Mal absolu mais simplement le résultat d’une enfance difficile marquée par des traumatismes profonds. Une erreur monumentale qu’il reproduit ici avec ostentation. Derrière le musicien porté sur la violence et la noirceur se cache l’âme d’un vrai romantique. Rob Zombie ne peut concevoir de réaliser un film sans confier un personnage à sa femme, Sheri Moon Zombie. Interprète de Déborah Myers, la maman morte depuis belle lurette, elle ne pouvait dès lors qu’apparaître à l’occasion de quelques flashbacks. Halloween II s’ouvre d’ailleurs sur un flashback, lors duquel elle rend visite à son fils encore adolescent. Ce sera le seul. Par la suite, Rob Zombie joue la carte d’un onirisme frappé du sceau du symbolisme. Tel Jason Voorhees lors de ses premiers méfaits, Michael Myers agit ici sous l’emprise de sa mère, visualisée en déesse blanche accompagnée d’un cheval à la robe idoine. Un grand écart risible entre le goût pour le réalisme crû du réalisateur et l’aura fantastique qui accompagne la création de John Carpenter et Debra Hill. Et pourtant, Rob Zombie l’assume au-delà du raisonnable, multipliant les visions “angéliques” auxquelles s’adjoigne Michael Myers adolescent, plutôt prolixe eu égard à ses antécédents, pour un dialogue visuel entre les deux versions du même personnage. Et comme si cela ne suffisait pas, Rob Zombie multiplie les mises en abymes à l’image de cette rencontre impromptue entre Michael Myers et un gamin grimé comme il l’était la nuit où il tua sa grande sœur. En fait, Rob Zombie ne nourrit aucun dessein particulier pour son personnage vedette. Ne sachant trop quoi en faire, il le dépeint comme un marginal qui erre dans la campagne, dort dans des granges et se nourrit des animaux qu’il croise en attendant patiemment le 31 octobre. Son comportement ne répond à aucune logique. Il traîne sa lourde carcasse dans des endroits aussi étranges qu’un bar à striptease ou une fête d’Halloween, sans trop savoir s’il cherche à venger sa mère (c’est le bar où elle travaillait) ou à tuer Laurie. Alors que cette dernière est présente à la fête, Michael fait son timide, tue un couple puis s’éclipse… direction la maison des Brackett avant que sa “sœur” ne rentre. Une prévenance frappée du sceau de la maladresse scénaristique. Rob Zombie se montre plus à l’aise lorsqu’il s’attache à la trajectoire de Sam Loomis. Terminé le psychiatre en mission qui ne peut trouver le sommeil tant que son ex patient continue de semer la terreur. Place à un homme bien de son temps, cynique et intéressé, qui cherche à s’enrichir sur le dos de cette affaire criminelle dont il est partie prenante. Plus son livre remue la fange sans rien n’épargner des détails sordides de l’affaire, plus il crée l’événement. En agissant ainsi, Loomis tente de transformer un échec en réussite, de rentabiliser le temps perdu. Son arc narratif acquiert une portée méta lorsqu’il se rend à un show télévisé où il est copieusement moqué pour l’indécence et la violence de ses écrits. Un passage qui fait songer à Freddy sort de la nuit, où la fiction – Sam Loomis – et le réel – le comique Weird Al Yankovic – dialoguent de conserve. Malheureusement, Rob Zombie ternit cette réinterprétation du personnage par une tentative de repentance aussi improbable que mal amenée, gâchant ainsi la seule et maigre source de satisfaction de cette séquelle.
Dans sa manière d’illustrer la violence et de mettre en scène les actes de Michael Myers, Halloween II n’est pas à proprement parler un film d’horreur. Il serait plutôt question d’un film d’action horrifique. Rob Zombie ne cherche pas à effrayer mais à en mettre plein la vue. Sa mise en scène se veut percutante, elle est surtout brouillonne avec sa manie de filmer caméra à l’épaule et de s’appuyer sur un montage cut. Sous couvert d’appropriation du mythe, il n’aboutit qu’à un amalgame hétérogène d’éléments propres à la série et d’idées plus ou moins neuves. Peu enclin à l’idée de remake au départ, Rob Zombie aurait dû s’en tenir à ses principes. Son incursion dans l’univers initié par John Carpenter se conclut par un deuxième ratage dont je ne retiendrai que ce nouveau masque qui confère à Michael Myers de faux airs de Jamie Lee Curtis. Clin d’œil consenti ou esprit abusé, la question reste en suspens.


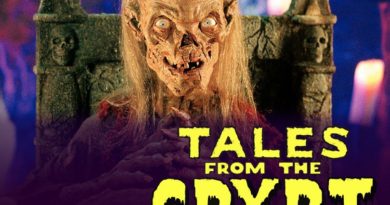


C’etait nul. Rob Zombie est un piètre réalisateur qui case sa femme dans tous ses films. Le remake et sa suite plus onirique sont des purges, que le film de David Gordon Green arrivera à effacer, avec son Halloween suite tardive mais efficace de Halloween 2 de Rick Rosenthal.
J’espère la même chose pour Halloween Kills, tout aussi efficace, et surtout aussi flippant que le premier, voir la scène de Mike Myers dans la maison de Laurie Strode, elle le traquant, inversant le point de vue du premier film.
Dans le film de David Gordon Green, le premier forfait de Michael Myers m’a marqué. On a je crois un journaliste au premier plan, et par une fenêtre à l’arrière plan on voit Michael Myers défoncer un mécano, et ces deux moments dans un même plan, fait peser la menace de Michael Myers sur le journaliste.
Je pourrais parler du climax où l’on suit Myers à la recherche de Laurie Strode dans une maison remplie de mannequins, le stress à son paroxysme, qui inverse le point de vue du premier Halloween où l’on suivait Laurie Strode qui se cachait dans la maison sans savoir où se trouvait Michael Myers.
Je pourrais rajouter le plan séquence où l’on voit Myers arriver à Haddonfield, rentrer dans une maison, tuer la locataire, sortir et continuer son massacre, un plan virtuose qui montre le parcours meurtrier de quelqu’un qui n’a plus rien d’humain.
Si je parle de ce film, c’est que tout simplement j’ai retrouvé les frissons avec ce film, là ou Rob Zombie est parti dans un délire onirique, complétement chiant, ponctué de morts fadasse tant les personnages apparaissent peu développés, ou sont des gros cons. Hormis la scène du début dans l’hôpital, qui était parfaitement maitrisée, intense mais qui est renvoyée avec à un gros doigt d’honneur, tout le reste du film sera chiant, ne racontant rien, et Zombie trouvera le moyen de caser sa femme, ce qui montre l’attachement qu’il a envers cette suite.
C’est vrai que la production du film n’a pas été aidée par la présence des frères Weinstein, aujourd’hui hors d’état de nuire, et que c’est Blumhouse qui a repris les rênes, mais Zombie a sa part de responsabilité dans les deux pires Halloween. Ça reste même en dessous de Halloween 6 et Halloween Resurrection, c’est dire l’attachement que je ressens pour ces films et son réalisateur.
Maintenant, je ne sais pas s’il y a une justice mais Rob Zombie fait ses films d’horreur avec des budgets minables tous aussi horribles les uns que les autres. Je me souviens de son film 31, tellement pénible à regarder que j’ai arrêté le film.
S’il y a une justice, j’espère que l’on gardera tous les Halloween sauf à la rigueur Resurrection et La Malédiction de Myers mais que l’on oubliera ceux de Rob Zombie.
Oublier certains titres, c’est justement ce que veulent tous ces petits malins désireux de faire de l’argent sans trop se creuser la tête, David Gordon Green au premier chef. Le plan séquence que tu loues à l’arrivée de Michael Myers à Haddonfield reprend l’entame de Halloween II, ce film dont les auteurs de ce reboot ne voulait plus entendre parler.
J’étais pas au courant qu’il avait pompé sur Halloween II de Rick Rosenthal, mais la suite qui prend pas en compte les autres films, c’est surtout qu’il y a personne qui veut faire la suite de Terminator Genesys, Die Hard: Belle Journée pour mourir, The Predator, Alien Resurrection. Il y a une question de prestige quand Bryan Singer fait son Superman Returns c’est dans la continuité de Superman II, et surtout de la version de Richard Donner, je suis pas sur qu’il s’est dit tiens je vais faire la suite de Superman IV qui se bat contre Nucléar Man. Tout le monde veut être dans les pas des grands réalisateurs qui ont fait de grands films, pas du tâcheron qui a fait un film pas terrible, ou moyen.
Ce qui dénote d’un manque d’humilité certain, d’autant que ces films qui prétendent réécrire l’histoire ne valent souvent pas mieux que ceux qu’ils dénigrent.
C’est à peu près ça. Parler d’humilité de la part d’ Hollywood c’est comme prêcher l’amour de son prochain dans une favelas à des trafiquants sous crack qui ont reçu la visite de la police. C’est pas le bon endroit pour en parler.
Par contre à ma connaissance, il y a pour moi deux cas qui ont réussi à relancer une franchise usée, ou qui menaçait de se casser la gueule. Le premier c’est Mad Max Fury Road, qui porte mal son nom tant le personnage de Furiosa est central à l’histoire, et le deuxième est Casino Royale, les James Bond de Pierce Brosnan menaçant de partir dans le n’importe quoi, avec des gadgets de plus en plus improbables, et des ennemis de jeux vidéos, Casino Royale revient à la période Timothy Dalton, en revenant à quelque chose de moins fantaisiste et plus brut de décoffrage, le personnage de Daniel Craig représentant bien cette direction terre à terre et plus réaliste.
Sinon, c’est un peu hors sujet mais un nouveau film Resident Evil va sortir, rebootant les films de Paul Anderson, plus fidèle au matériaux d’origine, il devrait reprendre les personnages et l’intrigue du premier Resident Evil. Quand ceux qui avaient descendu le travail de Paul Anderson verront le résultat, c’est à dire littéralement ce qu’ils veulent, ils comprendront que Paul Anderson avait raison de raconter une autre histoire. La fidélité n’est pas un gage de qualité, mais le temps qu’ils s’en rendent comptent…