Rose Madder – Stephen King
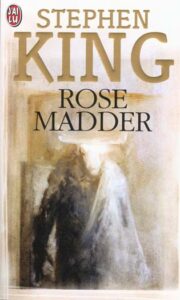 |
Rose Madder. 1995Origine : Etats-Unis
|
Cette fois, c’est la goutte de sang qui fait déborder le vase : après une énième correction conjugale, Rose Daniels sort enfin de la torpeur dans laquelle elle vit depuis 15 ans pour fuir Norman, le flic tortionnaire qui lui sert de mari. Il aura suffit qu’elle aperçoive une goutte de sang sur son drap. Profitant qu’il ne soit pas là, elle prend le minimum d’affaires et vole sa carte de crédit pour un unique retrait qui lui servira à payer son billet de bus pour une destination jugée suffisamment lointaine où elle pourra refaire sa vie. Et de fait, l’entame de ce nouveau départ n’est pas trop mal : hébergée par une association d’aide aux femmes battues qui lui trouve aussi un petit travail, Rose réapprend petit à petit à avoir confiance en elle pour affronter la société de laquelle elle a été si longtemps exclue. Elle est aussi aidée par un mystérieux tableau nommé Rose Madder (du nom du personnage qui y figure, contemplant un temple grec en ruine), dont le pouvoir d’attraction et de motivation semble sans limite… Rose Daniels, redevenue Rose McClendon, n’aura pas de trop de ses amies, de son tout frais petit ami, et de son tableau surnaturel pour repousser un Norman qui ne peut tolérer d’avoir ainsi été repoussé.
Jessie, Dolores Claiborne, Insomnie, et maintenant Rose Madder ! Voici venu le quatrième roman de rang s’attardant sur la violence faite aux femmes. Décidément, le Stephen King post-Castle Rock est un féministe militant. Cela avait marché dans les deux premiers romans, interconnectés, déjà nettement moins bien dans le troisième qui il est vrai abordait le sujet moins frontalement. Et dans ce quatrième, retour à une approche directe. Très directe même, encore plus que dans le diptyque contemplatif sachant manier la mesure à bon escient. Dans Rose Madder, plus aucune mesure : King se fait cru et radical, ne lésinant pas sur la description des violences qu’a subies Rose Norman, et s’évertuant à nous laisser imaginer l’horreur qu’elle vivrait si Norman venait à recroiser sa route. Tout est fait pour nous faire assister à son calvaire, depuis l’ouverture du roman où Rose fait une fausse-couche suite à une nouvelle série de coups pendant que Norman réfléchit à ce qu’il pourra dire aux infirmiers. Même ce que Rose cherche à dissimuler à ses camarades de l’association, King nous le dévoile via le procédé de la narration à la première personne. C’est ainsi que l’on apprend que Norman a été un jour jusqu’à lui enfoncer la manche d’une raquette de tennis dans l’anus… Pour aller encore plus loin, King nous montre même que Norman est un flic aux tendances psychopathiques, déjà mouillé dans une affaire de viol et d’assassinat. Et de tendance psychopathique, il devient au gré du roman purement et simplement fou à lier, aveuglé par la haine des femmes et de tous ceux qui les respectent. Là encore, l’auteur s’immisce dans les pensées du personnage, et fait preuve d’une bonne dose d’imagination pour trouver les termes par lesquels Norman qualifie la correction qu’il envisage d’infliger à Rose, et dont il est prêt à payer le prix par sa propre mort. Mais ce ne sont qu’une partie de ses pensées, qui s’étendent à la société toute entière. Nous sommes en plein dans la haine à l’état pur : égocentrisme, sexisme, racisme, homophobie, tout y est poussé à son paroxysme. Un tel personnage vire à la caricature du pourri intégral tel qu’on les rencontre à foison dans les grosses productions hollywoodiennes et qui sont en réalité d’un simplisme ahurissant. King s’en sort à meilleur compte grâce au fait qu’il ne se contente pas de montrer les actes (il a au contraire la bonne idée de ne pas trop dévoiler les sévices infligés aux victimes de Norman dans sa croisade d’époux contrarié) et de nous immerger dans ses pensées. Mais n’empêche que le trait est gros et sonne franchement plus comme un méchant de fiction que comme un véritable être humain.
De l’autre côté de la barricade, Rose Norman / McClendon souffre du même mal de caractérisation artificielle. Le choix de son prénom est d’ailleurs évocateur : la jolie rose, fragile et qui ne demande qu’à éclore (c’est d’ailleurs un des symboles de La Tour sombre, marronnier de la bibliographie de King) puis à se protéger avec ses frêles épines. C’est là toute la destinée du personnage, pour laquelle King cherche à créer de l’empathie non seulement via la description de ce qu’elle a pu traverser et de ce qui pèse encore au-dessus d’elle, mais aussi par le biais de sa timidité, de sa gêne, et de tout ce qui fait d’elle quelqu’un de sensible attirant la compassion. Jusque dans sa guérison, Rose est semblable à la fleur dont elle porte le nom : de la femme au foyer anonyme, elle devient une radieuse jeune femme à la sensibilité artistique remarquée (ce qui lui vaut un meilleur boulot). Prochaine étape : montrer qu’elle est capable d’user de ses épines et de se défendre… Avec son mari, elle forme donc un duo manichéen flagrant, cherchant à susciter des émotions criardes avec de grosses ficelles. Procédé convenu qu’on ne pourra donc guère apprécier. Autant se tourner vers Dolores Claiborne. En revanche, à force de nous instruire des étapes de l’arrivée inévitable de l’ouragan Norman et de ce qu’il peut infliger à ce joli champ de roses (car les amies de l’héroïne, de la frêle punk à la balaise noire funky en passant par la prolo blanche, sont du même calibre qu’elle… et ne parlons pas de Bill, le chevalier servant dont la galanterie n’a d’équivalent que la douceur), King instaure un suspense effréné. Rose Madder est ce que les américains appelle un « tourne-page », c’est à dire un roman qui se dévore plus qu’il ne se savoure. La réputation de King fait de lui un excellent auteur du genre, et c’est très réducteur. Mais pour ce livre, l’adjectif convient tout à fait. De ses quelques 600 pages en poche, on ne retient pas grand chose, mais on les parcourt très vite.
Maintenant, un dernier mot sur le tableau « Rose Madder », qui donne tout de même son nom au titre et dont le personnage constitue un modèle pour Rose McClendon. Et bien il s’agit du grand mystère du roman : quelle fut véritablement l’utilité d’avoir recours à ces interludes fantastiques ? Sachant que le tableau attire Rose, qu’elle finit par y pénétrer pour y rencontrer son modèle, on ne peut y voir qu’une portée symbolique tout à fait superflue. Le monde de Rose Madder est celui de la dévastation, et Rose Madder elle-même incarne la Rose Norman détruite par son mari, lui-même représenté par un taureau gardant tel le minotaure le trophée du labyrinthe, à savoir le bébé de Rose Madder (représentation du véritable bébé mort de la « vraie Rose »). Assistée par une femme identifiée comme étant la prostituée naguère assassinée par Norman, elle est consumée par la violence et par une rage folle. Notons que « madder » pourrait être assimilé au comparatif de l’adjectif « mad », c’est à dire « fou » (donc : « Rose en plus folle »). Les identifications sont transparentes, et encore renforcées par quelques mauvaises idées (Rose McClendon se coiffant comme Rose Madder, Norman revêtant un masque de taureau dans la partie finale)… L’intrigue, déjà suffisamment cousue de fil blanc, n’avait pas vraiment besoin de ces incartades qui en plus promettent de s’imposer -c’est gros comme une maison- dans la scène finale, là où justement la rencontre entre Norman et Rose aurait dû déboucher sur quelque chose de rationnel, venant couronner le suspense développé sur des centaines de pages. L’usage du surnaturel dans le dénouement est ainsi très frustrant. Tout ça pour un peu de mystère à peu de frais, un peu comme si King cherchait à préserver sa réputation d’écrivain de genre fantastique malgré le thème féministe qu’il arborait alors. Mais à vrai dire, le côté inconséquent de cet argument fantastique ne surprend pas : tout comme Insomnie invoquait la figure du Roi Cramoisi de La Tour sombre, King fait plus que laisser entendre que la scène du tableau est issue du monde de cette même Tour sombre, évoluant (aussi lentement que gauchement si je puis me permettre) à coups d’univers parallèles. Or, ce monde a tendance à parasiter les autres œuvres de King, parfois sans que cela ne soit préjudiciable (Cœurs perdus en Atlantide), et parfois de façon invasive, comme ici, au sein d’une intrigue simple et linéaire qui n’en avait absolument pas besoin, à moins justement de la juger trop simple et linéaire. Ce qui est bien le cas, mais ce n’est pas en y balançant des références à un univers brouillon que l’auteur peine lui-même à cerner qu’il aurait pu corriger le tir. Autant assumer la carte du simple « tourneur de page » jusqu’au bout. Avec Rose Madder, on peut considérer que l’obsession féministe de King a laissé la place à son obsession de La Tour sombre (dont le quatrième volet officiel sortira deux ans plus tard), justement parce que le féminisme qu’il y dévoile est trop caricatural, trop artificiel, pour être encore pris au sérieux. Que le roman se termine par l’intervention d’un personnage issu du monde de La Tour sombre permet d’entériner le fait que la période de transition entamée depuis la fin de Castle Rock dans Bazaar est définitivement finie…

