Blaze – Richard Bachman
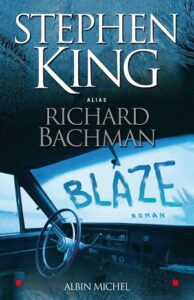 |
Blaze. 2007Origine : Etats-Unis
|
Depuis la mort de son ami et partenaire George Rackley, l’armoire à glace Clayton Blaisdell Jr. dit « Blaze » est livré à lui-même. Vu son faible niveau d’intelligence, il y a peu de chances pour que sa carrière de criminel fasse des étincelles. Pourtant, Blaze a décidé d’aller au bout du projet que George avait en tête peu avant sa mort : le kidnapping de Joe Gerard IV, héritier encore poupon de la richissime famille Gerard. Ce gros coup lui permettrait de se retirer des affaires. Mais comment y parvenir tout seul ? Et bien en n’étant pas tout seul : la voix de George continue à donner des instructions à Blaze…
La voix de George Rackley n’est pas la seule à revenir de l’oubli : celle de Richard Bachman fait même mieux, puisqu’après Les Régulateurs en 1996 c’est la deuxième fois qu’il se rappelle à notre bon souvenir depuis sa disparition prématurée au milieu des années 80. Et si le premier come-back fleurait bon le clin d’œil (bien que l’idée des Régulateurs ait été élaborée en compagnie de Sam Peckinpah avant que le pseudo de Bachman ne soit éventé, elle ne fut couchée sur le papier que plus tard), cette fois elle trouve une légitimité dans la période d’écriture de Blaze, celle des récits de jeunesse de Stephen King (début des années 70). Jugeant son roman médiocre du fait d’un surplus de sentimentalisme, King ne l’avait jamais publié, et le manuscrit finit par atterrir à la bibliothèque universitaire du Maine, récipiendaire de ses archives. Il y végéta jusqu’à ce que King se lance dans Colorado Kid pour l’éditeur Hard Case Crime, spécialisé dans le roman policier vieille école. A cette occasion, il relut Blaze et jugea qu’il pourrait en faire quelque chose après de sévères corrections expurgeant son sentimentalisme et les références historiques trop enracinées dans le contexte du début des années 70. Et c’est donc après ce ravalement de façade que se présente à nous ce Blaze qui n’est pas publié chez Hard Case Crime mais qui hérite à la fois du nom de Bachman et de son style, car remanié ou pas il y a dans le présent roman cet attrait pour la description de la misère que l’on retrouvait dans les premiers romans parus sous ce nom (Rage, Marche ou crève et Chantier). Sûrement davantage, même… Car en plus, le jeune King partait ici sous la double influence des romans noirs et de John Steinbeck, dont le superbe Des souris et des hommes est très certainement l’une des meilleures portes d’entrée entre la littérature jeunesse et le thème plus adulte de la misère sociale. Sa simplicité n’avait d’égale que sa subtilité. On ne peut pas en dire autant de Blaze, œuvre adulte mais écrite par un jeune écrivain idéaliste et chaussé de gros sabots bien bruyants qu’il n’avait pourtant pas revêtu dans ses autres livres. On comprend pourquoi King laissa Blaze en sommeil pendant tant d’années, et si l’on sent bien qu’il a fait du ménage dans le sentimentalisme il n’en a aucunement éradiqué la présence, provenant en grande partie du personnage éponyme. Tel le Lennie de Steinbeck, Clayton Blaisdell est un colosse idiot, mais il possède un cœur gros comme ça que la société a été incapable de distinguer, vouée qu’elle est à classifier les individus selon leurs origines et leurs apparences. Pour démontrer cela, le jeune King a commis l’erreur d’entrecouper son récit de flashbacks sur la jeunesse de Blaze. Non pas que cela nuise particulièrement au rythme de la lecture -ces apartés sont idéalement placés à chaque temps mort de l’intrigue-, mais l’erreur ici provient de l’acharnement avec lequel King entend démontrer que la société et le destin en général n’ont pas laissé sa chance à un gamin incarnant la bravoure même. De la décisive raclée paternelle l’affectant mentalement aussi bien que physiquement (c’est elle qui a détruit son intelligence et lui a laissé une sorte de trou dans le front) à la mort subite d’un éventuel chaperon ayant décelé sa bonne âme en passant par la brillante destinée de son fils qu’il n’aura pas connu à -encore !- la mort d’un de ses seuls ami, King multiplie les symptômes de misérabilisme et les cruelles ironies de l’Histoire. Lui qui dans son avant-propos mentionnait Oscar Wilde disant que Le Magasin d’antiquités de Dickens était à pleurer de rire à force d’étaler son misérabilisme, il ne semble pas avoir retenu la leçon. Qu’il existe des personnes pouvant par l’acharnement du sort mériter la compassion absolue, ce n’est pas faux… Mais collectionner les chapitres d’enfance voués à aligner ces malheurs n’est pas la meilleure façon qui soit de s’y prendre. Cela exigerait une biographie introduisant un peu de liant entre chaque évènement, histoire de rendre la vie de Blaze un peu moins artificielle. Et puis King, surtout à l’époque, n’était ni Steinbeck ni Zola, et la forme d’écriture employée est vraiment d’une grande naïveté. Il y met du cœur, soit, mais peu de raison. Typique du jeune idéaliste des années post flower-power qu’il a été (diatribes anti-républicains à l’appui à travers les paroles de George). C’est à se demander quelles ont été les modifications faites 35 ans plus tard.
A y regarder de plus près, il est vrai que la partie du roman au présent est moins atteinte par le syndrome du misérabilisme. L’ambition de King est encore transparente, surtout que Blaze affiche une affection de plus en plus croissante pour le bébé (et une dépendance de moins en moins forte pour les paroles cyniques de George venues de son esprit) jusqu’à ne plus considérer l’objectif pécunier comme sa priorité, mais au moins se dilue-t-elle dans le nécessaire besoin de raconter une histoire de A à Z, et non des bribes se terminant inévitablement en drames comme pour les flashbacks. A travers un style linguistique plus pesé, King s’y prend de manière plus diffuse, demandant davantage -mais pas trop quand même- de réflexion personnelle pour comprendre la misère plutôt que d’y aller en force en voulant frapper aux tripes. Ainsi, les innombrables erreurs commises par Blaze dans l’élaboration de son plan renvoient immédiatement à ses limitations mentales. Or, puisque l’on sait que le gars Blaze est un pauvre hère (pas besoin des flashbacks pour le voir), la tristesse n’en est que plus flagrante. Blaze a déclenché des forces qui le dépassent : plusieurs officines de sécurité publique, dont le FBI, la presse, la population hostile au kidnappeur qu’il faudrait selon un conducteur de poids lourds mettre à mort… Il est seul face à une société qui a fait de lui ce qu’il est devenu, son bon fond ne peut aucunement jouer, son physique évoque les soupçons et par dessus le marché la sympathie et la commisération vont à la famille Gerard, le genre de personnes riches qui condamnent les pauvres à la survie. Le message humaniste de King reste toujours bien gros, mais il n’y a pas de formulation directe, ce qui permet de faire passer la pilule. Encore que vers la fin, entre les symboliques résurgences du passé et l’affection pour le bébé devenu amour absolu (se voulant poignant avec la maladie dudit bébé), nous atteignons la limite… Mais de toute façon, la limite se trouve surtout dans le manque d’acuité de la vision sociale de King, qui en évitant d’analyser les rouages sociaux tombe forcément sur une critique du système un peu creuse, donnant l’impression qu’il ne s’agit que d’une question d’hommes méchants plutôt que d’une machinerie rendant inévitable ce genre de drame. Que d’idéalisme et que de naïveté ! Modelé sur de bonnes intentions, Blaze n’est pas vraiment à jeter en bloc. Pour autant, ce n’est pas non plus une réussite. Il souffre en outre d’une intrigue qui sur le strict point de vue policier (traité avec désinvolture : seul le commentaire social a semblé compter) n’est pas folichonne. L’ère Bachman nous a amené des choses bien meilleures, plus ludiques et plus pertinentes, ce qui fait qu’on ne peut guère invoquer l’excuse du roman de jeunesse.

