Big Sur – Jack Kerouac
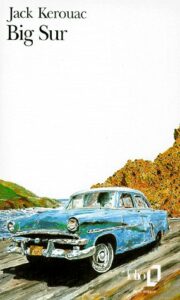 |
Big Sur. 1959Origine : Etats-Unis
|
Dans Les Anges de la désolation (et plus précisément sa deuxième partie, Les Anges vagabonds), Jack Duluoz prenait conscience de son incapacité à trouver la paix intérieure. Toujours rattrapé par ses vieux démons orgiaques amenés par ses amis Beat, il avait finit par se replier sur l’humilité toute catholique de ses racines familiales. Il s’était alors embarqué avec sa mère dans un périple à travers les États-Unis au terme duquel Duluoz mère et fils devaient emménager en Californie. Las, la vie de Jack (ainsi que ses amis) était bien trop incommodants pour sa mère, qui repartit en Floride auprès de sa fille, laissant le nouveau « Roi des Beats » mélancolique et livré à lui-même. C’est donc sans surprise que Big Sur, roman succédant aux Anges de la désolation dans la Légende de Duluoz, s’ouvre avec l’image d’un Duluoz sortant d’une énième nuit de beuverie, lui qui est désormais à l’alcool ce que William Burroughs est à la drogue. Plusieurs années se sont passées, et l’incarnation littéraire de Jack Kerouac est désormais connue de tous. Cette célébrité est intervenue au pire moment : déjà en proie à ses soucis existentiels, Duluoz / Kerouac doit en plus faire face aux journalistes inquisiteurs et aux hordes de pseudos-beatniks cherchant à croiser sa route jusque dans ce qu’il reste de sa sphère intime. Incapable de résister à ces pressions, il passe donc son temps à boire et à faire des fêtes qui au moins pour lui n’ont plus rien en commun avec celles auxquelles il s’adonnait à la fin des années 40, à l’époque des évènements narrés dans Sur la route. Il n’y a plus cette volonté de jouir de la vie, il s’agit purement et simplement des retombées de sa tendance auto-destructrice. C’est dans ce milieu particulièrement sinistre que vivote Duluoz au début de Big Sur, et auquel il essaiera d’échapper tout au long du roman en se réfugiant à Big Sur, un relief de la côté californienne où se trouve le bungalow isolé de Lorenzo Monsanto (en réalité le poète libraire Lawrence Ferlinghetti).
Il ne fait aucun doute que Duluoz sombrera à la fin du livre. Tout simplement parce que celui-ci n’est pour une bonne partie qu’un faisceaux d’indices annonciateurs de la semaine où Duluoz est devenu fou. En temps que narrateur, Kerouac l’annonce directement, et ses chapitres jusqu’à ce fameux coup de folie sont consacrés à ces indices. En réalité, tout le roman n’est qu’une vaste descente aux enfers programmée dont le protagoniste principal est d’autant plus pitoyable que l’on sait dors et déjà que ses maigres efforts pour enrayer cette spirale sont voués à l’échec. Ils sont d’ailleurs de plus en plus futiles. Le premier d’entre eux rappelle quelque peu Les Clochards célestes, puisqu’après avoir réalisé l’ampleur de son désastre personnel, Duluoz se réfugie en solitaire à Big Sur. La sérénité le regagne brièvement, jusqu’à ce que l’ennui refasse son apparition (rappelons que ce fut déjà l’ennui et le désir de se replonger dans la civilisation qui ruinèrent toute la sagesse acquise sur le pic de la désolation) et qu’il soit pris sur la plage d’un violent et soudain accès de pessimisme, attribué selon lui à l’air iodé, qui ne serait pas moins que la parole de l’océan lui intimant l’ordre de partir. La seconde tentative de retrouver la paix s’effectue avec Cody Pomeray (Neal Cassady) et plusieurs autres amis (dont Arthur Ma, en fait le futur acteur Victor Wong qui tournera notamment pour John Carpenter). Mais comment retrouver la paix lorsque Pomeray est dans le coin, accompagné d’une foule de beatniks ? Enfin, la troisième vire complétement au cauchemar, puisque c’est là que Duluoz devient fou.
Superficiellement, ces séjours solitaires à Big Sur peuvent rappeler celui au pic de la désolation. C’est pourtant dans une toute autre optique que celle du dharma et des Clochards célestes que Duluoz se rend dans le bungalow de Monsanto, y compris lors de sa première visite en solitaire. Sa période bouddhiste est passée, non sans avoir laissé certaines marques. Telle que la concevait Duluoz, cette foi plaçait l’homme au centre d’un tout. C’était pour se fondre dans ce tout que l’auteur s’était porté volontaire pour rester un été seul à Desolation Peak en temps que vigie, sur les conseils de son mentor Japhy Ryder (Gary Snyder). Aucune des trois virées à Big Sur n’a de telles ambitions… En pleine déchéance, le roi des Beat (surnom trahissant bien les attentes trop lourdes nées de sa célébrité) perçoit désormais les enseignements bouddhistes sur la place de l’homme -grain de poussière dans l’univers- sous un jour bien plus sinistre, également influencés par les préceptes catholiques justifiant une vie de souffrance par la promesse du paradis. Autrement dit, il se considère comme un être insignifiant tout juste capable de détruire et de faire du mal aux autres, et, sans dimension autre que la boisson à donner à sa vie il en est venu à se haïr lui-même. D’où son comportement destructeur, qui l’éloigne de ses proches amis, qui cherchent pourtant à le sortir de son trou. Cody Pomeray / Dean Moriarty / Neal Cassady fait un retour fracassant dans la vie de Duluoz / Kerouac, mais le temps a passé et si leur amitié est toujours aussi solide elle ne peut plus prendre la forme qu’elle avait 15 ans plus tôt. Ce n’est pourtant pas faute d’essayer, mais le déclin psychologique de Duluoz avorte les projets allant dans ce sens. Comme à la belle époque, Pomeray cherche par exemple à confier sa maîtresse du moment à son ami, en espérant cette fois que cela les conduise au mariage comme lui-même est désormais marié à Evelyn (Carolyn Cassady, Camille dans Sur la route). Ainsi fixés, les ex compères pourraient être de nouveau sur un pied d’égalité et surtout évoluer dans un même milieu, et pourquoi pas partager leurs femmes en menant une double vie croisée. Mais, n’ayant pas changé beaucoup malgré son séjour en prison, Pomeray ne tient pas ses promesses, toujours fidèle à son individualisme qui l’avait déjà fait abandonné Sal Paradise / Jack Duluoz / Jack Kerouac dans un hôpital mexicain. Il abandonne ainsi ce dernier auprès de Billie, femme que Duluoz n’aime pas, mère d’un gamin et à laquelle il parle pourtant de mariage. Terrifié autant par le gamin en question que par la perspective de se fixer, plongé dans la double vie de Pomeray où il croise la route d’un ex taulard aux gros bras nommé Perry Yturbide, dont l’ambiguë affection pour les petites filles l’épouvante, Duluoz se livre plus que jamais à l’alcool et devient un légume posé dans un fauteuil voyant défiler une faune qu’il ne comprend pas. Ce qui l’amène à fuir vers Big Sur avec un couple d’amis et avec Billie et son gamin, dont il ne peut se débarrasser. Au passage, en débarquant chez Pomeray, il aura trahit celui-ci en écornant le secret de sa double vie. Coup dur porté à une grande amitié, et dernier indice de la folie qui gagnera Duluoz à Big Sur.
Les pages racontant ce séjour écourté, tant attendues puisqu’annoncée dès le début du roman, comptent probablement parmi les choses les plus fortes qu’a pu écrire Kerouac. A ce stade, le seul objectif de ce séjour en compagnie de Billie, de son fils, de Dave Wain (Lew Welch) et de la compagne de celui-ci Ramona Swartz (Lenore Kandel, future chantre hippie), tout deux poètes, ne semble être qu’une cure de désintoxication. A part le fils de Billie, un gamin en bas âge, tout le monde cherche à faire de ce séjour un instant de calme au milieu de leurs vies agitées. Ce n’est pas d’attention dont manquera Duluoz, et pourtant il est bel et bien devenu fou. Son isolement spirituel est total, ses méditations sont noircies par l’alcool qui constitue la seule chose qu’il ingurgite et tout cela prend le pas sur la réalité. La narration de ce séjour est dominée par l’esprit de Duluoz, véritable prisme transformant la réalité en hallucinations sinistres, sorte de version macabre du Las Vegas Parano de Hunter J. Thompson dont l’humour côtoierait la compassion pour ce personnage en pleine dérive. Duluoz est complètement paranoïaque, persuadé que ses amis veulent intenter à sa vie lorsqu’ils ne veulent que l’aider, et que lui-même n’a fait que donner la mort, comme par exemple plus tôt, avant son départ, en laissant mourir les poissons de Billie (évènement futile qui l’obsède malgré tout). Cette idée de mort ne l’avait en fait plus quitté depuis le début du livre, lorsqu’il apprit par la lettre de sa mère la mort de son chat idolâtré. La mort, Billie et son gosse, la brouille avec Cody Pomeray, la brume de Big Sur, les enseignements bouddhistes, tout lui revient en tête pour le torturer dans ce bungalow où il s’humilie et pourrit le séjour de ceux qui ont bien voulu l’accompagner. « Oh merde, j’en ai marre de cette existence. Si j’avais assez de tripes, je me noierais dans cette eau écœurante« , songe-t-il entre deux bouteilles. La nature elle-même cherche selon lui à l’y inciter, puisque tout est lugubre sur Big Sur, spécialement la nuit. Le roman a beau s’achever sur une note optimiste (suite à un rêve très catholique) et par la fin de sa folie, trop soudaine pour être sérieuse, la Légende de Duluoz s’achève sur cet épisode marquant la fin du Kerouac « beatnik ». Par la suite, sa carrière se composera essentiellement de retouches à ses livres (un seul roman écrit à cette période, lui qui fut pourtant si prolifique), d’enregistrements audio, de prises de positions très réactionnaires, d’apparitions télévisées, d’une séparation plus ou moins prononcée avec ses amis beatniks et, toujours, d’un retranchement auprès de sa mère (chez laquelle il vivait avec sa troisième femme). Une mode de vie en apparence rangé, mais qui doit être perçu d’une part comme une nouvelle manifestation de l’anticonformisme systématique de Kerouac à cette époque du Flower Power et d’autre part comme l’aveu d’une vie dors et déjà terminée, qu’il achèvera plus ou moins consciemment dans la pauvreté et l’alcool.
Ce qui est arrivé à Duluoz dans Big Sur n’est en fait rien de moins que le retour de bâton de son mode de vie purement spirituel, celui-là même qui a fait de la Beat generation un fantasme culturel devenu au grand dam de l’auteur une marque de fabrique attirant les médias et les jeunes en mal d’identité. Tout le contraire de la fraicheur et de la spontanéité avec laquelle les « beatniks » originels avait commencé leurs tribulations, avant même d’être connus. Notons d’ailleurs que le cercle autour de Kerouac, Burroughs, Ginsberg et compagnie s’est élargit au fil du temps non pas au gré des adhésions d’admirateurs, mais au gré des rencontres et des affinités. Or, pour les quelques vrais amis comme Arthur Ma et George Baso (nom donné au bouddhiste Albert Saijo) que se fait encore Duluoz malgré son alcoolisme, figurent aussi des personnages bien moins en phase avec lui, tel que Ron Blake, « ce pauvre gosse qui s’imagine qu’il y a quelque chose de noble, d’idéaliste, de beau dans toute cette sauce beat » ou encore l’ex taulard Perry Yturbide, ami de Pomeray / Cassady. Big Sur nous montre la finalité d’un auteur qui avait tout pour être heureux dans sa condition matérielle, mais qui a finit rattrapé et piégé par des idées et un mode de vie trop intense, qu’il n’a put maintenir sur la durée (car oui, l’âge a aussi joué dans la chute de Kerouac). Ce roman nous présente une spectaculaire sortie de route en fin de compte prévisible dès Sur la route, titre qui résume bien la vie de Kerouac, ses lignes droites, ses virages, ses culs de sac… Big Sur est certainement l’un des trois meilleurs livres de son auteur, en compagnie de Sur la route et des Clochards célestes. Tout trois ont été écrits sur un rouleau de papier, et tout trois ont en commun de nous montrer un Kerouac totalement imprégné de son humeur du moment : respectivement frénétique, zen et désespéré. Les points d’orgue de la vie d’un artiste assez unique, y compris au sein de la génération qui le caractérise.
Maintenant, un mot sur La Mer, bruits de l’océan à Big Sur, poème d’une vingtaine de pages présent à la fin de l’édition Folio de Big Sur. Écrit comme son titre l’indique sur la plage, lors du séjour en solitaire de Kerouac, ce poème est pour le moins très difficile d’accès, encore plus que le plus complexe des romans de l’auteur. A vrai dire, il est difficile de trouver un sens à ces vers régis par aucune sorte de règle, que ce soit d’un point de vue stylistique ou tout simplement narratif. Bien entendu écrits spontanément, ils reproduisent bien le bruit de l’océan : c’est donc pour une bonne part un assemblage d’onomatopées qui peuvent ou non être des transformations de mots réels « tordus » par l’interprétation que se faisait Kerouac du bruit des vagues (le traducteur a dû beaucoup s’amuser -si tant est que la traduction de poésie même « classique » ait déjà un sens-). Nous ne sommes plus très loin des jeux de mots et des simples néologismes. D’un autre côté, certains vers ont un sens compréhensible, mais n’en ont plus une fois alignés les uns après les autres. Ce sont les divagations de Kerouac, qui dans sa poésie se laisse totalement aller. Enfin, certains vers comprennent aussi des onomatopées, ce qui les rend particulièrement opaques, à l’image de l’ensemble du poème, qui il faut bien l’admettre est beaucoup trop abstrait pour être interprété textuellement. C’est en tout cas fort différent du célèbre Howl de Ginsberg qui alignait des vers extrêmement longs -réminiscents des rouleaux de Kerouac- évoquant clairement toute la folie du mouvement beat (et qui démarrait en ces termes : « J’ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus« ).

