La Nasse – Pete Walker
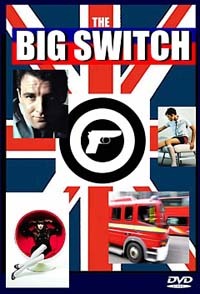 |
The Big Switch. 1969Origine : Royaume-Uni
|

Avant que le public ne s’intéresse à son sort, le pauvre John Carter (Sebastian Breaks) n’avait déjà pas la belle vie. Ayant raté une carrière de rocker, il tenait un minable poste de photographe publicitaire. Son sort empire dès le début du film qui lui est consacré : à peine s’est-il éclipsé dix minutes de l’appartement de sa pouliche d’un soir pour acheter des cigarettes que ladite pouliche est assassinée. Pas malin, il fuit sans avertir la police. Le lendemain, il se fait virer de son poste sans raison et des caïds viennent le tabasser chez lui pour le presser de régler des dettes de jeux. Pour parachever le tableau, un pourri du nom de Mendez (Derek Aylward) menace de le balancer à la police si il n’accepte pas de se rendre à Brighton en compagnie d’une certaine Karen (Virginia Wetherell) pour recevoir des ordres au sujet d’une mission dont on ne lui dit rien. Avec la chance qu’il a, cette mission risque bien d’être une entourloupe.

A son niveau, Pete Walker est un peu un « golden boy ». Parti des autoproductions de sexploitation tournées avec trois bouts de ficelles, il fit plus de dix ans durant son petit bonhomme de chemin dans le cinéma indépendant pour bifurquer sur l’horreur et terminer sa carrière de réalisateur en apothéose avec Le Manoir de la peur, son seul film de studio (et pas n’importe lequel : la Cannon de Golam et Globus !), doté d’un casting de luxe malgré l’âge avancé de ses acteurs : Vincent Price, Peter Cushing, Christopher Lee et John Carradine. Difficile d’imaginer cette trajectoire modérément ascendante à la vue de La Nasse, l’une des sexploitations microscopiques de son début de carrière. Tournée en 1969, cette œuvre d’à peine plus d’une heure (sauf dans certains pays, où elle eut droit à du rab de polissonnerie) mêle machinalement érotisme soft et policier british, surfant à la fois sur la vague libertaire de son époque de production et sur le succès des héros british du type James Bond ou John Steed. On y retrouve donc ce look très spécifique de l’Angleterre de l’époque, avec ses voitures toutes en arrondis, ses jeunes femmes sophistiquées courtement vêtues, ses rockeurs chevelus et ses boîtes de nuit colorées. Pete Walker n’a pourtant pas utilisé sciemment tous ces ingrédients : au cœur même de l’année érotique, il s’est contenté de filmer ce qui lui passait sous les yeux sans enjoliver ni noircir le tableau, et même sans avoir conscience de l’importance que prendra cette époque dans les esprits. A ce titre, la voix ouvrant le film est éloquente, puisqu’elle nous décrit ce contexte comme étant un endroit certes marqué par l’évolution des moeurs, mais un endroit après tout singulièrement normal. Du reste, toute trace de photographie semble absente de La Nasse. Ce qui fait que nous pouvons donc voir à quoi ressemblait réellement les quartiers festifs du Londres de 1969, loin des représentations caricaturales généralement de mise dans la plupart des films situés à cette époque et loin des polissages des grosses productions de l’époque. Cette sobriété, si elle est louable à un niveau sociologique (certainement pas l’objectif de Walker !) l’est nettement moins pour le scénario, avec sa théorie du complot. Difficile d’être convaincu par cette histoire de gangsters organisés et de héros dur à cuire alors que Londres est tristement banale, que Brighton se résume à quelques immeubles et que les quelques pelés du casting restent inactifs. John Trent lui-même subit passivement les évènements jusqu’à un climax d’une incroyable mollesse se déroulant dans un train fantôme. Dans des wagonnets roulant à cinq à l’heure au milieu de dessins évoquant plus les gribouillages d’enfants de maternelle que les tableaux fantastiques de l’ère gothique, le règlement de compte final aurait fait bonne mesure dans les séries policières allemandes lors des fin d’après-midi du service télévisuel public. D’ailleurs, le flic qui intercepte nos deux vedettes triomphantes à la sortie du manège leur propose d’enregistrer leur déposition autour d’une tasse de thé. C’est dire si leur mésaventure est considérée comme homérique.

C’est pourtant la seule scène d’action d’un film qui est caractérisé par l’expectative dans lesquels sont plongés John et Karen jusqu’à ce qu’ils devinent les projets de Mendez, dix minutes avant de fuir dans le train fantôme. Avant ça, et bien… La copine de John se fait tuer, John se fait tabasser, John se fait virer, John est victime de chantage, John est enlevé, John est enfermé… Mais John ne fout rien. Il est passif. Cela ne l’empêche pas de se la ramener régulièrement, visiblement dans une tentative de se faire passer pour un mâle viril, un dur à cuire digne d’Humphrey Bogart (il passe d’ailleurs le plus clair de son temps à fumer). Ce qui le discrédite un peu plus : en lieu et place du détective rugueux que Pete Walker aimerait qu’il soit, il n’apparaît que comme un aigri dont la seule force de persuasion tient dans la plume miraculeuse du scénariste (Walker lui-même), qui lui permet de convaincre une geôlière de passer au lit plutôt que de le surveiller, et dans les instruments du musicien, qui se prend pour John Barry. Bref, compte tenu de la personnalité du héros, le moindre fait d’arme de sa part sonne faux. Mais il y a pire. Le plus flagrant manque de naturel intervient lors des scènes de nudité, catapultées inopinément dans le récit sans aucune nécessité autre que celle d’assumer le statut de sexploitation. Pas fou, Walker sait bien que ce qui fera vendre son film n’est pas l’intrigue policière… La quasi intégralité de ses actrices se retrouve donc à poil à un moment où à un autre. La plupart d’entre elles traversent d’ailleurs le film comme ça, le temps d’une scène gratuite. La copine du début se fait assassiner en se changeant, Carter traîne dans un bar à strip-tease, il rentre chez lui pour y trouver des gens en train d’écraser une femme au strip poker (Strip Poker est d’ailleurs le titre alternatif du film, même si le jeu n’a aucune sorte d’importance), il photographie des filles nues pour une pub pour déodorants, il entre dans la maison de Mendez à Brighton pour y trouver deux occupantes dans leur bain, et le comble du comble, il rejoint Mendez lorsque celui-ci donne des consignes à ses catcheuses dévêtues. Karen elle-même, la « Carter Girl », ne sert en gros qu’à être désapée le temps d’une séance photo, traînant le reste du temps comme un boulet aux pieds du raté poisseux. C’est à peu près tout ce que propose La Nasse, et c’est bien maigre, surtout que ces scènes sont traitées sans aucun style, et sont donc loin d’être aussi aguichantes que le cinéma d’un Russ Meyer. Le reste n’est en fait que le support à ces quelques instants, et plutôt que le personnage principal, John Carter est en fait un fil rouge permettant de croiser quelques figurantes qui sont quant à elles les véritables vedettes de La Nasse. Pete Walker n’a même pas le courage de tenter quelque chose d’autre (un peu d’humour, par exemple, aurait été le bienvenu), tant et si bien que son film reste toujours très plat, dépourvu de vie. C’est aussi ce qui explique que les quelques timides sursauts d’orgueil de son héros et que les soudaines apparitions de figurantes décoratives paraissent incongrues. Le réalisateur ne tarda pas à quitter le monde de la sexploitation, expliquant qu’il avait l’impression de tourner en rond. On peut confirmer. La Nasse manque clairement d’audace : tout y est traité par dessus la jambe, et tout compte fait, on aurait encore préféré assister à une description caricaturale de cette Londres « underground » de 1969. Au moins, les couleurs psychédéliques auraient-elles permis de marquer les esprits.


