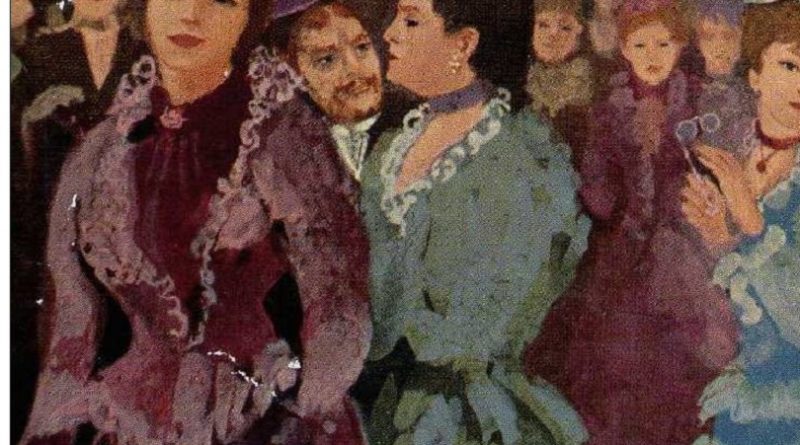Au bonheur des dames – Émile Zola
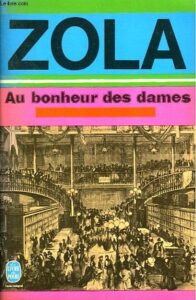 |
Au bonheur des dames. 1883Origine : France
|
Onzième roman des Rougon-Macquart, Au bonheur des dames est plus ou moins la suite directe du dixième, Pot-Bouille, en ce sens qu’il se penche sur le cas d’Octave Mouret, fils de Marc Mouret et Marthe Rougon, devenu époux de Mme Hédouin dans Pot-Bouille. Héritier du Bonheur des dames, magasin de vêtements pour femmes qui n’était au moment où il en a hérité qu’une modeste boutique, il en a fait un empire en pleine croissance par des méthodes commerciales révolutionnaires. Et qui dit révolution dit destruction du vieux monde, c’est à dire des commerces à l’ancienne qui le ceinturent. Denise Baudu, nièce d’un de ces commerçants menacés par le Bonheur des dames, débarque en orpheline à Paris avec ses deux jeunes frères dont elle a la charge. Malgré l’opinion tranchée de son oncle sur le Bonheur des dames et son propriétaire, Denise se sent attirée par cette boutique, et y trouve une place en temps que simple vendeuse. De là, elle devra survivre aux conditions de vie des employés du Bonheur, et observera celles, de plus en plus dégradées, des autres commerçants.
Toujours dans son optique naturaliste, Zola se penche cette fois-ci sur la transformation du commerce parisien, s’appuyant sur l’exemple de Auguste Hériot, qui reprit la petite boutique Au Pauvre Diable en 1855 pour la laisser à sa mort en 1879 comme l’un des temples du commerce parisien, sous l’appellation des Grands Magasins du Louvre. L’époque changeait, Paris changeait, et la nature du commerce également. Cela méritait bien un roman, histoire d’étudier cette transformation, son impact sur le vieux monde, sur ses nouveaux employés et sur les mode de consommation. C’est bien deux conceptions différentes qui s’affrontent : celui d’un commerce artisanal, géré de façon familial et se concentrant sur un seul et même produit (ainsi, Baudru, l’oncle de Denise, vent des tissus, tandis que Bourras, son voisin d’en face, vend des cannes qu’il sculpte lui-même) et celui de la modernité, le Bonheur des dames, véritable industrie de la consommation, vendant de tout en grande quantité, à des prix défiants toute concurrence. Les marges des commerces familiaux s’obtiennent par des prix élevés, tandis que celle du magasin de Mouret repose sur une faible marge, mais sur des ventes beaucoup plus nombreuses. Et bien entendu, bien que la clientèle soit identique d’un côté comme de l’autre (les femmes de la bourgeoisie, petite ou grande, car à cette époque le prolétariat ne pouvait écumer les magasins de mode), elle préfère toujours aller là où le choix est plus vaste pour un prix moins élevé. D’où les difficultés croissantes rencontrées par Baudu et les autres petits commerçants. Car Mouret est un homme dont l’ambition n’a d’égal que l’ingéniosité. Il voit toujours plus grand, et sa seule obsession est d’agrandir le magasin, créer de nouveaux rayons, et donc accroître son chiffre d’affaire. Mais en s’agrandissant, le Bonheur des dames finit par empiéter littéralement sur ses modestes voisins. Non seulement leurs secteurs d’activités sont petit à petit mis en concurrence déséquilibrée avec les rayons de l’empire de Mouret, mais en plus son agrandissement perpétuel finit par être une menace à leurs propres locaux. La baisse du chiffre d’affaire conduit des gens comme Baudu et Bourras à subir la pression financière de Mouret, désireux de leur racheter leurs boutiques pour les intégrer au Bonheur des dames. Hommes fiers, ces petits commerçants tentent de résister à l’étouffement, jusqu’à la mort. Mais rien ne peut contrecarrer le développement du Bonheur des dames. Même Robineau, un vendeur dissident affranchi de l’enseigne de Mouret pour fonder son propre commerce, échoue à lui faire concurrence. A l’instar de la compagnie minière de Germinal, pouvant résister à une grève jusqu’à ce que les mineurs soient écrasés, le Bonheur des dames a les reins solides, et même la vente à perte ne le met pas en danger. Comme il le fera pour la mine de Germinal, Zola décrit ce magasin comme un ogre. Bref, la disparition de ce commerce familial est inéluctable. Disparition professionnelle, puis disparition physique, et disparition des commerçants eux-mêmes, trop fiers pour avoir accepté de se livrer à Mouret mais aussi trop accrochés à leurs valeurs, surannées. Car si Zola déplore à travers Denise la misère dans laquelle sont plongés les Baudu et consorts, provoquée par le Bonheur des dames, il n’en condamne pas pour autant Mouret. La transformation du commerce est devenue nécessaire dans une zone urbaine telle que Paris, où la société de consommation est en train de prendre son envol. C’est un ordre naturel des choses qui se produit, et l’ancien ordre est appelé à disparaître. Cette révolution a beau être marchande, elle n’échappe pas aux conséquences de toute révolution : la disparition pure et simple de ce qui demeure ancré à l’ancien monde. L’optique naturaliste de Zola est ici évidente.
Puisque c’est un nouveau mode de commerce qui s’est créé, l’analyse de la stratégie de Mouret est également nécessaire. C’est même ce qui est le plus fascinant d’Au Bonheur des dames, tant notre société actuelle du XIXème siècle est empreinte de ces méthodes devenues monnaies courantes. Déjà, le concept de grand magasin rassemblant toute sorte d’articles n’est autre que celui de nos supermarchés, qui eux-mêmes ne se privent d’ailleurs pas pour écraser les épiceries du coin, par exemple (plus généralement, l’implantation de franchises est un grand danger pour chaque petit commerce). L’idée d’Octave Mouret, qui est celle de cajoler ses clientes, de les traiter en reines pour mieux les déplumer de leur argent, relève de la même hypocrisie dissimulée derrière l’expression « le client est roi ». Baisser les prix pour mieux fidéliser la clientèle et l’inciter à payer moins tout en achetant plus est la même stratégie que celle de bien des enseignes contemporaines. L’étude du comportement du consommateur ne varie pas d’un iota : aguicher les acheteurs en offrant une masse de produits à prix cassés, pour les amener à acheter finalement plus d’articles, avec une dépense finale supérieure à ce qui était envisagée en entrant. Toute l’idée est là : contraindre l’acheteur à acheter autre chose que ce qu’il était venu chercher. Sous nos yeux, au fil des pages, c’est tout le commerce actuel qui se met en place. Cela passe aussi par la publicité agressive, s’affichant par des affiches placardées sur les murs, par des annonces dans les journaux, par l’édition de catalogues et même par des convois publicitaires. On retrouve également le commerce par correspondance ou la livraison à domicile. Et puis il y a l’organisation des rayons, en vrac pour mieux contraindre le client à parcourir le magasin et à se laisser attirer par les couleurs vives et les dispositions savamment étudiées des articles. Le vol est même perçu comme un signe encourageant, car signe que ces dames -aisées- se sont laissées tourner la tête par les produits du Bonheur des dames. Bref, dans ses méthodes vis-à-vis de la clientèle, le Bonheur des dames n’est rien d’autre que l’ancêtre de nos grosses enseignes actuelles. Un temple de la consommation que l’auteur décrit en un champ lexical digne d’une description de cathédrale.
Fort heureusement, il n’en va pas de même pour le traitement des employés. Des progrès sociaux ont heureusement été conquis, et le statut de travailleur dans un tel magasin, quoiqu’il reste encore fort précaire de nos jours, n’a plus grand chose à voir avec celui des salariés du Bonheur des dames. C’est à ce niveau que Zola se refait le peintre de son époque, et le lire actuellement ne peut que nous rendre compte du chemin déjà parcouru par le progrès social. Les employés de Mouret travaillent six jours par semaines, selon des horaires bien plus larges que nos 8 heures (officielles) quotidiennes. Les employés les plus pauvres sont également logés aux appartements du magasin, où leur vie est régulée comme elle le serait dans un pensionnat. La nourriture se prend à la cantine, et il est bien entendu hors de question de discuter pendant les horaires de travail. Il est encore plus mal pour un homme et une femme de se fréquenter en dehors des liens du mariage, car la clientèle bourgeoise en serait outrée. Les femmes enceintes n’ont aucun droit, et doivent prendre la porte, dotées de ressources ou non, ce qui contraint plusieurs d’entre elles à dissimuler leur grossesse au point d’accoucher d’enfants morts-nés. Tout ce personnel est entièrement soumis au caprices des clientes, en droit d’exiger tout et n’importe quoi. La division entre employés est également encouragée par un système de prime à la vente, poussant chaque vendeur à vouloir empiéter sur son voisin, voire même à pratiquer la délation. Enfin, le système de promotion incite ces mêmes employés à faire du zèle auprès de la direction, à comploter contre leurs supérieurs immédiats afin d’obtenir leur poste. Tout ceci contribue à créer une ambiance délétère, et en fin de compte à asseoir l’hégémonie de Mouret, qui en plus de manipuler les clientes parfois jusqu’à apparaître comme leur proche pour mieux profiter d’une de leur relation haut placée (comme le responsable d’une agence de crédit immobilier, propriétaire des immeubles dont nécessite Mouret pour agrandir son enseigne) manipule aussi ses employés.
C’est dans ce milieu qu’atterrit Denise, pauvre jeune fille de la campagne, avec ses deux frères à charge. Prise à partie par ses nouvelles collègues et par tous les supérieurs, elle ne doit sa présence qu’à la bienveillance de Mouret, intrigué par elle. Dès leur première rencontre, il devient évident que l’histoire d’amour n’est qu’une question de temps. D’ici là, Denise devra même vivre dans une misère noire, un temps renvoyée du Bonheur. Avec elle, Zola commet l’erreur d’avoir recours à une histoire romantique, typiquement XIXème siècle, qui sort quelque peu le roman de son naturalisme. Denise est trop parfaite : trop gentille, trop compatissante, trop courageuse, trop hésitante à répondre à l’amour de Mouret, bref trop niaise. Son développement personnel, puis son retour en grâce au Bonheur, permet certes de développer le constat social de Zola au sujet du magasin, mais il parasite aussi une intrigue qui se retrouve ainsi cousue de fil blanc. On ne retire vraiment pas grand chose de Denise, en tout cas nettement moins que des pages où Zola évoque la mutation du commerce. Elle adoucie ce qui serait apparu comme un peu sec, mais quand à s’intéresser véritablement à ses amours et son pathos, c’est une autre paire de manches… Ce qui n’enlève rien à l’apport d’Au Bonheur des dames à la retranscription de la vie sous le second empire, concernant un sujet il est vrai un peu moins fort que celui de Germinal.